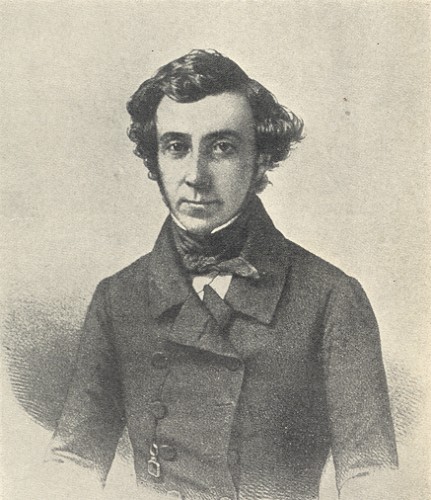vendredi, 22 mai 2009
Un seul peuple de frères - l'Etat dans la littérature

SYNERGIES EUROPÉENNES - Juillet 1988
Un seul peuple de frères - L'Etat dans la littérature
Peter SCHNEIDER, ”... ein einzig Volk von Brüdern”. Der Staat in der Literatur, Athenäum, Frankfurt a.M., 390 S., DM 48.
Le titre de cet ouvrage, c'est la formule du célèbre serment de Rütli, fondateur de la Confédération Helvétique. Etre un seul peuple de frères, tel est le vœu profond de toute nation qui veut for-mer un Etat de citoyens, un Etat fondé sur la volonté commune de tous les citoyens. Dans cette formule, la multiplicité sociale se voit sublimée, les oppositions et les clivages de toutes sortes s'évanouissent dans un néant idéal. Cette aspiration pluriséculaire, qui traverse toute l'histoire européenne, c'est davantage la littérature que la théorie politique qui s'en est fait le véhicule. Schiller, dans son Wilhelm Tell (= Guillaume Tell) opère de manière optimale la fusion entre unité et pluralité au sein des corps politiques: l'individu-personne possède des droits mais de-meure responsable vis-à-vis du tout; ainsi, sans concept rigide, sans corset juridico-philosophique, dans une langue limpide, s'exprime, par le génie du poète, l'instinct politique européen, idéaliste et faisant ta-ble rase de toutes les corruptions. L'œuvre antonymique, c'est l'épopée médiévale de Reineke Fuchs (le Roman de Renard), marquée d'esprit satirique. Aucune volonté communautaire, holiste, ne s'y manifeste et il n'y règne que la ruse et la violence. Si Wilhelm Tell représente l'idéal pur de la psyché politique européenne, Reineke Fuchs exprime sa désillusion, sublimée en satire. Entre ces deux pôles a émergé une quantité de variantes, démontre Schneider: chez Kafka, il perçoit une désillusion noire qui a la nostalgie de l'amitié, manifestation de pro-xi-mité humaine, et aspire à une nouvelle union de la ratio et de la voluntas. Les réflexions de Schneider se poursuivent sur Jerry Cotton, James Bond, Ernst Jünger, Anna Seghers, Friedrich Dürrenmatt et Albert Camus (Robert STEUCKERS).
00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, suisse, littérature, lettres, littérature allemande, lettres allemandes, histoire, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 mai 2009
Partijen in overheidsdiensten
Partijen in overheidsdienst
De politieke partijen hebben tijdens de voorbije decennia ongegeneerd in de staatskas gegraaid, met als gevolg dat hun inkomsten vandaag voor 83procent afkomstig zijn van de overheid. Elk jaar vloeit 53 miljoen euro van de belastingbetaler naar de partijen. Politieke partijen zijn daardoor parastatale organisaties geworden, die uit de hand eten van de overheid. Helemaal problematisch wordt het wanneer de gevestigde partijen die overheidsfinanciering ook gaan misbruiken als een politiek wapen om hun concurrenten onderuit te halen.
In 2003 verloren zowel Agalev als de N-VA hun dotatie. Dit betekende voor beide partijen een enorme financiële aderlating en bracht hen op de rand van de afgrond. Maar goed, dat was nu eenmaal de wet: dura lex, sed lex. Alleen hadden de gevestigde partijen het zo niet begrepen. Open VLD wilde vermijden dat de N-VA om financiële redenen een kartel zou sluiten met de CD&V. De N-VA kreeg van Open VLD de belofte dat de criteria om een dotatie te krijgen zouden worden versoepeld, op voorwaarde dat de partij geen kartel zou sluiten met de CD&V. Uiteindelijk is die deal niet doorgegaan en werd er pas bij de Vlaamse regeringsvorming een akkoord bereikt over de wijziging van de wet in het voordeel van de N-VA. Agalev daarentegen bleef financieel in de kou staan. Dat paste het best in het kraam van de SP.A, die op dat moment aanstuurde op een rood-groen kartel. De wetgeving werd dus gewijzigd à la tête du client. Anders gezegd: de gevestigde partijen maken misbruik van de partijfinanciering om het politieke landschap naar hun hand te zetten.
Nog een straffer voorbeeld daarvan is de manier waarop een aantal gevestigde partijen nu proberen om Vlaams Belang financieel droog te leggen. Politici hebben de geldkraan van de bedrijfsgiften helemaal dichtgedraaid en ook de privégiften sterk aan banden gelegd. Het gevolg is dat men door de overheidsfinanciering stop te zetten meteen ook de financiële levenslijn van een partij doorknipt. Wanneer men dit systematisch zou doen, dan komt dit in de praktijk op hetzelfde neer als een partijverbod. Op die manier krijgt de politieke elite een machtig wapen in handen om ongewenste partijen hetzij van de kaart te vegen, hetzij in de pas te doen lopen. Vandaag wordt dit wapen gebruikt tegen een uiterst-rechtse partij, maar morgen kunnen ook andere (communistische, islamitische, Eurosceptische) partijen worden geviseerd die door de elite als bedreigend worden ervaren.
Het zijn heus niet enkel separatisten en extremisten die problemen hebben met de financiële drooglegging van Vlaams Belang. De Raad van State heeft zelf twijfels bij de grondwettelijkheid daarvan en vraagt zich af of die drooglegging wel te rijmen valt met de vrijheid van vereniging. In januari heeft de Raad deze kwestie dan ook voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. Benieuwd wat het Hof zal doen met deze wel zeer hete aardappel.
Maar de kiesstrijd wordt ook nog op een andere manier financieel gemanipuleerd door de overheid. Op 17 mei organiseert de vzw Belgavox een gratis concert aan het Atomium. Het concert heeft een uitgesproken politiek oogmerk, namelijk 'het versterken van de solidariteit, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België, en het versterken van de Belgische identiteit.' (aldus de Belgavox-website). Ook al omdat dit concert plaatsvindt in de directe aanloop naar de verkiezingen gaat het hier overduidelijk om een politieke manifestatie. Er kan moeilijk worden ontkend dat het initiatief is gericht tegen de separatistische partijen in Vlaanderen: Vlaams Belang en de N-VA, die samen ruwweg 20procent tot 30procent van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigen. Tot hier is er evenwel geen vuiltje aan de lucht. Verkiezingen of niet, het staat de betrokken artiesten en intellectuelen volledig vrij om zich te outen als goede Belgische patriotten en om een antiseparatistische manifestatie te organiseren.
Maar wat te denken van het feit dat deze electorale manifestatie mee wordt gefinancierd door de overheid? Hoofdsponsors van het concert zijn immers de Nationale Loterij en Belgacom (voor 54procent in handen van de Belgische staat). Het initiatief wordt ook gesteund door de Vlaamse en Franstalige openbare omroep en door de Stad Brussel. En bovendien voorziet de NMBS in een voordelig tarief voor wie met de trein naar deze politieke meeting komt.
Met de ene hand probeert de overheid de grootste separatistische partij financieel te nekken. Met de andere hand financiert diezelfde overheid een antiseparatistische politieke manifestatie vlak voor de verkiezingen. Partijen en kandidaten worden tijdens de campagne stevig gekortwiekt door de overheid. Ze moeten zich houden aan draconische uitgavenbeperkingen. Dat gaat zelfs zo ver dat gewone kandidaten nauwelijks nog een campagne kunnen voeren die naam waardig. Maar diezelfde overheid mag zelf blijkbaar onbeperkt electorale manifestaties financieren. Dit is toch echt wel de wereld op zijn kop.
Een land waar zulke dubieuze praktijken mogelijk zijn en worden geduld kan men bezwaarlijk een normale democratie noemen. Maar wie maakt zich daar nu nog illusies over?
Bart Maddens is politicoloog aan de K.U. Leuven.
00:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, corruption, manipulations, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pirateria e Impero
Piratería e Imperio
 La actual “guerra contra la piratería,” que se extiende a los tribunales kenianos y estadounidenses después pasar meses hirviendo a fuego lento ante las costas de Somalia, es sólo la última en una larga serie de acciones de EE.UU. al servicio del imperio contra protagonistas no-estatales. La “Guerra Global contra el Terror,” que el gobierno de Obama reemplazó recientemente por el término más vago de “operaciones de contingencia en ultramar,” justificó un aumento en gran escala de los gastos militares, dos grandes intervenciones, y llamados explícitos a que EE.UU. mantenga su poderío sin igual. Al poner en peligro los puntos neurálgicos marítimos del mundo, los piratas emergen como la última amenaza no-estatal: los terroristas de los mares.
La actual “guerra contra la piratería,” que se extiende a los tribunales kenianos y estadounidenses después pasar meses hirviendo a fuego lento ante las costas de Somalia, es sólo la última en una larga serie de acciones de EE.UU. al servicio del imperio contra protagonistas no-estatales. La “Guerra Global contra el Terror,” que el gobierno de Obama reemplazó recientemente por el término más vago de “operaciones de contingencia en ultramar,” justificó un aumento en gran escala de los gastos militares, dos grandes intervenciones, y llamados explícitos a que EE.UU. mantenga su poderío sin igual. Al poner en peligro los puntos neurálgicos marítimos del mundo, los piratas emergen como la última amenaza no-estatal: los terroristas de los mares.
Sin embargo, no es una historia nueva. Hace doscientos años, los piratas de Barbería llevaron a los primeros gastos militares de importancia en la historia pos-revolucionaria de EE.UU. y aumentaron el perfil del Cuerpo de Marines de EE.UU. Después de los ataques del 11-S, los conservadores utilizaron comparaciones forzadas entre esos piratas y al-Qaeda como justificación para invadir Afganistán y lanzar una guerra global contra el terrorismo.
Hubo piratas presentes en la creación del imperio de EE.UU. ¿Han vuelto para el acto final del imperio?
Los neoliberales y los neoconservadores tienen diferentes respuestas a esta pregunta.
El mito del guerrero renuente
Según un agradable mito liberal excepcionalista, EE.UU. siempre ha defendido la democracia en el extranjero y ha renunciado a primeros ataques militares. George Washington, quien estableció un ejemplo al renunciar a su cargo militar para convertirse en el primer presidente civil del país, recomendó la neutralidad en la política exterior del nuevo país. Como tema utilizado por Jefferson en su advertencia contra “alianzas enmarañadas,” la neutralidad de los Padres Fundadores inspiró un siglo de subsiguientes aislacionistas. En el Siglo XX, EE.UU. entró a dos guerras mundiales sólo cuando fue provocado (el Lusitania, Pearl Harbor), y libró las guerras de Vietnam y Corea no para conseguir ventajas territoriales o por ambición imperial sino para defender a todo el Mundo Libre de una creciente mancha roja.
Las recientes guerras en Afganistán e Iraq pueden ser reempaquetadas para que se ajusten a esa narrativa inofensiva. Lanzamos la guerra contra los talibanes sólo después de que nos atacaron el 11 de septiembre. Luego apuntamos (inicialmente) a Sadam Husein por sus vínculos con el terrorismo, la amenaza (después) de sus armas de destrucción masiva, y (finalmente) por su verdaderamente atroz historial de violaciones de derechos humanos. En los tres casos, fuimos guerreros renuentes y combatimos por cuenta de otros, por razones altruistas de seguridad general o de democracia iraquí. En la más amplia Guerra Global contra el Terror, según la doctrina Bush, EE.UU. combate a terroristas en el extranjero para que no tengamos que combatirlos en nuestro suelo. La guerra “preventiva”, aunque pueda parecer imprudente y agresiva, es en los hechos prudente y defensiva. Como guerreros renuentes, loa estadounidenses son en última instancia hijos de George Washington.
Es un hermoso cuento de hadas para contarlo a niños a la hora de acostarse o a la ONU en tiempos de guerra. Pero, patrocinadores de la Guerra Global contra el Terror, incómodos con la visión de EE.UU. como pacífico excepto cuando es provocado, construyeron una contra-narrativa para servir sus propios propósitos. Para justificar una agenda bastante poco liberal – la adopción de masivos aumentos de los gastos militares, la suspensión de leyes internacionales como las Convenciones de Ginebra y la Convención de la ONU contra la Tortura, la perpetración de violaciones generalizadas de las libertades cívicas dentro del país – los neoconservadores prefirieron una narrativa con más testosterona. Ni siquiera se avergonzaron al utilizar la palabra “imperio.” Su contra-narrativa ha rastreado la historia intervencionista de EE.UU. desde el comienzo del imperio estadounidense hasta fines del Siglo XIX pasando por la construcción del “Siglo Estadounidense” durante la Guerra Fría. Esa desenfadada adopción del imperio suministra el elemento crítico – el thymós o el deseo y el esfuerzo y por lograr reconocimiento – cuya defunción fue lamentada por Francis Fukuyama en el fin de la historia. Los nostálgicos por la era del imperio reconocen que el mundo tiende hacia una inmensa democracia uniforme de mercado. Pero siguen existiendo por ahí diversas fuerzas antidemocráticas y anticapitalistas – vestigios comunistas como Cuba, potencias autoritarias como China, líderes dictatoriales como Robert Mugabe de Zimbabue, y la junta de Myanmar – y los facilitadores de la “Vieja Europa” carecen de las agallas para resistir a toda esa tiranía. Sólo el coraje y el poder de fuego pueden restaurar el thymós a su lugar de honor en el desarrollo de la historia del mundo.
La historia convencional de la expansión de EE.UU. en el extranjero se ha concentrado en que habría repelido a otros imperios y naciones-estado: españoles, soviéticos, vietnamitas, norcoreanos. Perceptiblemente ausentes en esa lista, excepto por un breve período durante el gobierno de Reagan, han quedado los protagonistas no-estatales y el mundo musulmán. Como tal, la campaña inspirada por los ataques del 11-S pareció ser un desvío en la historia de EE.UU.: una reacción sin precedentes a un evento sin precedentes. La Guerra Global contra el Terror se exponía a parecer no-estadounidense en su singularidad. Después de todo, ¿no fueron las Cruzadas algo europeo? ¿No fue el terrorismo un problema local para Londres, Madrid, Moscú, y Beijing? ¿No eran los Estados totalitarios los que libraban guerras globales?
De modo que, después de que decreció el choque inicial de los ataques del 11-S, los arquitectos de la nueva campaña de contraterrorismo se apresuraron a establecer una continuidad histórica. Para sustentar lo que se convertiría en la campaña militar más cara de la historia de EE.UU., era importante fabricar una genealogía – tal como la familia de un nuevo rico construye un escudo de armas falso para establecer un orgulloso y aristocrático linaje. La Guerra Global contra el Terror tenía que convertirse en una expresión esencial del destino de EE.UU. en lugar de ser un desvío del camino hacia una economía liberal de mercado global.
De esta manera, los propugnadores de la guerra global contra el terror descubrieron a los piratas de Barbería. A fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, EE.UU. mantuvo un conflicto de dos décadas de duración contra varios Estados a lo largo de la costa norafricana. La campaña inspiró la expansión de los Marines y la creación de la moderna Armada de EE.UJU. En días de debilidad general de EE.UU. – luchando con poco éxito contra los franceses y los británicos – las guerras de Barbería constituyeron un raro éxito para la joven república. Fue, en breve, una historia predispuesta para ser abusada: una guerra contra terroristas musulmanes antes de los hechos que resultó en una victoria militar de EE.UU. y un temprano triunfo del libre comercio.
La interpretación errónea de este episodio en la historia de EE.UU. es muy reveladora sobre los objetivos de la guerra global contra el terror. Y sirve como punto de salida útil para una consideración del futuro de la disputa entre los neoliberales y los neoconservadores sobre la trayectoria del poder global en lo que Thomas Friedman ha llamado una “era de piratería.”
Un paralelo pirata forzado
Los propugnadores de una Guerra Global contra el Terror no tuvieron que buscar mucho en los libros de historia después del 11-S para encontrar lo que necesitaban. Thomas Jewett, en la edición de invierno/verano de Early America Review, escribió que el 11-S “no es el primer conflicto en el que EE.UU. ha enfrentado semejantes ofensas contra la vida y la propiedad. Hubo otra época en la que se determinó que la diplomacia no sería sólo fútil, sino humillante y a la larga desastrosa. Una época en la que un rescate o tributo no compraría la paz. Una época en la que la guerra era considerada más efectiva y honorable. Y una época en la que la guerra se libraría, no contra grandes concentraciones de poderío militar, sino por pequeñas bandas formadas por individuos de espíritu indomable. Hace casi 180 años nuestro joven país atacó Trípoli bajo circunstancias que son extrañamente similares a los tiempos contemporáneos.”
Los panfletistas identificaron rápidamente los paralelos religiosos. Rick Forcier, director ejecutivo de la Coalición Cristiana del Estado de Washington, escribió en noviembre de 2001 sobre el terrorismo: “Es bastante antiguo, y así es su empleo por fundamentalistas islámicos, quienes durante siglos, han atacado con bombas, secuestrado, raptado, asesinado y extorsionado para difundir su religión y la gloria de su dios Alá. Conocidos en el pasado como ‘piratas de Barbería,’ los terroristas hicieron que el mundo de otrora temblara ante el pensamiento de ser capturado en alta mar y ser muerto o vendido a los traficantes de esclavos de Timbuktú.”
El periodista conservador Joshua London también tocó el tema de la Guerra Santa. Escribiendo en The National Review, opinó: “Aunque hay mucho en la historia de las guerras de EE.UU. contra los piratas de Barbería que es de relevancia directa con la actual guerra global contra el terrorismo, un aspecto parece ser particularmente instructivo para informar nuestro entendimiento de los asuntos contemporáneos. Dicho de modo muy simple, los piratas de Barbería eran musulmanes comprometidos, militantes, que insistían en hacer exactamente lo que decían.”
Sólo un mes después del 11-S, la derivación de paralelos era suficientemente significativa como para justificar un artículo del Washington Post que destacó los puntos de vista de numerosos historiadores sobre el tema. Entre los citados estaba el profesor de derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, quien utilizó explícitamente la analogía histórica en su recomendación al Congreso. “Invocó el precedente de los piratas de Barbería, diciendo que EE.UU. tenía pleno derecho a atacar y destruir a la dirigencia terrorista sin declarar la guerra,” informó el artículo.
Tres años después, cuando el entusiasmo por la Guerra de Iraq seguía siendo fuerte en las filas conservadoras, Christopher Hitchens escribió una apología de alto perfil de Thomas Jefferson y su tratamiento de los piratas de Barbería en la revista Time. El punto de partida para Hitchens fue el carácter definitivo de Jefferson. “Considerado en conjunto con algunas otras acciones ambiciosas y casi-constitucionales de Jefferson – la Compra de Luisiana y el envío de la expedición de Lewis y Clark al Oeste – la guerra de Barbería lo expuso a algunas críticas federalistas y en los periódicos por su secretismo, su prepotencia y su estilo exageradamente ‘presidencial.’ Pero no fue posible argüir contra el éxito,” escribió en una obvia reverencia hacia el gobierno de Bush.
En su minería de la historia estadounidense, periodistas, historiadores, y activistas conservadores encontraron las pepitas que buscaban: las humillaciones de la diplomacia, la importancia de demostraciones individuales de valor (¡el thymós!), las contribuciones de un poderoso presidente, y la perfidia militante de los musulmanes. Este establecimiento de paralelos entre los talibanes y al-Qaeda por una parte y los piratas de Barbería por la otra logró varios objetivos. Primero, estableció que los propios Padres Fundadores de EE.UU. habían ido a la guerra contra terroristas islámicos, dando a la guerra global contra el terror un pedigrí indiscutible. Segundo, reveló que desde el comienzo, el apaciguamiento en la forma de diplomacia estéril y del pago a chantajistas era poco efectivo, y que sólo una enérgica reacción militar podía asegurar la victoria. Tercero, esas batallas necesitaban nuevos enfoques (guerra preventiva) y nuevas capacidades (una armada expandida, una guerra centrada en la red). Finalmente, no se trataba de un simple conflicto local sino de una guerra global entre fundamentalistas retrasados y los que defendían el vigor de la ley.
Los mismos temas reaparecieron en una más reciente vinculación de la reacción del gobierno de Obama frente los piratas somalíes con el enfoque de Jefferson ante los piratas de Barbería. Los piratas somalíes son musulmanes y vinculados a fundamentalistas, el apaciguamiento no funciona, y la guerra es la respuesta. Y los expertos utilizan a los piratas como argumento a favor de una transformación de las capacidades del Pentágono. La asociación de piratas y terroristas es tan poco probable hoy en Somalia como lo fue en la histórica malinterpretación de las guerras de Barbería.
El “descubrimiento” de los piratas de Barbería es casi demasiado bueno como para ser verdad – como si un activista contra el aborto descubriera un dictamen desapercibido de la Corte Suprema del Siglo XVII sobre la concepción como inicio de la vida. Al proyectar sus prejuicios hacia el pasado, los neoconservadores deformaron la historia para que sirviera sus intenciones. Por cierto hay paralelos entre las Guerras de Barbería y los conflictos actuales. Pero no son los paralelos aprovechados por Jewett, London, y otros.
La verdadera historia del contraterrorismo
A pesar de las interpretaciones de los neoconservadores, las guerras de Barbería no tuvieron que ver con la religión. Los Estados del Norte de África, distantes tributarios del Imperio Otomano, no eran califatos islámicos sino gobiernos seculares dirigidos por un dey y sus jenízaros turcos. Clérigos musulmanes controlaban la esfera eclesiástica pero tenían poco poder político real. Además, los ataques contra los barcos comerciales no tenían nada que ver con el yihad. Más bien, excluidos de los mercados europeos, Argel, Trípoli y Marruecos se volvieron a la piratería para sobrevivir económicamente. EE.UU., en el intertanto, no inició una guerra santa contra esos Estados. En su lugar, estaba librando la Guerra Revolucionaria a posteriori a fin de conseguir mercados abiertos para productos estadounidenses. Fue, como argumentó Thomas Paine en “Common Sense,” una clave para la supervivencia de un país recientemente independizado. Pero Gran Bretaña no dio la bienvenida al recién independizado EE.UU. en sus mercados. Peor todavía, los británicos lanzaron a los piratas de Barbería contra la navegación comercial de EE.UU. en el Mediterráneo. Lo que algunos intérpretes contemporáneos ven como una temprana confrontación entre Occidente y el Resto – un prototipo para el choque de civilizaciones – fue en realidad la continuación de una batalla entre EE.UU. y sus rivales europeos.
Sin embargo, existen algunos paralelos útiles entre entonces y ahora. Por ejemplo, los Padres Fundadores identificaron rápidamente a sus oponentes de Barbería como piratas y negreros. Pero los británicos interpretaron las incursiones realizadas por John Paul Jones durante la Guerra Revolucionaria como poco más que piratería. La piratería, como el terrorismo, depende del punto de vista del observador. En cuando a la esclavitud, EE.UU. era en esos días el centro de la trata de esclavos. La hipocresía del trato por los Estados de Barbería de un par de cientos de marineros estadounidenses – cuando los negreros estadounidenses había llevando cientos de miles de esclavos africanos – no fue percibida por la mayoría de los comentaristas de la época (con la notable excepción de Benjamin Franklin).
Se puede encontrar un paralelo más pertinente en la esfera militar. A fines del Siglo XVIII, EE.UU. carecía de fuerzas armadas que se pudieran enfrentar frente a frente con las potencias europeas, mucho menos con la flota de Barbería. Muchos Padres Fundadores consideraban que una armada permanente era una amenaza para la libertad. Era costosa y, con el fin de la Guerra Revolucionaria, no existían razones compulsivas para gastar dinero en la construcción de barcos de guerra. James Madison recomendó que EE.UU., en una temprana versión de la Seguridad Interior, se concentrara en la defensa de las líneas costeras. En 1794, sin embargo, el Congreso rechazó los argumentos de Madison y Jefferson y aprobó legislación, firmada por el presidente Washington, para la construcción de seis fragatas. Los propugnadores de la ley utilizaron a los piratas de Barbería como justificación explícita para ese fuerte aumento en los gastos militares, pero sin duda también pensaban en las flotas de Gran Bretaña y Francia.
Había, sin embargo, una cláusula interesante en la ley: “Si llegara a haber paz entre EE.UU. y la Regencia de Argel, no habrá actuaciones ulteriores bajo esta ley.” Después, EE.UU. firmó un tal tratado con Argel. Washington invocó esa cláusula en 1796 para reducir los desembolsos navales. Pero incluso entonces, cuando el complejo militar-industrial estaba en su nadir histórico, hubo preocupaciones sobre el desempleo en el sector de la defensa. De modo que, en un compromiso, la temprana república siguió adelante con la construcción de tres barcos.
La guerra que terminó por acontecer entre EE.UU. y primero Trípoli, y luego Argel, estableció muchos de los mitos fundadores de las hazañas militares de EE.UU. (las hazañas de Stephen Decatur), nuevos tipos de guerra (misiones militares secretas), y la vinculación de la intervención en el extranjero con el comercio. En otras palabras, los neoconservadores del Siglo XXI recibieron una cierta mitología prefabricada en la cual basarse. Todo lo que necesitaban era vincular a los piratas de Barbería con al-Qaeda. Eso precisaba que se convirtiera a los agentes de gobiernos seculares con limitados objetivos económicos en musulmanes terroristas con los más amplios objetivos ideológicos. De esta manera, una guerra de EE.UU. contra el terrorismo islámico adquiriría la distinción de un antiguo interés nacional.
Piratería y globalización
Cuando EE.UU. declaró la Doctrina Monroe en 1823, sólo ocho años después del fin de la Guerra Argelina, tenía el deseo, pero no la capacidad, de mantener a sus rivales europeos fuera del Caribe y de Latinoamérica. Fueron las guerras contra los Estados de Barbería – y ciertamente no la desastrosa guerra de 1812 – lo que había dado a EE.UU. la confianza necesaria para desafiar a los imperios europeos. Esos tempranos conflictos suministraron a EE.UU. la retórica y la visión de un imperio comercial cuando EE.UU. no era más que un simple páramo.
La noción de que EE.UU. pudiera mantenerse fuera de guerras y de las sucias complicaciones de la política imperial europea se acabó durante los conflictos de Barbería. El crecimiento económico de EE.UU. dependía del libre comercio, y los barcos de guerra de EE.UU. eran necesarios para mantener abiertas las líneas de navegación. Cuando Thomas Friedman escribió sobre la importancia de McDonnell Douglas para la seguridad de los restaurantes McDonald’s – el puño de hierro de los militares tras la mano invisible del mercado – heredó esa tradición de lógica imperial. Es también el espíritu que animó la visión geoeconómica de Bill Clinton de mantener el poder económico de EE.UU. mediante la conservación del poder militar de EE.UU., que he llamado en otro contexto “globalización de cañonera.”
Con la presidencia de Barack Obama, sobreviene una cierta versión resucitada del enfoque de Clinton. Se deja de lado toda el habla de imperio, en la que los adversarios son derrotados definitivamente, y viene el arte de la hegemonía, en el que aliados y adversarios de EE.UU. son persuadidos para que vean la confluencia de sus intereses y de los intereses de EE.UU. Obama sigue comprometido con unas inmensas fuerzas armadas – está redistribuyendo tropas de Iraq a Afganistán, aumentando la cantidad de soldados en 92.000 hombres, y manteniéndose “a la ofensiva” de Djibouti a Kandahar” – incluso mientras promete utilizar su pericia persuasiva con los dirigentes de Irán, Corea del Norte, y Venezuela. Obama ha prometido echar marcha atrás en algunos de los aspectos más ofensivos de la Guerra Global contra el Terror (Centro de detención de Guantánamo, la tortura) pero el marco general será mantenido bajo la designación AfPak. Mientras tanto, el nuevo presidente se concentrará en la expansión del poder económico global de EE.UU. como parte de un intento de reanimar la moribunda economía del país.
En este entorno neoliberal reanimado, al-Qaeda seguirá siendo el mismo importante “otro” que constituyeron los Estados de Barbería en el Siglo XVIII: una excusa útil para nuevos gastos militares y la proyección de la fuerza. Pero ahora se le suman otros herederos más directos del manto de Barbería: los piratas de Somalia. Esos piratas atacan la sangre vital misma de la globalización – los barcos que transportan energía y bienes por el Canal de Suez – tal como los piratas de Barbería bloqueaban la intención del temprano EE.UU. de convertirse en un protagonista económico global. Como parte de su propia transformación después de la Guerra Fría, la Armada está alejando su estrategia de la custodia de alta mar al control de las líneas costeras. Ya ha tenido una importante confrontación con China (relacionada con el USNS Impeccable). Pero ante las inversiones de China en la economía de EE.UU., los piratas representan una justificación más segura para este cambio de dirección.
Los terroristas en tierra y en el mar son útiles de otra manera. Precisamente porque no son Estados sino entidades dispersas, los piratas y los terroristas pueden servir mejor para justificar tanto una guerra global como una nueva doctrina militar. El Pentágono ha insistido en costosos, pero bastante anticuados, sistemas de armas para encarar la creciente amenaza de China: portaaviones de tecnología avanzada, inmensos destructores navales, y nuevos submarinos nucleares. Una amenaza dispersa, mientras tanto, requiere una defensa dispersa: Bases militares de EE.UU. (reconfiguradas como “hojas de nenúfar” [ciudades flotantes], tanto mejores para salirse de ellas), unidades de reacción rápida, nuevas capacidades de C4 (comando, control, comunicación y computadores). También justifica una nueva doctrina militar que subraya la rapidez por sobre la posición. Obama ha apoyado esos cambios. Permitirán al Pentágono que reaccione rápido ante amenazas a los intereses económicos de EE.UU., sean ataques paramilitares contra oleoductos en el Golfo de Guinea y Colombia, disputas territoriales que afecten rutas de navegación en el Sudeste Asiático, o piratas en los Estrechos de Malaca.
El fin de la Guerra Fría creó una crisis de misión para la OTAN. ¿Para qué era necesaria si la Unión Soviética ya no existía? Pero esa crisis de misión podía ser aplicada más generalmente al Pentágono. El celebrado segundo frente de la zona desmilitarizada de Corea perdió su propósito cuando Corea del Sur dejó de considerar a Corea del Norte como su enemiga. La amenaza china disminuyó considerablemente cuando Beijing se convirtió en el principal socio comercial de todos los países de la región. Cuba ya no representaba ningún potencial de amenaza aparte de enviar botes cargados de refugiados a la costa de Florida. Sadam Husein está muerto. Colin Powell hizo la genial declaración después de la primera Guerra del Golfo: “Se me acaban los malvados. Sólo me quedan Kim Il Sung y Castro.” Osama bin Laden llegó justo a tiempo para el gobierno de Bush. Los piratas somalíes son el último lazo salvavidas para el Pentágono.
La conservación de altos gastos militares, sea para impulsar los “duros” objetivos imperiales de los conservadores o los “suaves” objetivos económicos hegemónicos de los neoliberales, requiere a malvados de una estatura comparablemente grande. El hermano de Castro y el hijo de Kim Il Sung no bastan. Si al-Qaeda no existiera Washington tendría que crearlos. Por cierto, en su construcción de terroristas islámicos de piratas bastante corrientes, ha hecho precisamente eso.
John Feffer
Traducido por Germán Leyens, extraído de Rebelión.
00:22 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, impérialisme, piraterie, politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 mai 2009
Noltes neuer Streich

Ernst Nolte hat ein neues Buch geschrieben und erstes Presseecho erhalten. Das ist gut so und verwundert auch, denn gewöhnlich wird totgeschwiegen, was aus der Feder des im Historikerstreit medial unterlegenen Geschichtsdenkers stammt. Doch offenbar hat Ernst Nolte (dessen letzte Bücher zugegebenermaßen nichts Neues brachten) wieder einmal einen neuralgischen Punkt berührt, und nach gewissenhafter Prüfung hat man sich offenbar entschieden, ihm hier nicht unwidersprochen das Feld zu überlassen.
Es geht um den Islamismus als „dritte radikale Widerstansbewegung“ neben Bolschwismus und Faschismus. Damit verpackt Nolte den Islamismus in seine bekannte These vom kausalen Nexus zwischen den beiden Ideologien und erkennt in ihm Elemente von beiden wieder. Was Islamismus ist, erfahren wir in einer Fußnote:
Am einfachsten lässt sich der „Islamismus“ so definieren, dass er den kriegerischen und dogmatischen Aspekt des Islam, dem bereits im Koran ein friedenswilligerer und toleranterer Aspekt gegenübersteht, isoliert und dann ausschließlich hervorhebt. Insofern ist der Islamismus nichts anderes alsder zu seiner eigenen Radikalität gebrachte Islam.
Von daher stellt sich natürlich die Frage, was der Islamismus mit den anderen beiden Widerstandsbewegungen zu tun hat, die eine völlig andere Entstehungs- und Entfaltungsgeschichte haben. Nolte faßt daher am Anfang des Buches seine Charakterisierung des Marxismus und Nationalsozialismus zusammen und sieht in beiden „konservative Revolutionen“, die ein ursprüngliches Lebensverhältnis vor der Moderne retten und wiederherstellen wollten. Im Anschluß daran erzählt Nolte die Geschichte der Konfrontation des Islam mit der modernen Welt, beginnend mit der Landung Napoleons in Ägypten, über den Zionismus als entscheidende Herausforderung und endend mit dem Islamismus als Macht im gegenwärtigen Weltkonflikt.
In den oben erwähnten Rezensionen wird deutlich, daß Nolte mit seiner These zumindest Widerspruch provoziert. An der Begründung dieses Widerspruchs kann man ablesen, daß er mit seinen Überlegungen nicht daneben liegt. Hinzu kommt das Pathos des Verstehenwollens, das Nolte auszeichnet und das auf den Zeitgeist immer verstörend wirkt. Dem Journalisten(Jörg Lau in Die Zeit) bleibt nur die Empörung:
Nolte hält nicht etwa nur den Widerstand der Palästinenser gegen Vertreibung und Besatzung für legitim. Es kommt ihm vielmehr darauf an, den arabischen Antisemitismus zu verteidigen, den die extremsten Teile der islamistischen Bewegungen kultivieren.
Das ist der übliche Reflex. Nolte verteidigt hier gar nichts, er wagt nur eine gerechte Betrachtung einzufordern, die Ursachen und Auslöser benennt und so ein Verstehen auch des Islamismus möglich machen kann.
In eine ähnliche Richtung geht die Kritik des „Fachmanns“ Walter Laqueur in der Welt, der Nolte sowohl vorwirft, keine Ahnnung zu haben, als auch, nichts Neues zu schreiben. Das sieht Josef Schmid in seiner positiven Besprechung für das Deutschlandradio ganz anders:
Nolte präsentiert Zeitwissen und Verknüpfungen, die allein schon die Lektüre unerläßlich machen. Darüber hinaus eröffnet dieses Werk eine Sicht auf das noch bevorstehende 21. Jahrhundert. […] Ernst Nolte erwartet weniger einen Kampf der Kulturen, dafür aber einen Kampf konkurrierender Lebens- und Daseinsformen, des Islams wie der europäischen Moderne, um ihren universellen Geltungsanspruch. Er sieht ihn in einer Dimension, auf die wir nicht vorbereitet sind.
Nolte wird in vielen Abschnitten seinem Anspruch gerecht, ein Geschichtsdenker zu sein, also einer, der über den ganzen Einzelheiten und Handgreiflichkeiten die Idee sieht, wenn er einen Vorgang in den Zusammenhang stellt. Von dort aus lassen sich auch neue Einsichten über den europäischen Bürgerkrieg gewinnen, etwa wenn er die Revolution der Jungtürken 1908/1913
die erste jener handstreichartigen Machtübernahmen seitens einer Gruppe oder Partei sehr engagierter junger Männer [sieht], welche die Verhältnisse für unerträglich hielten und oftmals von dem Gefühl des Unrechts geleitet waren, das ihnen und Menschen ihrer Herkunft oder ihrer Lage in diesen Verhältnissen angetan wurde.
Nolte sieht in der Existenz Israels, des modernen Vorpostens in der arabischen Welt, den entscheidenden Grund für die „Verteidigungsaggressivität“ des Islam. Die eigenen Mängel werden nicht mit einer fehlenden Modernität erklärt, sondern als Folge eines Abfalls von der „reinen Lehre“. Dieses Moment läßt sich in allen drei Widerstandbewegungen auffinden. Nolte stellt uns damit einen Schlüssel zur Verfügung, der auch die Hintergründe der eigenen Sehnsucht nach Authentizität und Ursprünglichkeit aufschließen hilft. Es ist die Sehnsucht nach der heilen Welt, die hinter der Subjekt-Objekt-Spaltung liegt, die Zeit als sich „alle nach einer Mitte neigten“ (Gottfried Benn). Die Unerfüllbarkeit dieser Hoffnung ist zumindest tröstlich: Auch der Islamismus wird scheitern. Die Frage nach dem Zeitpunkt sollte für uns Ansporn sein, die Hände nicht in den Schoß zu legen.
Ernst Nolte: Die dritte radikale Widerstandsbewegung: Der Islamismus, Berlin: Landtverlag 2009, 412 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 39.90 Euro. Zu beziehen bei Edition Antaios.
00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, islamisme, islam, théorie politique, sciences politiques, histoire, politologie, politique, multiculturalisme, dialogue des civilisations |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 mai 2009
Le profezie di Tocqueville
Le profezie di Tocqueville
 Così Alexis Henri Charles Clérel de Tocqueville (in foto) scriveva nel 1840 nella sua celeberrima Democrazia in America. Nella sua riflessione politica il saggista francese metteva seriamente in discussione il diritto della maggioranza a governare, determinato inevitabilmente dalla natura stessa del principio democratico. Egli rilevava con amarezza come l’attribuire la sovranità alla volontà caotica e dubbiosa delle masse fosse equivalente all’investire del potere decisionale un’entità incapace in molti casi di esercitare anche solo il potere di opinione. Questa prassi negativa determinava a suo dire una cronica instabilità, la quale favoriva l’insorgere di poteri campanilistici e di interessi politici di nicchia, spesso e volentieri tirannici o settari, e in ogni caso alimentati dalla brama per il benessere, il desiderio di potere personale e il conformismo. E infatti, proprio sulla base di queste convinzioni, l’autore si permetteva di affermare:
Così Alexis Henri Charles Clérel de Tocqueville (in foto) scriveva nel 1840 nella sua celeberrima Democrazia in America. Nella sua riflessione politica il saggista francese metteva seriamente in discussione il diritto della maggioranza a governare, determinato inevitabilmente dalla natura stessa del principio democratico. Egli rilevava con amarezza come l’attribuire la sovranità alla volontà caotica e dubbiosa delle masse fosse equivalente all’investire del potere decisionale un’entità incapace in molti casi di esercitare anche solo il potere di opinione. Questa prassi negativa determinava a suo dire una cronica instabilità, la quale favoriva l’insorgere di poteri campanilistici e di interessi politici di nicchia, spesso e volentieri tirannici o settari, e in ogni caso alimentati dalla brama per il benessere, il desiderio di potere personale e il conformismo. E infatti, proprio sulla base di queste convinzioni, l’autore si permetteva di affermare:«Se cerco di immaginare il dispotismo moderno, vedo una folla smisurata di esseri simili ed eguali che volteggiano su se stessi per procurarsi piccoli e meschini piaceri di cui si pasce la loro anima».
Eppure i padri costituenti, all’indomani della rivoluzione, temevano l’utilizzo stesso della parola “democrazia”, considerata di sapore giacobino (quando non sovversivo). Personaggi come Hamilton e Adams appartenevano a quella corrente, inizialmente di gran lunga maggioritaria, che identificava negli ideali del governo elitario il modello funzionale alla nascente repubblica, e rigettavano la partitocrazia come un sistema nel quale «l’egoistico interesse viene eretto innanzi alle folle come fosse un pilastro della società» . Il modello politico che conseguiva da queste convinzioni era basato su un diritto di voto limitatissimo, includente meno del 2% dei cittadini. Quel numero esiguo di elettori (poco più di trentamila su tre milioni di abitanti) identificati per criterio di censo, avrebbe rappresentato nell’idea della classe dirigente rivoluzionaria quel bacino di uomini “illuminati” capaci di prendersi cura dell’intera nazione in nome del popolo.
 All’epoca in cui Tocqueville scrisse il suo saggio, gli Stati Uniti esistevano ormai da più di sessant’anni, e le istituzioni politiche avevano perso il carattere elitario voluto dai padri fondatori. Un sistema partitocratico fortemente radicato e legato ai maggiori cartelli finanziari del paese basava la propria sopravvivenza proprio sulla difesa degli interessi di classe. Un vasto popolo di elettori, legittimati dal principio di sovranità del quale erano investiti, si autoesaltava nella celebrazione del principio democratico, mentre le brigate di cavalleria del generale Jackson portavano i nativi ad un passo dall’estinzione. Sull’argomento Tocqueville si esprimeva in questo modo:
All’epoca in cui Tocqueville scrisse il suo saggio, gli Stati Uniti esistevano ormai da più di sessant’anni, e le istituzioni politiche avevano perso il carattere elitario voluto dai padri fondatori. Un sistema partitocratico fortemente radicato e legato ai maggiori cartelli finanziari del paese basava la propria sopravvivenza proprio sulla difesa degli interessi di classe. Un vasto popolo di elettori, legittimati dal principio di sovranità del quale erano investiti, si autoesaltava nella celebrazione del principio democratico, mentre le brigate di cavalleria del generale Jackson portavano i nativi ad un passo dall’estinzione. Sull’argomento Tocqueville si esprimeva in questo modo:«Gli spagnoli, con mostruosità senza precedenti, coprendosi di onta incancellabile, non sono giunti a sterminare la razza indiana e nemmeno a condividere i loro stessi diritti [...] Gli americani [...] hanno invece raggiunto questo doppio risultato con meravigliosa facilità, tranquillamente, legalmente e filantropicamente [...] mai nessuna più grande atrocità fu compiuta, e quel che è peggio, essa è il prodotto di uno Stato che si celebra come l’Impero della Libertà».
Vi è un’incontestabile verità da rilevare nella riflessione di Tocqueville: i giudizi sugli esiti dell’applicazione del sistema democratico nella sua interpretazione moderna sfiorano il limite della profezia. Non è un caso che l’ordine sociale in vigore presso i paesi che dalla democrazia americana sono più o meno indirettamente influenzati si basi proprio su antivalori quali il consumismo, l’egoismo ed il conformismo, camuffati dietro ad espressioni come “cultura del libero mercato”, “centralità della classe media” o “moderazione politica”. L’Occidente contemporaneo non soltanto ha realizzato le paure del pensatore francese, ma le ha radicalizzate, giungendo a farne veri e propri pilastri del suo modus vivendi.
Mettiamo a fuoco la realtà statunitense, autoreferenziale al punto da considerarsi “matrice” esportabile a qualsiasi latitudine.
LE ELEZIONI PRESIDENZIALI
 Le elezioni presidenziali negli USA si basano su un principio che vanta origini antichissime, essendo stato teorizzato dai padri costituenti nel 1787. Secondo tale principio la carica presidenziale non si conquista con la maggioranza popolare, ma con quella dei componenti di uno specifico Collegio Elettorale, composto da 538 “Grandi Elettori” che vengono assegnati Stato per Stato al candidato che vi prevale, anche per un solo voto. Questa caratteristica distorce non poco il principio della sovranità popolare, e ancor di più quello della proporzionalità del potere politico dei cittadini: infatti il sistema di assegnazione dei Grandi Elettori è sbilanciato a favore dei piccoli Stati, nel rispetto di un “compromesso storico” (uno dei tanti che tiene in piedi il fragile sistema politico statunitense) sottoscritto alla fine del ‘700 per rassicurare gli Stati minori di fronte al rischio di una “tirannia dei partners più grandi”. Si verifica così che realtà elettorali ristrette come il piccolo Wyoming posseggano un grande elettore ogni 170.000 abitanti, mentre circoscrizioni più consistenti come quella del Texas ne posseggano uno ogni settecentomila residenti.
Le elezioni presidenziali negli USA si basano su un principio che vanta origini antichissime, essendo stato teorizzato dai padri costituenti nel 1787. Secondo tale principio la carica presidenziale non si conquista con la maggioranza popolare, ma con quella dei componenti di uno specifico Collegio Elettorale, composto da 538 “Grandi Elettori” che vengono assegnati Stato per Stato al candidato che vi prevale, anche per un solo voto. Questa caratteristica distorce non poco il principio della sovranità popolare, e ancor di più quello della proporzionalità del potere politico dei cittadini: infatti il sistema di assegnazione dei Grandi Elettori è sbilanciato a favore dei piccoli Stati, nel rispetto di un “compromesso storico” (uno dei tanti che tiene in piedi il fragile sistema politico statunitense) sottoscritto alla fine del ‘700 per rassicurare gli Stati minori di fronte al rischio di una “tirannia dei partners più grandi”. Si verifica così che realtà elettorali ristrette come il piccolo Wyoming posseggano un grande elettore ogni 170.000 abitanti, mentre circoscrizioni più consistenti come quella del Texas ne posseggano uno ogni settecentomila residenti.La conseguenza strategica di questa prassi è che i candidati alla presidenza circoscrivono la loro azione a determinati “bacini elettorali”, lasciando da parte interi Stati (considerati già acquisiti dall’una o dall’altra parte) o addirittura ignorandoli perché poco incisivi. Ad esempio, nelle elezioni presidenziali del 2004 soltanto in 20 Stati (corrispondenti al 37% della popolazione) furono organizzate campagne elettorali impegnative, lasciando fuori dai giochi le tre circoscrizioni più popolose del paese: California e New York (roccaforti democratiche) e Texas (bacino repubblicano d’eccellenza). È inevitabile quindi che la stragrande maggioranza della popolazione si consideri semplicemente “fuori dai giochi” ed eviti di recarsi a votare, come dimostrano le statistiche riguardanti l’affluenza alle urne (linea gialla):
I dati mostrano chiaramente come nella maggior parte dei casi la partecipazione elettorale superi di poco la metà degli aventi diritto. A conferma della prassi di ignorare gli Stati più popolosi perché relativamente sicuri o ininfluenti ci sono le percentuali di voto di New York (dove usualmente si reca a votare meno della metà degli aventi diritto) e del Nevada (dove la media scende al 40%) nonché le statistiche generali sui votanti (che nel 2008 sono stati 132 milioni su un totale di 212 aventi diritto). A questi dati ne aggiungiamo un altro, fondamentale: lo status sociale dei votanti è in maggioranza individuabile nel ceto medio-alto.
Percentuali di questo tipo vengono interpretate da sedicenti analisti come sintomo di una raggiunta “maturità politica” del popolo americano.
 La realtà è ben diversa: la storia delle elezioni presidenziali ci dimostra come il sistema elettorale sopra descritto serva alla classe politica per mettersi al riparo dall’emergere di “terze posizioni” meno legate agli interessi dei potentati economici che sostengono i due partiti principali (Partito Repubblicano e Partito Democratico). L’attribuzione delle prerogative politiche al di fuori di ogni parametro proporzionale garantisce alle forze “moderate” il monopolio della politica, scoraggiando di fatto la nascita e la proliferazione di organizzazioni che possano minare il “bipolarismo perfetto”, e che quindi potrebbero mettere in discussione le basi liberalcapitaliste del sistema. Serve una prova? Negli ultimi decenni dell’800 due formazioni politiche di estrazione non borghese, il Partito Populista (radicato nell’Ovest agricolo ed espressione del ceto contadino) ed il movimento dei “Mugwumps” (alimentato dalle élites aristocratiche meridionali) tentarono di scalzare il predominio dei “moderati”. Nonostante la percentuale di consenso nei confronti di queste organizzazioni raggiungesse in certi casi il 10% (corrispondente a parecchi milioni di voti) sia i Populisti che i Mugwumps non riuscirono mai ad ottenere più di qualche seggio alla Camera dei Rappresentanti, e non riuscirono mai ad avere una presenza stabile al Senato.
La realtà è ben diversa: la storia delle elezioni presidenziali ci dimostra come il sistema elettorale sopra descritto serva alla classe politica per mettersi al riparo dall’emergere di “terze posizioni” meno legate agli interessi dei potentati economici che sostengono i due partiti principali (Partito Repubblicano e Partito Democratico). L’attribuzione delle prerogative politiche al di fuori di ogni parametro proporzionale garantisce alle forze “moderate” il monopolio della politica, scoraggiando di fatto la nascita e la proliferazione di organizzazioni che possano minare il “bipolarismo perfetto”, e che quindi potrebbero mettere in discussione le basi liberalcapitaliste del sistema. Serve una prova? Negli ultimi decenni dell’800 due formazioni politiche di estrazione non borghese, il Partito Populista (radicato nell’Ovest agricolo ed espressione del ceto contadino) ed il movimento dei “Mugwumps” (alimentato dalle élites aristocratiche meridionali) tentarono di scalzare il predominio dei “moderati”. Nonostante la percentuale di consenso nei confronti di queste organizzazioni raggiungesse in certi casi il 10% (corrispondente a parecchi milioni di voti) sia i Populisti che i Mugwumps non riuscirono mai ad ottenere più di qualche seggio alla Camera dei Rappresentanti, e non riuscirono mai ad avere una presenza stabile al Senato.Lo stesso sistema elettorale garantisce al duopolio PD-PR il controllo stabile dei loro “territori”, stabilisce entro quali limiti debba svolgersi il confronto fra i due gruppi di potere e preserva l’egemonia moderata da pericolose derive politiche alternative.
In sostanza: due gruppi di potere, sostenuti dai poteri forti dello Stato, dell’economia e della finanza, mantengono l’iniziativa politica escludendo qualsiasi istanza di rinnovamento, appoggiandosi alla classe media (tendenzialmente conservatrice anche quando vota democratico) ed avvalendosi di una legge elettorale che scoraggia il pluralismo reale.
 A questo punto non è difficile capire che il popolo americano è tutt’altro che politicamente maturo: ingabbiato in un sistema rigidamente bipolare, esso soffre una cronica crisi di sfiducia verso la classe politica, e si è ormai rassegnato ad una sorta di “pensiero unico” imperante, garantito dall’influenza finanziaria dei suoi fautori e tutelato dall’ordinamento sociale vigente. Immaginiamoci di essere un elettore repubblicano dello Stato di New York: che ci andiamo a fare in cabina elettorale se sappiamo che nella nostra circoscrizione la maggioranza si esprimerà a favore del candidato democratico, e che a prescindere dalla percentuale che otterrà il fronte che cerchiamo di contrastare si prenderà tutto, annullando comunque la nostra rilevanza politica? Tanto vale che ce ne stiamo a casa!
A questo punto non è difficile capire che il popolo americano è tutt’altro che politicamente maturo: ingabbiato in un sistema rigidamente bipolare, esso soffre una cronica crisi di sfiducia verso la classe politica, e si è ormai rassegnato ad una sorta di “pensiero unico” imperante, garantito dall’influenza finanziaria dei suoi fautori e tutelato dall’ordinamento sociale vigente. Immaginiamoci di essere un elettore repubblicano dello Stato di New York: che ci andiamo a fare in cabina elettorale se sappiamo che nella nostra circoscrizione la maggioranza si esprimerà a favore del candidato democratico, e che a prescindere dalla percentuale che otterrà il fronte che cerchiamo di contrastare si prenderà tutto, annullando comunque la nostra rilevanza politica? Tanto vale che ce ne stiamo a casa!Se estendiamo questo ragionamento ad una buona metà dei cittadini statunitensi, riesce piuttosto facile capire come mai circa cento milioni di americani neanche si preoccupano di iscriversi alle liste elettorali.
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, 19ème siècle, france, etats-unis, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 mai 2009
Democrazia come partecipazione: Moeller van den Bruck
Democrazia come partecipazione: Moeller van den Bruck
«La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino»
 Si fa presto a dire “democrazia”. Termine che mette effettivamente i brividi, a chi abbia un po’ di esperienza circa il modus operandi dei “democratici” d’Italia e del mondo. Ma si può essere sostenitori della democrazia nonostante i democratici? Può una democrazia essere organica, comunitaria, nazionale, antiliberale e antioligarchica? In un’epoca di tecnocrazia e grandi potentati transnazionali che espropriano i popoli di ogni brandello di sovranità può la partecipazione essere la bandiera di una politica non conforme? Arthur Moeller van den Bruck (1876 – 1925, in foto) avrebbe risposto in modo affermativo a tutte queste domande. Ma andiamo con ordine. Chi era, innanzitutto, l’autore che porta un nome tanto imponente e ridondante?
Si fa presto a dire “democrazia”. Termine che mette effettivamente i brividi, a chi abbia un po’ di esperienza circa il modus operandi dei “democratici” d’Italia e del mondo. Ma si può essere sostenitori della democrazia nonostante i democratici? Può una democrazia essere organica, comunitaria, nazionale, antiliberale e antioligarchica? In un’epoca di tecnocrazia e grandi potentati transnazionali che espropriano i popoli di ogni brandello di sovranità può la partecipazione essere la bandiera di una politica non conforme? Arthur Moeller van den Bruck (1876 – 1925, in foto) avrebbe risposto in modo affermativo a tutte queste domande. Ma andiamo con ordine. Chi era, innanzitutto, l’autore che porta un nome tanto imponente e ridondante?Nato il 23 aprile 1876 a Solingen, Moeller è considerato uno dei padri nobili e degli spiriti animatori della vasta corrente di pensiero conosciuta come “Rivoluzione conservatrice”. Chiamato Arthur dal padre in onore di Schopenhauer, il futuro cantore dei “popoli giovani” comincia, nelle sue prime uscite pubbliche, ad affiancare al cognome paterno anche quello – di origine olandese – della madre: Elise van den Bruck. Si forma su Nietzsche, Dostoewskij, Langbehn, Chamberlain e Gobineau. Nella giovinezza un po’ bohémien fa la conoscenza di Rudolf Steiner, August Strindberg, del pittore völkisch Fidus, Edvard Munch, Dimitri Merezkowskij, Theodor Däubler ed Ernst Barlach. Dal 1904 al 1910 scrive l’opera enciclopedica Die Deutschen (I Tedeschi) un ritratto dei maggiori geni della cultura tedesca, mentre nel 1906 inizia la traduzione delle opere complete di Dostoewskij. Nel 1913 pubblica Die italienische Schönheit (La bellezza italiana). Nel 1914 parte volontario. Nel 1916 pubblica Der prussische Stil (Lo stile prussiano) e, dopo la disfatta, nel giugno 1919 lo troviamo tra i fondatori dello Juniklub, comunità nazionalconservatrice di Berlino, e di Gewissen, importante rivista nazionalista. Del 1919 è il suo saggio politico Das Recht der jungen Völker (Il diritto dei popoli giovani). Nel 1923 pubblica invece il suo libro più celebre, Das dritte Reich (Il terzo Reich, traduzione italiana di Luciano Arcella, Settimo Sigillo, Roma 2000). Nel 1925 si suicida a Berlino.
 Nel suo saggio più celebre, che porta un titolo oggi piuttosto impegnativo come Il terzo Reich (ma ricordiamo che il testo uscì 10 anni prima dell’ascesa al potere del nazionalsocialismo e che l’autore si tolse la vita otto anni prima che Hitler divenisse cancelliere), Moeller traccia una originale visione politica basata su alcune istantanee fissate in modo vivido e caustico. Il libro è in effetti composto da diversi capitoli, ognuno dei quali prende le mosse da un termine del lessico politico e da una breve frase introduttiva. Das dritte Reich, per fare un esempio, si apre con il capitolo intitolato “Rivoluzionario – Vogliamo vincere la rivoluzione”, seguito da “Socialista – Ogni popolo ha il suo socialismo”. E così via. Ora, il quarto capitolo del saggio è dedicato esattamente alla democrazia ed ha per titolo: “Democratico – La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino”. Frase già di per sé rivelatrice, non c’è che dire. Come nel resto del libro, Moeller prende le mosse dalla situazione concreta della Repubblica di Weimar, per poi passare a considerazioni di tipo più generale. Leggiamo quindi l’inquadramento generale del problema in questi termini: «La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino. Ed il destino del popolo, dovremmo dire, è pertinenza del popolo. La domanda è sempre la stessa: come è realizzabile una effettiva partecipazione?». Con il Parlamento, risponderebbe il liberale. Moeller la pensa diversamente. Per lui il Reichstag è «la struttura incaricata della diffusione delle frasi fatte». Il problema, per il teorico della konservative Revolution, non sono tuttavia le istituzioni, ma lo spirito che le anima. La democrazia, scrive Moeller, esiste da prima del Parlamento. Essa era anzi intrinseca nella mentalità degli stessi antichi Germani. «Fra i neoconservatori – spiega Alain de Benoist– la nozione di Reich non è a priori antagonistica nei confronti della democrazia. Di fronte a questo tipo di regime, i membri dello Juniklub non professano, d’altronde, alcuna ostilità di principio. Cercano piuttosto di creare una “democrazia tedesca” – così come si pronunziano per un “socialismo tedesco”. È un atteggiamento, molto caratteristico in loro, mirante a “nazionalizzare” una dottrina piuttosto che non a respingerla».
Nel suo saggio più celebre, che porta un titolo oggi piuttosto impegnativo come Il terzo Reich (ma ricordiamo che il testo uscì 10 anni prima dell’ascesa al potere del nazionalsocialismo e che l’autore si tolse la vita otto anni prima che Hitler divenisse cancelliere), Moeller traccia una originale visione politica basata su alcune istantanee fissate in modo vivido e caustico. Il libro è in effetti composto da diversi capitoli, ognuno dei quali prende le mosse da un termine del lessico politico e da una breve frase introduttiva. Das dritte Reich, per fare un esempio, si apre con il capitolo intitolato “Rivoluzionario – Vogliamo vincere la rivoluzione”, seguito da “Socialista – Ogni popolo ha il suo socialismo”. E così via. Ora, il quarto capitolo del saggio è dedicato esattamente alla democrazia ed ha per titolo: “Democratico – La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino”. Frase già di per sé rivelatrice, non c’è che dire. Come nel resto del libro, Moeller prende le mosse dalla situazione concreta della Repubblica di Weimar, per poi passare a considerazioni di tipo più generale. Leggiamo quindi l’inquadramento generale del problema in questi termini: «La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino. Ed il destino del popolo, dovremmo dire, è pertinenza del popolo. La domanda è sempre la stessa: come è realizzabile una effettiva partecipazione?». Con il Parlamento, risponderebbe il liberale. Moeller la pensa diversamente. Per lui il Reichstag è «la struttura incaricata della diffusione delle frasi fatte». Il problema, per il teorico della konservative Revolution, non sono tuttavia le istituzioni, ma lo spirito che le anima. La democrazia, scrive Moeller, esiste da prima del Parlamento. Essa era anzi intrinseca nella mentalità degli stessi antichi Germani. «Fra i neoconservatori – spiega Alain de Benoist– la nozione di Reich non è a priori antagonistica nei confronti della democrazia. Di fronte a questo tipo di regime, i membri dello Juniklub non professano, d’altronde, alcuna ostilità di principio. Cercano piuttosto di creare una “democrazia tedesca” – così come si pronunziano per un “socialismo tedesco”. È un atteggiamento, molto caratteristico in loro, mirante a “nazionalizzare” una dottrina piuttosto che non a respingerla». Esiste una democrazia tutta tedesca, quindi, che non ha a che fare con il parlamentarismo. Quest’ultimo «in Germania non ha nessuna tradizione», e la Germania stessa «è un paese troppo nobile per il parlamentarismo». In questo quadro, «la volontà di democrazia è volontà di autocoscienza politica di un popolo: essa è la sua autoaffermazione nazionale. La democrazia è l’espressione dell’autostima di un popolo, oppure non è nulla».
Esiste una democrazia tutta tedesca, quindi, che non ha a che fare con il parlamentarismo. Quest’ultimo «in Germania non ha nessuna tradizione», e la Germania stessa «è un paese troppo nobile per il parlamentarismo». In questo quadro, «la volontà di democrazia è volontà di autocoscienza politica di un popolo: essa è la sua autoaffermazione nazionale. La democrazia è l’espressione dell’autostima di un popolo, oppure non è nulla».In concreto, «si potrebbe immaginare in Germania una democrazia che si prenda cura soprattutto della vita del popolo, che sia in grado di radicare la repubblica nella specificità del paese, nella differenza delle componenti etniche e nell’armonia generale del popolo. Non la forma dello Stato, ma lo spirito dei cittadini realizza la democrazia. La sua base è il senso del popolo […]. Se vogliamo salvare la democrazia tedesca dobbiamo rivolgerci lì dove l’elemento umano e l’elemento tedesco non sono stati contaminati: al popolo stesso, al carattere originario di questo popolo, che può sussistere anche in questo Stato. E potremmo forse dire che vi sarà vera democrazia in Germania solo quando non vi saranno più “democratici”. Vi sono popoli che si sono sollevati mediante la democrazia. Vi sono altri popoli che sono andati in rovina con la democrazia. La democrazia può significare stoicismo, concezione repubblicana, inflessibilità, durezza. Ma allo stesso tempo può significare liberalismo, chiasso parlamentare, lassismo».
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, années 20, démocratie, participation, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 mai 2009
Giano Accame o dell'amicizia antieconomicista

.
.
Giano si proponeva se non di abbatterlo almeno di aprire qualche breccia, qui in Italia, grazie alle idee controcorrente di un pugno di refrattari al capitale finanziario, come si e ci definì il compianto professor Arduino Agnelli, presente tra gli invitati lì riuniti, grazie alle grandi capacità organizzative di Giuliano Borghi e ai mezzi messi a disposizione dal compianto Ivo Laghi, quale direttore all’epoca di “Pagine Libere”, autentico fiore all’occhiello della Cisnal.
Il muro però oggi è ancora lì. E noi pure, magari con qualche triste assenza legata alle inesorabili leggi della grande catena dell’Essere. Ma sempre con le spade dell’intelligenza sguainate. E con Giano al comando, pronti all’ultima carica, contro i carri armati di Wall Street… Costi quel che costi.
Non poteva perciò non nascere tra noi, già in quegli anni, un grande feeling intellettuale. Poi trasformatosi nel tempo in amicizia.
Su quali basi però? Ovviamente quelle di un rigoroso e affratellante antieconomicismo. E sicuramente ricambiato, nei nostri riguardi, dall’economia stessa. E in particolare dal denaro, che ci ha sempre “guardato”, diciamo così, con analoga antipatia.
Per entrare nel merito: in Giano, l’antieconomicismo passa attraverso il fuoco di una cultura trans-fascista, incarnatasi storicamente nella gigantesca e sempre attuale battaglia del sangue contro l’oro. Mentre nel sottoscritto l’antieconomicismo origina da una formazione di tipo sociologico, meno politicizzata o infuocata, che però designa nello studio dei fenomeni sociali le chiavi ideali per penetrare e cambiare, secondo i valori di sempre, la Città dei Moderni. Troppo sbilanciata sul piano dell’agire economico orientato al profitto, fino a sconfinare nella pirateria borsistica, oggi ancora ben insediata dietro il Muro di Wall Street.
Diciamo subito che anni di conversazioni fitte fitte, avvenute nel suo studio così affollato di libri, quadri, gatti, cani e idee antieconomiciste, hanno contribuito ad allargare i miei orizzonti. Fino al punto di riuscire a capire che l’economia non è solo sociologia, ma anche poesia e letteratura. E soprattutto politica, come capacità di immergersi con la passione dell’intellettuale “armato” (delle sue sole idee, ovviamente), anche nella trivialità, pur necessaria, della comprensione del divenire storico ed economico. Per riaffiorarne con nuove certezze sulla natura a tutto tondo dell’ uomo reale: che non è economico e ragionatore, ma antieconomico e sragionatore. E dunque capace di sacrificarsi “poeticamente”, immolandosi magari in guerra, per un’ idea come quella di patria. O semplicemente per fedeltà alle scelte fatte. E non importa se perdenti. Scegliendo così la via del più ruggente idealismo politico.
Ma devo a Giano anche numerosi suggerimenti di lettura, poi magari concretizzatisi in comuni collaborazioni. Penso al Mazzini, al Carli e al Michels, pubblicati nella collana “Contra” di Settimo Settimo Sigillo da me diretta. E da ultimo, al mio libro su Del Noce, che si avvale di un’intensa prefazione proprio di Giano. Dove, tra l’altro, ho messo a frutto alcune sue preziose notazioni esistenziali sul filosofo cattolico. Ma penso anche ai convegni, alle presentazioni di libri, alle riunioni editoriali e di redazione. Sarebbe veramente lungo fare la lista, per autori, delle suggestioni legate alla sua frequentazione e amicizia.
Un legame fatto anche di momenti ludici. E perciò di vivaci incontri conviviali, con altri valorosi quanto, alla bisogna, faceti amici. Segnati da bicchierate, squisiti manicaretti, e, a fine pasto, da esplosivi “Sgroppini”: una miscela di vodka, gelato al limone e una lacrima di spumantino. Se ci si passa l’espressione un po’ volgare: uno sturalavandini… Al quale Giano, insieme alla poesia e alla letteratura antieconomicista di Pound e di Marinetti, mi ha iniziato… Con mio grande gaudio. E ne sanno qualcosa Enzo Cipriano, il nostro grande e incosciente editore, sempre presente al rito dello Sgroppino. E il bravissimo ristoratore Michele, proprietario della “Piccola Irpinia”, nostro anfitrione romano e sapiente somministratore di “Sgroppini”…
Anche in queste occasioni conviviali, Giano non manca di suggerimenti e stimoli. La convivialità, insomma, nel senso del “vivere con” le emozioni, non solo della cultura, raggiunge il suo livello più intenso proprio durante le nostre cene. Vita e intelletto finiscono così per congiungersi felicemente.
Ecco, questa prodigalità di consigli e suggerimenti; questo donare, così candidamente se stesso, con naturalezza, senza mai far pesare la propria cultura, è tipico di quello che mi piace definire l’antieconomicismo esistenziale di Giano. Che spesso si nota nella sua pagina anche giornalistica, sempre colta, nitida, ma ricca di liberi spunti e stimoli donati al lettore, arricchendolo; si parla al mondo ma senza prevaricare. Con eleganza di cuore.
Il punto è che Giano, pur nella fermezza delle sue idee, è ancora oggi capace di ascoltare il mondo, dando così vita a una specie di circuito del dono intellettuale, tra chi legge e chi scrive. Anche se di sponde opposte. Come del resto dimostra l’attenzione che Giano ha ricevuto in ambienti lontani dalla destra. Il che deve rappresentare una lezione di vita per tutti noi, giovani e meno giovani. Quale lezione? Come essere realmente artigiani delle idee, nel senso più nobile del termine, andando al di là degli steccati politici post-1789. Pur conservando un ideale rispetto per quei “maggiori” di destra o sinistra, dai quali alcuni di noi discendono per precedenti scelte politiche.
E in questo senso mi piace parlare dell’amico Giano come di un mio “Maggiore”: vero maestro di studi, di giornalismo e di vita.
Auguri Grande Giano per i tuoi ottant’anni. Donati bene a quel mondo variegato e ribelle di spiriti liberi che ti ama intellettualmente e che non sarà mai pago di ascoltarti.
Un abbraccio affettuoso dal tuo Carlo.
.
00:15 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, sociaologie, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 mai 2009
Tocqueville contre le nihilisme moderne
Tocqueville contre le nihilisme moderne
par Pierre Le Vigan - http://europemaxima.com/
On sait que Benjamin Constant distinguait dans un célèbre discours de 1819 la liberté des Anciens et la liberté des Modernes. La première réside dans la participation aux affaires publiques, la seconde dans la garantie des jouissances privées. Dans la première, il y a selon Constant « asservissement de l’existence individuelle au corps collectif ». C’est pourquoi il défend la seconde conception de la liberté, celle des Modernes. En un sens, la conception de Benjamin Constant a fondé un certain libéralisme. Il est toutefois patent qu’une autre grande figure libérale, ou plutôt peut-être devrait-on dire conservatrice, a souligné que la liberté des Modernes ne suffisait pas. Cette figure c’est Tocqueville. Il est constant que pour Tocqueville la liberté des Modernes même corrigée par la morale chrétienne ne suffit pas. « Les devoirs des hommes entre eux en tant que citoyens, les obligations des citoyens envers la patrie me paraissent mal définis et assez négligés dans la morale du christianisme. C’est là, ce me semble, le coté faible de cette admirable morale de même que le seul coté vraiment fort de la morale antique. » note Tocqueville (Lettre à Arthur de Gobineau, 5 septembre 1848).
Si la morale civique tend à disparaître c’est encore pour une raison que Tocqueville a parfaitement analysée. C’est du fait de la montée de l’individualisme. L’égalité de principe des hommes « abolit le prestige des noms pour lui substituer la force du nombre » note Finkielkraut. En conséquence se développe l’esprit moutonnier et le conformisme de masse dont nous voyons aujourd’hui les effets poussés à l’extrême. Plus les hommes sont égaux en principe plus se manifeste l’envie, la recherche du bien-être, l’hédonisme. Le régime des désirs tend à être la loi de l’économie. Ce « chacun pour soi » et ce désinvestissement de l’engagement civique et politique donne au despotisme toutes les chances de s’imposer. Il aggrave alors l’individualisme. « Il retire aux citoyens toute passion commune, tout besoin mutuel, toute nécessité de s’entendre, toute occasion d’agir ensemble ; il les mure, pour ainsi dire, dans la vie privée […]. La liberté seule, au contraire, peut combattre efficacement dans ces sortes de sociétés les vices qui leur sont naturels et les retenir sur la pente où elles glissent. Il n’y a qu’elle en effet qui puisse retirer les citoyens de l’isolement dans lequel l’indépendance même de leur condition les fait vivre, pour les contraindre à se rapprocher les uns des autres, qui les réchauffe et les réunisse chaque jour par la nécessité de s’entendre, de se persuader, et de complaire mutuellement dans la pratique d’affaires communes. Seule elle est capable de les arracher au culte de l’argent et aux petits tracas journaliers de leurs affaires particulières pour leur faire apercevoir et sentir à tout moment la patrie au-dessus et à côté d’eux ; seule elle substitue de temps à autre à l’amour du bien-être des passions plus énergiques et plus hautes, fournit à l’ambition des objets plus grands que l’acquisition des richesses, et crée la lumière qui permet de voir et de juger les vices et les vertus des hommes. » (L’Ancien régime et la Révolution).
Si chacun ne se saisit pas de la liberté, une liberté de faire, une liberté des Anciens, et non une simple liberté de ne pas être contrôlé, encadré par l’État, la liberté des Modernes, alors le despotisme menace d’autant plus fortement que la société est justement démocratique. Tocqueville remarque : « Je pense que l’espèce d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde ; nos contemporains ne sauraient en trouver l’image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain en moi-même une expression qui reproduise exactement l’idée que je m’en forme et la renferme ; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer. Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux et ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie. Au-dessus d’eux s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? » (De la démocratie en Amérique). Tocqueville peut ainsi conclure : « Le despotisme me parait particulièrement à redouter dans les âges démocratiques. » Face au triomphe conjoint de l’individualisme et du despotisme, la société s’atomise, comme avait bien vu Tocqueville. C’est ce que le « Comité invisible » aura bien défini quelque cent cinquante ans après sa mort, dans L’insurrection qui vient (La Fabrique, 2007) : « Le couple est comme le dernier échelon de la grande débâcle sociale. C’est l’oasis au milieu du désert humain. On vient y chercher sous les auspices de l’« intime » tout ce qui a si évidemment déserté les rapports sociaux contemporains : la chaleur, la simplicité, la vérité, une vie sans théâtre ni spectateur. » Avant de préciser que le couple n’échappe pas à la tourmente de la société-machine et marchandise.
Notre monde, Tocqueville nous a aidé à le penser. Tocqueville n’est ni libéral – il ne croit pas que l’intérêt général soit la simple somme des intérêts particuliers, ni rousseauiste – il ne croit pas à l’unanimité du peuple qui ne parlerait que d’une seule voix. Tocqueville est bien plutôt un ancêtre de Hannah Arendt et de sa notion d’une démocratie excédant radicalement toute idéologie des droits de l’homme. C’est aussi avec cent cinquante ans d’avance un formidable critique du nihilisme du règne contemporain de la marchandise et de l’équivalence généralisée des biens culturels et des œuvres d’art.
Pierre Le Vigan
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, théorie politique, philosophie, france, 19ème siècle, nihilisme, modernité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 mai 2009
Karl Ludwig von Haller en de restauratie gedachte
KARL LUDWIG VON HALLER EN DE RESTAURATIE GEDACHTE
door Willem van der Burcht - http://bitterlemon.eu/
De Zwitserse conservatieve staatstheoreticus en publicist Karl Ludwig von Haller werd op 1 augustus 1778 te Bern geboren in één van de voornaamste patriciërsfamilie van de trotse stadrepubliek. Hij was de kleinzoon van de grote natuurwetenschapper, arts, dichter en botanicus Albrecht von Haller (1708-1777) en de tweede zoon van de bekende staatsman, historicus, numismaticus en heruitgever van de “Bibliothek der Schweizergeschichte”, Gottlieb Emanuel von Haller (1735-1786). Hij liep school in de Academie van zijn geboortestad, maar de vroege dood van zijn vader en financiële problemen lieten universitaire studies niet toe, zodat hij op wetenschappelijk gebied geheel autodidact is gebleven.
Op amper zestienjarige leeftijd trad hij in dienst van de stad Bern – toen de grootste stadsstaat benoorden de Alpen – en maakte snel carrière door zijn bekende naam en zijn capaciteiten. Hij had goede vooruitzichten op een mooie loopbaan in dienst van de stad. Als twintigjarige was hij reeds Secretaris van de Commissie en politiek heel erg actief via politieke geschriften.
In juli 1790 maakte hij tijdens een reis naar Parijs persoonlijk kennis met de Franse revolutie. Hij zetelde in talrijke commissies en genootschappen en zijn toespraken en denkbeelden vielen bij velen in de smaak. Tussendoor schreef hij nog ontelbare verhandelingen, memoranda, tijdschrift- en krantenartikelen, enz.
Als delegatiesecretaris en in zijn talrijke publicaties, bemoeide hij zich ook met de Bernse buitenlandse politiek. Zo nam hij deel aan diplomatieke zendingen naar Genève (1792), Ulm (1795), Noord Italië -waar hij Napoleon ontmoette - en Parijs (1797); hij was aanwezig op het Congres van Rastatt (1797/1798) en in 1798 waarschijnlijk ook betrokken bij de onderhandelingen met de Franse generaal Brune, die met zijn revolutionaire troepen op het punt stond het Zwitserse Eedgenootschap binnen te trekken. Er werd nog voorgesteld dat de stad zelf met een progressief en liberaal “Projekt einer Constitution für die Schweizerische Republik Bern” op de proppen zou komen (maart 1798), maar het voorstel kwam te laat. Op 6 maart 1798 trokken de Fransen Bern binnen, wat het einde was van het oude Bern en ook van het oude Zwitserland dat, onder de benaming “Helvetische Republiek”, een Franse satellietstaat werd.
Anti-revolutionair verzet en eerste ballingschap
Albrecht Ludwig von Haller werd uit overheidsdienst ontslagen en met zijn tijdschrift Helvetische Annalen zette hij het verzet tegen het revolutionaire systeem voort. Algauw veroorzaakte hij een groot schandaal in de pers en ontkwam ter nauwer dood aan arrestatie vanwege de autoriteiten door naar Zuid-Duitsland te vluchten, waar hij zich aansloot bij de Zwitserse emigranten rond Nikolaus Friedrich von Steiger, de laatste verdedigers van een onafhankelijk Bern. Ondanks het feit dat ze ten gevolge van de krijgsgebeurtenissen niet lang op eenzelfde plaats konden blijven, spreidde hij een indrukwekkende literaire en propagandistische productiviteit ten toon.
In maart 1799 vond hij onderdak in het hoofdkwartier van het leger van Aartshertog Karel en in juni, tijdens de Eerste Slag van Zürich, was hij getuige van de eerste geallieerde zege op Napoleon, die echter algauw weer verloren ging door de Tweede Slag, die de Oostenrijkers ook dwong de terugtocht te aanvaarden. Vervolgens hield hij zich weer op in kringen van Zwitserse emigranten tot hij in juni 1801 als Hofkriegskonzipist in de Präsidialkanzlei van Aartshertog Karel in Wenen werd aangesteld.
De in 1803 tot Hofkriegssekretär bevorderde vluchteling werd – na de herinvoering van de kantonale soevereiniteit door de Mediatie Akte van Napoleon - in 1805 als professor in het staatsrecht aan de nieuw opgerichte Academie van Bern aangesteld. Hij moest echter alweer snel de benen nemen voor de oprukkende Franse troepen en hij vluchtte naar Agram in Kroatië.
Terug in Bern; academische loopbaan
Eind februari 1806 nam hij ontslag uit Oostenrijkse staatsdienst en keerde terug naar Bern om er zijn professoraat weer op te nemen. In hetzelfde jaar huwde hij de patriciërsdochter Katharina von Wattenwyl en bekleedde –naast talrijke andere ambten- de functies van Censor en Prorector aan de Academie van Bern. Hij begon zijn universitaire carrière met zijn openingsrede “Über die Notwendigkeit einer andern obersten Begründiging des allgemeinen Staatsrechts” (vert.: Over de noodzakelijkheid van een andere fundamentele grondslag van het algemene staatsrecht); het volgende jaar hield hij een rede “Über den wahren Sinn des Naturgesetzes, daß der Mächtige herrsche” (vert.: Over de ware betekenis van de natuurwet, dat de machtige heerse). In 1808 publiceerde hij zijn Handbuch der allgemeinen Staatenkunde [vert.: Handboek der algemene staatskunde], dat de basis vormde voor zijn lessen. Daarin worden zijn opvattingen over de staat - en in het bijzonder over het wezen en het ontstaan van de staatsgemeenschap - voor het eerst systematisch uiteengezet, en zodoende geldt het als voorloper van zijn grote werk, de Restauration der Staatswissenschaft (vert.: Restauratie der Staatswetenschap). Het Handbuch leverde hem roem en erkenning op, maar ook hoon en vijandschap.
Het "enfant terrible" van Bern
Von Haller kwam al gauw in conflict met zijn grote concurrent op de universiteit, Samuel Schnell. Nadat von Haller zijn ambt als Censor misbruikt had om zijn concurrent te benadelen, werd hij in 1809 verplicht zijn mandaat neer te leggen.
Dit verhinderde echter niet dat hij het jaar daarop lid van de Grote Stadsraad van Bern werd en in 1810 in de Kleine Stadsraad werd gekozen. In zijn opmerkelijke werk uit 1811: Politische Religion oder biblische Lehre über die Staaten (vert.: Politieke religie of Bijbelse leer over de staten) trachtte hij aan te tonen dat zijn nieuwe staatspolitieke opvattingen in alle opzichten in overeenstemming waren met wat de Bijbel daarover zegt. Hij bleek onvermoeibaar als politieke stokebrand, verklikker en intrigant in de Bernse stadspolitiek, en hij raakte betrokken bij enkele schandalen die een smet op zijn reputatie wierpen. Zo was hij de auteur van een (anonieme) recensie in de Göttingischen gelehrten Anzeigen waarin hij op een perfide wijze van leer trok tegen het levenswerk van Pestalozzi, waarmee hij de ongemeen harde hetze die tegen deze laatste gevoerd werd, nog aanwakkerde. Hij liet zich evenmin onbetuigd in de zogenaamde “Kreis der Berner Unbedingten” terwijl zijn rol in het “Waldshuter Komitee” nog steeds niet helemaal opgehelderd is. Voor zijn verantwoordelijkheid bij de onlusten in Nidwalden werd hij tot een celstraf veroordeeld, maar snel begenadigd. Wel leverde dit incident hem een blaam op vanwege de voorzitter van de Kleine Raad.
De door von Haller bejubelde doortocht van de geallieerde legers door Bern op 23 december 1813 en een algemene staking bij de overheid, leidden tot de val van de Mediatieregering, die werd opgevolgd door de Restauratieregering. Hij stelde zich kandidaat voor de verkiezingen voor de Grote (of “Soevereine”) Raad van de Republiek Bern, die op 12 januari 1814 gehouden werden, met een programma dat hij in twee propagandabrochures neerschreef: Was sind Untertanenverhältnisse? (vert.: Wat zijn onderdanenverhoudingen?) en Was ist die Alte Ordnung? (vert.: Wat is de oude orde?)
Zijn hoofdwerk: "Restauration der Staatswissenschaft"
Von Haller was co-auteur van de nieuwe Bernse grondwet van 1815 en lid van de commissie die de grondwet diende te herzien ten gevolge van de aansluiting van de Jura. In 1816 werd hij tot lid van de Geheime Raad gekozen, waar hij echter met zijn reactionaire voorstellen op niet veel steun kon rekenen.
Op de derde verjaardag van de Slag bij Leipzig voltooide hij het eerste deel van zijn magnum opus dat zijn naam zou geven aan een heel tijdperk: Restauration der Staatswissenchaft (vert.: Restauratie der Staatswetenschap). Dag op dag een jaar later, op 18 oktober 1817, werd het boek tijdens het Wartburgfest openbaar verbrand omdat het een Duitse grondwet niet genegen was.
De volgende delen van het monumentale werk (2: 1817; 3: 1818; 4: 1820; 5: 1834; 6:1825) kenden niet meer dezelfde weerklank als het eerste deel, ondanks de vele (negatieve) publiciteit die von Haller te beurt viel: in 1817 werd hij gedwongen “in allen Ehren” (sic) ontslag te nemen als professor aan de Bernse universiteit, en hoewel hij nog tal van ambten beklede, bleef hij vooral op een negatieve wijze in de belangstelling komen.
In zijn Über die Constitution der spanischen Cortes (vert.: Over de Constitutie van de Spaanse Cortes), betoonde hij zich een hartstochtelijke verdediger van de koninklijke rechten, tegen de usurpatoren van de Cortes-grondwet in. Het geschrift werd aanvankelijk door de bevriende censor toegelaten, maar kort daarop door de Kleine Raad van Bern verboden.
Karl-Ludwig von Haller -“cet extravagant”, zoals hij genoemd werd- maakte zich alsmaar minder en minder geliefd. Het enfant terrible van de Bernse politiek gold in die dagen niet alleen in Bern maar in heel Zwitserland als ultrareactionair. Die reputatie had hij ook te danken aan zijn engagement in wat de “Olry-Hallerschen Clique” werd geheten. Het grootste schandaal, dat de emmer ten slotte deed overlopen, stond echter nog te gebeuren.
Bekering tot het katholicisme en tweede ballingschap
Op 17 oktober 1820 legde de protestantse patriciër uit Bern – die later bekende “… in zijn hart reeds sedert 1808 katholiek te zijn geweest …” - op het landgoed van de familie de Boccard in Jetschwil (Freiburg), in het geheim de Katholieke Geloofsbelijdenis af. Tijdens een oponthoud op weg naar Parijs raakte zijn bekering echter bekend. Hij koos voor de vlucht naar voren en kondigde in een brief aan zijn familie zijn overstap naar het Katholieke geloof aan. Deze apologie, die meer dan 70 herdrukken beleefde en in vele talen werd vertaald, lokte een stortvloed aan reacties pro en contra uit! Zijn bekering zond een schokgolf doorheen Europa en ontketende een storm in de pers. Op voorstel van de Kleine Raad en na stormachtige debatten werd Von Haller door een overweldigende meerderheid in de Grote Raad uit al zijn ambten ontzet en voor immer en altijd van lidmaatschap van datzelfde orgaan uitgesloten.
Von Haller werd nu voor de tweede maal – en deze keer definitief – weggejaagd. Tevergeefs verzocht hij in Oostenrijkse, Pruisische of Spaanse dienst te kunnen treden; na afscheidsbezoeken aan Freiburg, Bern, Genève en Erlach te hebben gebracht, trok hij in mei 1822 met zijn familie – zonder zijn beide zonen, die tot 1823 hun studies in Gottstadt verderzetten – naar Parijs. Daar werd hij snel opgenomen in het gezelschap van gelijkgezinden, waaronder de Bonald, de Lamennais en anderen, en leverde hij talrijke bijdragen aan Franse ultraroyalistische en Duitse conservatieve bladen. In juli 1824, na het terugtreden van Chateaubriand, kreeg hij een aanstelling als “publiciste” verbonden aan het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
In Parijs vond hij ook de tijd en de energie om zijn familieleden tot het katholicisme te bekeren, achtereenvolgens de groep rond zijn dochter Cecilia, de bij hem inwonende Julie Mathilde von Erlach, zijn tweede zoon Albrecht (die later hulpbisschop van Chur zou worden), zijn oudste zoon Karl Ludwig (later publicist en politicus in Solothurn) en uiteindelijk ook zijn echtgenote.
Reeds in 1828 kocht von Haller in Solothurn het huidige bisschoppelijke paleis en in 1829 verwierf hij het burgerschap van deze stad. Kort na de Julirevolutie van 1830 trok hij weg uit Parijs om zich definitief in Solothurn te vestigen.
Voorvechter van de Restauratie tot het einde
In Solothurn stelde hij zich aan het hoofd van de ultraconservatieven en was vanaf 1834 drie jaar lang lid van de Grote Raad; in 1837 werd hij niet meer herkozen.
Koortsachtig richtte de reeds op pensioenleeftijd gekomen pamflettist zijn pijlen op de rampzalige tendensen van zijn tijd. In 1833 ontwierp hij het programma voor een “Bund der Getreuen zum Schutz der Religion, der Gerechtigkeit, und der wahren Freiheit” (vert.: Bond der getrouwen ter bescherming van de Godsdienst, de Gerechtigheid en de Ware Vrijheid), die zou uitgroeien tot een internationale strijdgroep tegen liberalisme, de vrijmetselarij en het revolutionaire systeem überhaupt. Met Satan und die Revolution (vert.: Satan en de revolutie) uit 1834 toonde hij aan dat de drijvende krachten achter de revolutie voortsproten uit het Kwade. In zijn Geschichte der Kirklichen Revolution oder protestantischen Reform (vert.: Geschiedenis van de kerkelijke revolutie of protestantse hervorming, 1836) ontmaskerde hij de reformatie als een tweede zondeval, en duidde haar als diepere oorzaak van en voorloper van de grote revolutie.
Met zijn geschriften tegen de vrijmetselarij (1840/41) wilde hij de “oerleugen” blootleggen die volgens hem aan de basis lag van de valse leerstellingen van die verderfelijke “sekte” en antistoffen aanreiken ter bestrijding ervan. Achter alle revolutionaire stromingen in Zwitserland vermoedde hij de hand van geheime genootschappen en hun ideeën van “gleichmacherei” (lett. vert.: “gelijkmakerij” of egalitarisme), van “onverschilligheid ten aanzien van iedere vorm van religiositeit”, van “exclusieve haat jegens de katholieke godsdienst en kerk”, van “afschaffing van iedere gedachte van een opperheerschappij” en van een “bevrijding van iedere hogere macht”. In zijn strijd tegen de revolutie, die bij wijlen extreme en obsessieve vormen aan nam, schreef hij ontelbare journalistieke bijdragen voor kranten en tijdschriften .
Hij ondernam ook nog meerdere reizen: in 1840 verbleef hij een tijdje in het Zuiden van Duitsland, meerbepaald in München; ook Freiburg, Luzern, Schwyz en Kienzheim in de Elzas deed hij aan. Op zijn reizen legde hij veel contacten en ook door middel van een uitgebreide correspondentie met iedereen van naam en faam in Europa, onderhield hij contacten met katholieken, bekeerlingen, ultramontanen, conservatieven en reactionairen.
Von Hallers werk gaf, samen met de activiteiten van de Jezuïeten, voedsel aan een antiprotestantse, traditionalistische en legitimistische politieke cultuur in Zwitserland, wat de spanningen aan de vooravond van de Sonderbundskrieg van 1847 aanzienlijk deed toenemen. De katholieke, conservatieve en overwegend landelijke kantons moesten het echter afleggen tegen de protestantse, liberale stadskantons; deze nederlaag én de revolutie die in 1848 door gans Europa trok, ervoer de bejaarde voorvechter als een persoonlijke nederlaag. Tijdens de laatste jaren van zijn leven zag hij zijn levenswerk instorten.
In hetzelfde jaar als de revolutie overleed zijn echtgenote, die al lange tijd zwaar ziek was. Op 20 mei 1854 volgde hij haar in het graf ten gevolge van een longontsteking. Drie dagen later werd hij op het kerkhof van Sint-Katharina van Solothurn bijgezet. Het kerkhof werd echter onder het radicale regime met de grond gelijk gemaakt, zodat er niets meer overblijft dat herinnert aan deze onvermoeibare strijder, wiens levenswerk gericht was tegen zijn eigen tijd.
Von Hallers reactionaire staatstheorie
Albrecht Ludwig von Haller was zijn hele leven lang vervuld van het profetisch zendingsbewustzijn, de kop van de slang van het jacobinisme te moeten verpletteren. Daarvoor ontwikkelde hij een restauratieve staatstheorie gebaseerd op de “natuurlijke gemeenschap”, als tegenpool voor Rousseau’s “kunstmatig-burgerlijke” leer van het “sociaal contract”. Tegenover deze zuiver speculatieve drogbeelden wilde hij een uit de Schepping en uit de Openbaring gedestilleerde, wetenschappelijk onderbouwde Waarheid plaatsen die universeel en absoluut geldig was.
Von Haller zag de basis van de maatschappelijke verhoudingen in de Natuurwet, waarbij de sterkere heerst en de zwakkere dient: “De machtige heerst, of hij wil of niet, terwijl de zwakke dient, of hij wil of niet”.
Tegenover de geconstrueerde, egaliserende filosofie van de revolutie, plaatste hij de door hem opnieuw naar voor gebrachte principes van de “eeuwige en onveranderlijke Goddelijke Ordening”: de fundamentele ongelijkheid, de “weldadige verscheidenheid” der “krachten en noden” en de superioriteit van de sterksten. Macht en heerschappij komen voort uit het Natuurrecht, het Goddelijke recht en het positieve recht.
Von Hallers doctrine wordt daarom vaak voor brutaal, materialistisch en utilitaristisch aanzien. Daar zijn leer ook de triomf van de sterke over de zwakke bejubelt en soms geweld verheerlijkt, wordt eveneens beweerd dat zijn ideeën op de “Uebermensch” van Nietzsche vooruitliepen of zelfs dat zijn stellingen – indien consequent doorgedacht – tot een toestand van anarchie zouden leiden.
De Staat als huishouding
De Staat is voor von Haller een oneindig uitgestrekte familie, één reusachtige huishouding. De heerschappijverhoudingen zijn over elkaar heen geordend en van een zuiver privaatrechterlijk karakter.
Zo wil hij dat het Staatsrecht, de opperste bekroning van de natuurlijke dienst- en maatschappelijke verhoudingen, wordt vervangen door een aggregaat van oneindig verschillende, vrije, private verdragen. Met andere woorden: staatsrecht en privaatrecht zijn voor hem identiek. Bijgevolg bestaat er binnen een staat ook geen gemeenschappelijk doel, maar is hij slechts een mengeling van talrijke verschillende private doelen. Dus dient de Staat uitsluitend de door God gewilde verhoudingen en toestanden te bewaren en garandeert hij zo de ware Vrijheid, de vrijheid der voorrechten en de natuurlijke ongelijkheid.
Deze opvatting die – consequent doorgedacht – de staat ontbindt tot op het niveau van de enkele individu, staat in schril contrast tot de ideeën over Staat en Natie die in die periode overal in Europa opgang maakten.
De Staat als patrimonium
De natuurlijke basis voor het uitoefenen van macht en heerschappij is grondbezit. De landsheer is niets anders dan de grootste eigenaar en de Staat is zijn patrimonium. In deze “Patrimonialstaat” (lett. vert.: patrimoniumstaat) – een uitvinding en woordkeuze van von Haller waarmee hij een soort van feodale standenstaat voor ogen had – is de vorst enkel tegenover God verantwoording verschuldigd. Zijn gezag wordt slechts beperkt door verdragen en het recht, door de eigendom en de autonomie van zijn onderdanen en door de uit de Natuur afgeleide morele wetten. Gerechtigheid moet het Kwade verhinderen terwijl Liefde het Goede moet bevorderen. De concrete vrijheid die ieder individu toekomt, wordt gemeten naar de relatieve macht die iemand op grond van zijn sociale positie binnen het kader van heerschappij en dienstbaarheid, toekomt.
Onafhankelijkheid zonder dienstbaarheid behoort tot de soevereiniteit van de vorst en staat op de hoogste spurt van het menselijke geluk. Dit voorrecht verplicht de vorst tot rechtvaardigheid en tot het goede. Deze premisse, dat slechts de zwakke misbruik zou maken van zijn macht en niet de sterke, heeft hem het verwijt opgeleverd op moreel vlak naïef te zijn.
Invloed en nawerking
Von Hallers ambitieuze voornemen om een totaalverklaring voor de gehele werkelijkheid te geven, kan gezien worden als een – enigszins laattijdige - poging om het Ancien Régime op rationalistische basis te legitimeren. Tegelijkertijd heeft hij echter een gefundeerde contrarevolutionaire doctrine en een monumentale uitdaging aan het adres van de moderniteit nagelaten!
Ondanks de vaak starre systematiek, de ongegeneerde wereldvreemdheid en de reeds in zijn tijd opgemerkte anachronismen, heeft von Hallers “politieke theologie” – hoewel slechts voor een korte tijd – een enorme weerklank in Europa gekend. Von Haller werd alom bewonderd (bijvoorbeeld door de jonge Achim von Arnim) en zijn Restauration der Staatswissenschaft verdrong Adam Müllers Elementen der Staatskunst als hoogste autoriteit op het gebied van de staatswetenschappen. Daarnaast was von Hallers denken – naast dat van de Maistre en de Bonald - van groot belang voor de ontwikkeling van de staatsleer van het politieke katholicisme.
Zijn onhistorische, rationalistische opvattingen over de staat werden in kringen van Pruisische Junkers hartstochtelijk verwelkomd en ze oefenden een grote invloed uit op de conservatieven van het laatromantische Berlijn, zoals op de Christelijk-germaanse kring rond de gebroeders Gerlch.
Voor de Pruisische koning Frederik Willem IV dan weer, was von Hallers idee van een op religieuze grondslagen gevestigde “patrimoniale standenstaat”, tot in de jaren vijftig van de 19de eeuw het te verwezenlijken ideaal. De invloed die von Haller op het Pruisische conservatisme uitoefende, werd slechts overtroffen door die van Friedrich Julius Stahl (1802-1861).
Ook in Wenen kon von Hallers Restauratie-idee op grote instemming rekenen. In Zwitserland zelf bleef zijn invloed eerder gering, hoewel toch enkele aanhangers in zijn voetsporen verder werkten. In Frankrijk, in Nederland, in Italië (en in het bijzonder in de Kerkelijke Staten) en in Spanje bekenden prominente geestelijken en politici zich tot von Hallers systeem. Dit uitte zich niet alleen in publieke stellingnamen, maar ook in de talrijke orden en onderscheidingen die hem verleend werden, alsook in zijn indrukwekkende briefwisseling.
De nawerking van von Hallers poging om de geestelijke premissen van de revolutie door een antitheorie in de kiem te smoren om zo de tijd terug te kunnen draaien, was echter van korte duur. De democratische, liberale en nationale krachten stormden over hem heen en bepaalden het verdere verloop van de geschiedenis tot in de 21ste eeuw.
"Restauratie” verwerd van een strijdkreet tot een scheldwoord, de reactionair werd ideologisch geïsoleerd en als verliezer van de geschiedenis uit het collectieve geheugen verbannen. Niettegenstaande, blijft deze eens zo toonaangevende “politieke Luther” of “Helvetische Bonald”, zoals hij wel eens genoemd werd, één der belangrijkste en eigenzinnigste conservatieve denkers van de 19de eeuw. Geen enkele zichzelf respecterende conservatief kan het zich veroorloven rond deze Zwitserse persoonlijkheid van Europees formaat heen te lopen.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, restauration, droite, conservatisme, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 27 avril 2009
Renoncement : aliénation, servitude et tyrannie
Archives de "Synergies Européennes" - 1997
Renoncement : aliénation, servitude et tyrannie
Mai 1995 en France. Les anciens cabinets s'en vont, les nouveaux arrivent : ce sont les mêmes ou presque. Le pouvoir des commanditaires fortunés et les nouveaux riches, politiciens et technocrates, ont fait alliance avec les notables. Ce trust s'appuie sur une idéologie officielle, la « pensée unique », nouvelle désignation de la pensée pieuse des religions monothéistes, et réorganise idéologiquement la société. Le trust a mis la main sur l'Etat et, comme toute mafia, défend ses privilèges et ses richesses ; à l'abri du Pouvoir, le chemin de l'enrichissement est pavé de crapuleries heureusement effacées par les pensées pieuses affichées.
Un système de castes s'est constitué en France en particulier et en Europe en général grâce à l'introduction de lois obscurantistes, et par l'intermédiaire de colonies de peuplement affluant de toutes parts en raison des facilités d'établissement que le parti des ethnocideurs leur accorde et de la prodigalité avec laquelle les satrapes étatiques accordent la citoyenneté. La naturalisation de ces foules est effectuée alors même qu'elles se regroupent par "ethnos" et servent de point d'ancrage à de nouveaux trafics au détriment des Européens de vieille souche. L'éradication du peuple donne naissance à la plèbe, abrutie ou excitée par la pègre médiatique selon le pogrom du jour. Dans la course au profit, les plus malins, les plus fripons, les mieux organisés sur le plan transnational utilisent les trous noirs des paradis fiscaux et des zones franches juridiques, ainsi que la religion du droit de l'homme, ecclesia d'agitateurs sacerdotaux professionnels.
Pensée unique, idéologie officielle
L'équité dont se revendiquent les mafias installées emprunte le modèle raciste des trafiquants pieux. La pensée est interdite, remplacée par la croyance unique distillée par la race supérieure des purs et imposée au moyen des ruses de commerçants ou par violence contre les philosophes, "qui ne savent point ce qui est, mais qui savent très bien ce qui n'est pas" (1). Il apparaît qu'on n'a jamais tant craint les gens d'esprit en Europe qu'aujourd'hui. Et tous les conflits doivent être réglés par des magistrats sous contrôle, leur servilité s'obtenant par tous moyens : corruption, sélection partisane, intimidation. Ainsi les cours jugent-elles toujours comme il plaît à la Cour.
La pensée unique est l'anti-France. Elle s'étale à partir de cercles où règne la bassesse, et la tyrannie théocratique qui en résulte est bien pire que la discipline librement consentie dans le cadre d'un Etat. Le mensonge est permanent : faux chiffres, fausses idées, fausses solutions, et toujours le même catéchisme, la même idéologie : le branchement planétaire qui fait l'impasse sur l'organisation des savoirs, sur la structure de la pensée, sur la lente maturation de l'intelligence. La table rase des esprits est organisée au moyen de la pédagogie ludique substituée à la discipline intellectuelle, l'animation remplaçant l'instruction. Toutes les tyrannies théocratiques n'ont-elles pas pour but de liquider le passé et de le réécrire selon des principes pieux ?
Il existe en France une idéologie officielle, c'est-à-dire une doctrine idéologique et une organisation idéologique des hommes qui se renforcent chaque jour. L'idéologie officielle est un système dans lequel tout se tient : rejet du modèle républicain, doctrine de l'Etat minimum, franc fort, politique fiscale et rationnement budgétaire, mauvais fonctionnement de la police, de la justice, de l'école, inégalité d'accès aux services publics, chômage, rétrécissement de la protection sociale... Et aussi la désintégration du système productif, de l'armature territoriale de la ville, le déclin de l'industrie, les difficultés de l'agriculture... Chaque chapitre du livre de Henri GUAINO (2) développe un slogan pieux et en montre le ridicule ou la fausseté.
Ridicule et fausseté de la « pensée pieuse »
1 - La pensée unique dit : "La politique, c'est toujours la droite contre la gauche". Or, il existe aujourd'hui une classe dirigeante unique, qui verrouille les fonctions administratives, politiques et économiques. Le régime oligarchique est en effet très efficace pour assurer la prospérité durable des diverses factions qui s'entendent au détriment du public au lieu de s'affronter.
2 - La pensée unique dit : "La France vit au-dessus de ses moyens". D'où la désinflation compétitive. Mais un pays n'est pas une entreprise. Le travail ne saurait disparaître compte tenu de la dynamique permanente des besoins. Les chiffres de la comptabilité nationale sont à appréhender avec un regard critique, comme il fallait interpréter les statistiques du plan dans les anciens pays de l'Est... Le service des rentiers est présenté sous la forme d'une nécessité : ce serait le problème économique fondamental. Mais n'y a-t-il pas 7 millions de personnes confrontées directement aux difficultés de l'emploi ? Le coût du chômage n'atteint-il pas 1100 milliards de francs ? Les actifs entre 35 et 45 ans ne se suicident-ils pas plus que les personnes âgées ? Le produit par tête ne stagne-t-il pas depuis 1990 à un taux de croissance inférieur à 1% par an ? Aucune importance...
3 - La pensée unique dit : "La France va bien, elle avance dans la bonne direction". Or, les crapuleries montent en flèche. La guerre des groupuscules, de tous contre tous, fait vivre les anciens habitants dans une insécurité permanente dont ils savent que les mafias en possession d'Etat sont dispensées. Les Européens de vieille souche sont devenus minoritaires en de multiples lieux et massivement déportés par l'avancée de la barbarie. Parallèlement, le quadrillage de la population par l'industrie de la charité l'incite à quitter les petits villages, voués à la mort. Les droits élémentaires fondamentaux, dont celui de choisir son voisin, sont effacés par l'Etat qui force ainsi à l'exode des masses avilies par une propagande haineuse intense.
Dans l'enseignement, les mouchards-penseurs pullulent et affirment que puisqu'ils racontent partout la vérité vraie aux frais de l'Etat, le niveau monte. Quand à la protection sociale, la rançon dont les classes moyennes doivent s'acquitter chaque mois croît alors que la couverture décroît. La France se transforme en un ramassis de sectes, bandes, mafias. L'assassinat du peuple est vu comme la meilleure façon de jouir tranquillement du pouvoir et de ne plus être dérangé.
4 - La pensée unique dit : "Les fondamentaux sont bons". Un pays bien géré est en excédent. Mais le monde ne peut pas être en excédent vis-à-vis de lui-même. Lorsque le FMI martèle le catéchisme de l'ajustement structurel, il aliène les peuples au profit des soviets de la finance. La croissance repose sur la dynamique interne des pays qui travaillent pour eux-mêmes. Il est criminel de sacrifier le niveau de vie à la compétitivité extérieure. L'ordre de « réduire les déficits » est une erreur en matière budgétaire. L'épargne résulte de l'investissement, non l'inverse. Le montant et la nature de la dépense déterminent la réussite, en sorte que la première décision utile serait de réduire massivement les impôts pour accroître le revenu disponible. Les mauvais choix de dépenses et la restriction budgétaire coûtent chaque année 1,2 points de croissance et 800.000 chômeurs. En matière de retraites enfin, les têtes plates et les soviets de la finance encouragent la capitalisation. Or, les actifs paient les pensions des anciens si l'investissement intellectuel et matériel dont ils ont bénéficié dans leur jeunesse a été judicieux et rentable.
5 - La pensée unique dit : "Une bonne monnaie est une monnaie forte". Mais la monnaie forte bloque l'expansion et exprime un fétichisme qui n'est pas sans rappeler l'attitude à l'égard de l'or au temps de Philippe II. Pour nombre d'historiens, dont Pierre VILAR (3), les entrées de métaux précieux en Europe, leurs découvertes, ne sont jamais des variables exogènes aléatoires. A l'origine, il y a toujours une baisse générale des prix exprimés en or ou en argent, qui s'explique par un développement économique, source d'une pénurie de métaux précieux. La croissance crée le besoin monétaire, non l'inverse. Et si une dévaluation du Franc empire le déficit de la balance, il faudrait en toute logique, hausser le Franc...
D’autres politiques sont possibles
Les slogans des factions en possession d'Etat se rapprochent de ceux de toute théocratie : il n'y a qu'une vérité révélée, qu'un corpus doctrinal dont elles sont les interprètes autorisés. Il n'y a qu'une politique possible : la France, petit pays, n'a pas de moyens ; l'Etat est à abandonner au profit des internationales, mieux adaptées à une société complexe, en mutation ; l'Euro sera un bon bouclier contre la mondialisation. En réalité, le problème principal tient à la constitution d'Empires financiers conquérants dirigés par un système de soviets, des consistoires multimédias pilotés par des Al Capone pieux, en sorte que la mondialisation est très spécifique : un impérialisme semblable à celui des bolcheviks d'hier et de l'Eglise d'avant-hier.
Or, d'autres politiques sont possibles. Henri Guaino préfère la politique inspirée du jacobinisme. Il note que le gouvernement des juges s'installe sur la défaillance des dirigeants, et qu'une guerre s'engage entre juges et Etat, mortelle pour la république. L'analyse est à compléter. Pour un lettré d'aujourd'hui, l'Etat ressort plutôt de la dérive confessionnelle. La pénurie intellectuelle règne car le parti dévot, comme il y a deux mille ans, impose l'unité d'obédience religieuse : histoire sainte, dogmes absurdes, pensées pieuses ethnocidaires. La haine des humains qui pensent, l'anathème, bref l'infâme~ ont pris leur envol et l'Etat se met au service du fanatisme méticuleux.
« Lorsque le chevalier de La Barre, petit-fils d'un lieutenant-général des armées, jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une grande espérance, mais ayant toute l'étourderie d'une jeunesse effrénée, fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies, et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau, les juges d'Abbeville... » (4) furent dénoncés par Voltaire comme n'offrant pas de garantie d'intelligence, de compétence et d'impartialité. Il les appela des "Arlequins anthropophages". Ne revivons-nous pas cette situation ? La séparation des pouvoirs est parfaitement accessoire dans les circonstances présentes. La division du pouvoir en trois branches (exécutif, législatif, judiciaire) n'est plus qu'une commodité purement professionnelle. Elle semble plutôt protéger certaines factions contre d'autres au sein du pouvoir lui-même mais, en aucune façon, ne met la population à l'abri d'une tyrannie des pensées pieuses : les arrêts contre les impies sont toujours rendus par des "cannibales".
L'Etat est devenu la marionnette du pouvoir économique. La fusion des deux a créé un super-pouvoir, directoire informel qui n'est ni fixé dans les textes, ni reconnu comme une institution légale. Aussi, la plupart des élites "visibles" ne sont plus qu'un ramassis, une véritable sous-humanité de pantins s'agitant sous la férule de ce super-pouvoir. Félicitons M. Guaino d'avoir préféré la démission à la collaboration avec des associations de malfaiteurs.
PONOCRATES.
(1) VOLTAIRE : Progrès de la philosophie. A M. D'Alembert. Lettre du 5 avril l765. Dans : Lettres choisies de Voltaire, Classiques Larousse, 1937, p. 88.
(2) Henri GUAINO : L'étrange renoncement, A. Michel, 232 p., 98 FF.
(3) Pierre VILAR : Or et monnaie dans l'histoire (1450-1920), Champs-Flammarion, 1974.
(4) René POMEAU : Voltaire par lui-même, Le Seuil, coll. Ecrivains de toujours, 1962, p. 151.
00:09 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : renoncement, aliénation, servitude, tyrannie, sciences politiques, politologie, théorie politique, économie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 26 avril 2009
Furet/Nolte: fascisme et communisme
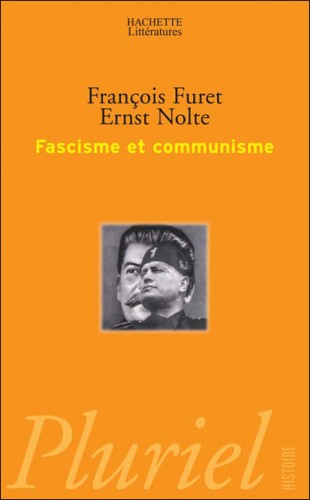
Archives de "SYNERGIES EUROPEENNES" - 1997
Furet & Nolte : fascisme et communisme
Chez Plon est paru Fascisme et communisme de François Furet et Ernst Nolte. Voici un extrait de la présentation: «Cet essai, qui réunit huit lettres échangées entre François Furet et l'historien allemand Ernst Nolte, constitue une sorte de prolongement au livre majeur de François Furet, Le passé d'une illusion. En réponse aux pages consacrées par Furet à l'analyse du fascisme et du nazisme chez Nolte, ce dernier entreprit de préciser et de développer une interprétation qui, lors de sa parution voilà dix ans, avait déclenché la plus importante controverse historique de l'après-guerre en Europe. Mais ce texte est davantage qu'une réflexion contradictoire entre deux grands historiens. Il propose une lecture de l'histoire du XXième siècle hors des sentiers battus à partir d'un événement fondateur, la guerre de 1914, et des liens qui unissent les trois "tyrannies" du siècle le fascisme, le nazisme et le communisme. Il s'agit de comprendre et d'expliquer l'étrange fascination que ces mouvements idéologiques et politiques ont exercée tout au long du siècle ». A propos de la liberté de la recherche historique, F. Furet écrit: « Rien n'est pire que de vouloir bloquer la marche du savoir, sous quelque prétexte que ce soit, même avec les meilleures intentions du monde. C'est d'ailleurs une attitude qui n'est pas tenable à la longue, et qui risquerait d'aboutir à des résultats inverses de ceux qu'elle prétend rechercher. C'est pourquoi je partage votre hostilité au traitement législatif ou autoritaire des questions historiques. L'Holocauste fait hélas partie de l'histoire du XXième siècle européen. Il doit d'autant moins faire l'objet d'un interdit préalable que bien des éléments en restent mystérieux et que l'historiographie sur le sujet n'en est qu'à son commencement » (P. MONTHÉLIE).
François FURET et Ernst NOLTE, Fascisme et communisme, 1998. 146 pages. 89 FF. Editions Plon.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, fascisme, communisme, totalitarisme, politologie, histoire, sciences politiques, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 avril 2009
E morto Giano Accame
È morto Giano Accame |
| ROMA (16 aprile) - Giano Accame si è spento a Roma. La notizia della morte dello storico, giornalista e scrittore nato a Stoccarda il 30 luglio del 1928 è stata data dal figlio Nicolò. La camera ardente, allestita presso la casa-studio di Accame in Lungotevere dei Mellini 10 a Roma, verrà aperta questo pomeriggio a partire dalle 15. I funerali si svolgeranno sabato prossimo alle 10.30 a Roma, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione al Foro romano. Accame, giornalista, studioso, direttore del Secolo d'Italia ìtra l'88 e il '91, è stato uno degli intellettuali di primo piano della destra italiana e avrebbe compiuto 81 anni il 30 luglio. Aveva un record unico tra i giovani di Salò: si arruolò la mattina del 25 aprile 1945: «la sera ero già in galera. Non ho mai fatto il miles gloriosus anche per questo. Avevo 16 anni», disse in una recente intervista. Accame, nato a Stoccarda ma cresciuto a Loano, ha avuto un percorso molto particolare nella destra. Fu tra i relatori al convegno sulla Guerra rivoluzionaria, nel '65, che gettò le base teoriche della strategia della tensione, dirigente del Movimento sociale italiano fino al '68, tra i più stretti collaboratori di Randolfo Pacciardi, padre del presidenzialismo italiano, nell'esperienza effimera dell'Unione democratica per la Nuova Repubblica, anticipatrice del dibattito sulla repubblica presidenziale. E' stato poi redattore delle più importante riviste della destra - da Il Borghese, al Fiorino e L'Italia settimanale - collaboratore de Il Sabato, Lo Stato, Pagine Libere, Letteratura. Durissima fu in principio la sua critica a Gianfranco Fini che parlava del fascismo come male assoluto ma Accame negli ultimi tempi leggeva gli avvenimenti politici e la confluenza con Forza Italia nel Pdl come un necessario fatto imposto dai tempi. Collocava dunque questa svolta nell'orizzonte del superamento delle ideologie, «oltre la destra, oltre la sinistra - disse ricordando lo slogan sempre caro alla destra sociale dell'Msi - il vero ambito in cui si muove questa fusione è quello della de-ideologizzazione, una scelta che è positiva ma che impone nuove analisi, nuovi modi di essere, nuove sfide. Lo globalizzazione non è stata quel fenomeno negativo che oggi si tende a raffigurare». «Per me è veramente una scomparsa gravissima, per me è stato un maestro», ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno. «Ho offerto alla famiglia di allestire la camera ardente in Campidoglio - ha detto Alemanno - loro però preferiscono tenerlo a casa». «È stato un intellettuale di grandissimo spessore - ha concluso - che ha attraversato tutta la storia del dopoguerra, con posizioni sempre molto ricche e significative. È stato uno dei grandi maestri della cultura di destra». |
00:48 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, italie, non conformisme, pensée rebelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Chi era Giano Accame
Chi era Giano Accame
L'intellettuale "eretico" di destra
Pensatore eretico della destra, fascista di sinistra, uno degli intellettuali storici della destra italiana, l'intellettuale che voleva unire destra e sinistra sull'idea di patria, il pioniere del dibattito sulla repubblica presidenziale, il primo intellettuale di destra ad avere posizioni filoisraeliane, pensatore "scomodo" grande studioso del poeta americano Ezra Pound: sono solo alcune delle definizioni date ad Giano Accame, il giornalista, saggista e scrittore scomparso a Roma a 81 anni.
Da vero "irregolare" del panorama politico e culturale di destra, Giano Accame ha ricoperto ruoli diversi nella sua lunga vita: dalla sua collaborazione con Tabula Rasa, fucina di pensatori della destra, a inviato del settimanale Il Borghese dal 1958 al 1968; per sedici anni direttore del settimanale Nuova Repubblica, che faceva capo al repubblicano Randolfo Pacciardi, e direttore del quotidiano Il Secolo d'Italia, organo del Msi, tra il 1988 e il '91. Ha pubblicato diversi libri che hanno sempre suscitato dibattito a destra e letti con attenzione a sinistra: Socialismo tricolore (1983) con Editoriale Nuova, poi con Settimo Sigillo Il fascismo immenso e rosso (1990), Ezra Pound economista, Contro l'usura (1995), La destra sociale (1996), Il potere del denaro svuota le democrazie (1998). Nel 2000 con Rizzoli Accame ha pubblicato Una storia della Repubblica: un'opera, avvertiva l'editore, non basata sul conformismo e sul politicamente corretto, ma raccontata con un'interpretazione fuori dai vecchi schemi, spesso critica ma sempre obiettiva e rigorosamente documentata. In pochi mesi il volume fu ristampato più volte e poi apparve anche in edizione tascabile Bur Rizzoli. Alla presentazione ufficiale del libro a Roma esponenti di destra e di sinistra cercarono di far "pace" sul dopoguerra: intervennero, tra gli altri, Gianni Borgna, Marco Minniti, Gianni Alemanno e Francesco Storace.
Giano Accame nasce a Stoccarda il 30 luglio 1928 da madre tedesca, Elisabeth von Hofenfels, mentre il padre e il nonno furono ammiragli e gli antenati piccoli armatori di Loano (Savona). Il 25 aprile 1945, giorno della Liberazione, ad appena 17 anni, Accame si arruolò nella marina militare della Repubblica sociale italiana, ammirando la Decima Mas. La sua adesione alla Rsi durò lo spazio di un mattino, perché alla sera fu catturato dai partigiani a Brescia. Nel 1946 si iscrisse a Genova al Fronte degli Italiani, organismo poi confluito nel Msi, di cui creò le prime sezioni nella riviera ligure ed è stato dirigente regionale e nazionale. Nel 1956 lasciò il Movimento sociale italiano, stanco di polemiche interne e per impegnarsi di più con il giornalismo, sua futura professione, nelle polemiche culturali.
Da qui la collaborazione, con altri intellettuali già stanchi del partito, con Tabula Rasa. Nel 1956 iniziò la professione come capo della redazione toscana del settimanale Cronaca italiana. Nel 1958 passò a Il Borghese, da cui si dimise nel 1968 per contrasti sulla contestazione giovanile. Segretario del Centro di vita italiana presiedutoda Ernesto De Marzio, organizzò a Roma due incontri internazionali di scrittori di destra. Nel1964 dirisse il settimanale Folla, poi, Nuova Repubblica, organo del movimento presidenzialista del repubblicano Randolfo Pacciardi, l'Unione democratica per la nuova Repubblica, di cui divenne segretario nazionale. Come stretto collaboratore di Pacciardi, Accame fu anticipatore, durante gli anni Sessanta, del dibattito sulla repubblica presidenziale.
Dal 1969, come inviato ed editorialista de Il Fiorino, Giano Accame si specializzò in giornalismo economico e collaborò agli Annali dell'economia italiana di Epicarmo Corbino. Tra la fine del 1988 e il 1991 ricoprì l'incarico di direttore del Secolo d'Italia. Ha collaborato con diverse riviste, tra le quali L'Italia settimanale, Il Sabato, Lo Stato, Pagine Libere, Letteratura - Tradizione, La Meta Sociale e Area, ma anche con diversi quotidiani come Il Tempo, Lo Specchio e Vita.
Giano Accame è stato considerato, insieme a Piero Buscaroli, Fausto Gianfranceschi, Franco Cardini, Gianfranco de Turris e Marcello Veneziani, uno degli intellettuali storici della destra italiana. Accame non si ritenne mai un "fascista di sinistra", come il suo grande amico Beppe Niccolai, né tantomeno un "Bertinotti della destra", come fu definito da alcuni giornali per le sue posizioni "eretiche" e "scomode", considerandolo una perniciosa macchietta. Accame ha sempre pensato che tradizione e patria non dovessero essere pretesti, ma ideali veri da rendere concreti con l'azione politica. Quando vennero fuori i documenti del "golpe bianco" del partigiano liberale Edgardo Sogno, alla metà degli anni Settanta, Accame risultava in predicato come ministro della Pubblica istruzione. "Vanterie di una persona anziana che voleva stupire. Sogno era intelligente, simpatico, coraggioso. Ma era il birichino di mamma"', dichiarò Accame nel 2004 in un'intervista a Claudio Sabelli Fioretti per Sette del Corriere della Sera. Allo stesso giornalista che gli ricordava le definizioni date di lui come "terzomondista, anticapitalista, antiamericano", Accame rispose: "Sono solo venature".
Il sindaco di Roma Alemanno:
''Per me è veramente una scomparsa gravissima perché è stato un maestro''. ''E' stato un intellettuale di grandissimo spessore che ha attraversato tutta la storia del dopoguerra con posizioni sempre molto ricche e significative, uno dei grandi maestri della cultura di destra''.
La camera ardente, allestita presso la sua casa-studio in Lungotevere dei Mellini 10 a Roma, verrà aperta questo pomeriggio a partire dalle 15. I funerali si svolgeranno sabato.
00:40 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, non conformisme, pensée rebelle, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Giano Accame : pensiero scomodo

Giano Accame, pensiero scomodo
14 maggio 2001
Puntata realizzata con gli studenti del Liceo Classico "Umberto I" di Napoli"
STUDENTESSA: Ringraziamo Giano Accame per essere qui con noi. Prima di dare avvio alla discussione guardiamo la scheda filmata.
Pensieri scomodi, pensieri inquietanti, pensieri di difficile collocazione, attraversano, come ombre, il corso del secolo che è appena trascorso. Un secolo dove la massa si è fatta protagonista e il conformismo, l'automatismo mentale, l'inerzia, il torpore, sono diventati condotta comune, norma di comportamento. Il secolo dei grandi totalitarismi sicuramente è anche il secolo dell'indottrinamento di massa, ma, paradossalmente, è anche il secolo degli antagonismi, delle ribellioni, è il secolo in cui scrittori e pensatori, spesso solitari, emarginati, talvolta sconfitti dalla storia, conducono "esperimenti temerari" o semplicemente portano il peso di una "intelligenza scomoda", refrattaria a ogni conformismo. È il caso, ad esempio, dello scrittore tedesco Ernst Junger, una delle grandi figure della letteratura del Novecento. In età più che matura, all'inizio degli anni Cinquanta, Junger teorizza il comportamento del ribelle, al quale, "per sapere che cosa sia giusto, non servono teorie o leggi escogitate da qualche giurista di partito". Il ribelle "attinge alle fonti della moralità ancora non disperse nei canali delle istituzioni". Il ribelle rifugge da ogni ordine costituito, non appartiene più a niente, ha varcato una volta per tutte il meridiano delle opinioni comuni. Pensatore scomodo è dunque Junger, come d'altra parte scrittore scomodo è stato Louis-Ferdinand Céline, definito "veggente del tramonto dell'Occidente". Poeta scomodo è Ezra Pound, una delle voci più alte della poesia del Novecento e uno dei critici più feroci della vita degradata, misurata dal denaro e dalla prestazione. E scrittore scomodo Yukio Mishima, la cui "intelligenza scomoda" si esprime nella ricerca della bellezza e nella fedeltà alla propria tradizione. Ma ogni ricerca ha il suo prezzo: Mishima muore suicida nel 1970.
STUDENTESSA: Possiamo arrivare a definire una "intelligenza scomoda"? Cioè quali sono i suoi tratti distintivi?
ACCAME: Questa espressione, "intelligenze scomode", viene da una trasmissione di Rai Educational dedicata a scrittori, intellettuali e artisti di destra, ma più che di destra, o fascisti, o accusati di fascismo, persone che sono state una parte ineliminabile, importante, del pensiero del Novecento; e che appartengono ormai non solo a una parte, ma al genere umano. Non si potrebbe fare a meno, nella letteratura italiana, di Gabriele D'Annunzio, anche se a Fiume ha creato la ritualità del fascismo, i saluti, il discorso dal balcone. La filosofia italiana non potrebbe fare a meno del più grande filosofo accademico del Novecento, Giovanni Gentile. L'arte italiana non potrebbe fare a meno del futurismo, anche se Marinetti è stato fascista. Il futurismo è stato, dopo il Barocco, la prima volta che l'arte italiana ha avuto di nuovo una dimensione universale. E così la cultura del mondo non potrebbe più rinunciare a Ezra Pound, che è stato il grande innovatore del modo di fare poesia in lingua inglese, o di Céline, che ha cambiato completamente, rinnovato, il modo di fare prosa narrativa, o di Carl Schmitt, che è stato il più grande politologo del secolo scorso.
STUDENTESSA: Secondo Lei, quali sono i rischi, i pericoli, che una "intelligenza scomoda" corre al giorno d'oggi, e quali sono stati quelli dell'anticonformismo nel secolo appena passato?
ACCAME: Ad esempio, tra i rischi dell'anticonformismo, è esemplare la vita tormentata di Ezra Pound, che per essere stato vicino al fascismo e soprattutto alla repubblica sociale italiana, fu poi chiuso dai suoi concittadini americani in una gabbia, come una bestia, in un campo di concentramento a Pisa e poi confinato per tredici anni in un manicomio criminale negli Stati Uniti. Questa idea di curare le dissidenze come una forma di disturbo mentale non è stata adottata prima nell'Unione Sovietica, ma per prima in America. Non accettandosi l'idea che il più grande poeta americano fosse simpatizzante del fascismo, lo si è fatto passare per matto.
STUDENTE: Al di là del nostro secolo, come può manifestarsi oggi una "intelligenza scomoda"? E cosa vuol dire, nella nostra società, andare contro l'opinione comune?
ACCAME: È sempre una posizione rischiosa e naturalmente scomoda. Non lo è stata nella prima metà del secolo, dove il pensiero fascista è stato dominante in quasi tutta l'Europa, ma nella seconda metà del secolo queste forme di cultura sono state emarginate e quindi, tra l'altro, si sono rarefatti gli intellettuali che vi hanno aderito. Il massimo della scomodità oggi è nel ribellarsi alla pretesa del denaro, dei poteri finanziari, e di porsi come elemento principale della scelta politica. Oggi viene teorizzato dalla migliore cultura economica, quella che viene dalla Banca d'Italia in Italia, la compresenza di due elettorati: uno siamo noi, sarete Voi, quando ci arrivate, a diciotto anni, il popolo sovrano, quello che vota per dei deputati e dei senatori, che contano sempre di meno. E l'altro invece è il grande elettorato del mercato finanziario, che, si dice, ormai vota tutti i giorni in casa nostra, facendo salire o scendere le quotazioni della lira e della borsa, a seconda che il Parlamento e i governi si comportino bene, cioè secondo le indicazioni del mercato finanziario, oppure si comportino male. Se spendono troppo per i pensionati o gli ammalati, la lira cade. Ecco, ribellarsi a questo grande potere internazionale è certamente scomodo, perché la maggior parte degli organi di informazione importanti sono nelle mai del potere finanziario, e quindi liberissimi nel criticare i poteri politici, molto meno nel criticare i poteri economici. I grandi giornali, le televisioni, sono un po' delle pistole puntate alla tempia dei poteri politici, che devono adeguarvisi.
STUDENTE: Non pensa che sia il pericolo ad impedire l'esercizio dell'anticonformismo? E ancora: è forse per paura che ci si adegua all'opinione comune?
ACCAME: Per la verità l'anticonformismo oggi non viene impedito. Viviamo in un periodo di piena libertà, soltanto che nessuno gli dà poi retta. Diceva Ezra Pound che la libertà di parola, senza la libertà di esprimersi via radio, non vale nulla. Questo lo diceva quando non esisteva ancora la televisione. Se uno scrive, ma non arriva a esprimersi attraverso il nuovo grande mezzo di comunicazione, parla a vuoto, o parla a delle piccole minoranze. Non credo che oggi vi siano motivi di paura. Il grande vantaggio di essere usciti dai due secoli di cultura delle rivoluzioni, con la caduta del Muro di Berlino, che nessuno ha più legittimo motivo di avere paura per la vita, per la libertà, per i beni, di fronte a qualunque scelta politica. Il potere non fa paura. Il potere però può emarginare, è naturale insomma. Quindi esiste, è legittimo, anche per gli intellettuali, il timore, la paura di essere isolati, di essere emarginati, di non contare niente, quindi di non guadagnare. Ecco, questo è. Ridimensionando il timore, è lì oggi il vero nemico dell'anticonformismo, quello che spesso vengono reclamizzate sono forme di anticonformismo banale, ma quello più serio viene ancora ghettizzato.
STUDENTESSA: Recentemente ho visto un film, L'ultimo bacio, di Gabriele Muccino, e uno dei personaggi dice: "La normalità è la vera rivoluzione". Lei cosa ne pensa?
ACCAME: La rivoluzione è cambiamento, mentre la normalità è stabilizzazione. La grossa difficoltà nel rapporto tra gli intellettuali e la politica è che, soprattutto in periodo democratico di elezioni, la politica si muove appunto sulla normalità. La politica deve usare argomenti accessibili al grande pubblico, quindi argomenti ormai banalizzati. Mentre il compito dell'intellettuale è quello di spingersi oltre, di dire delle novità; il compito più difficile, insomma. Ma la normalità non è la vera rivoluzione. La vera rivoluzione è il cambiamento. La vera rivoluzione è stata - adesso ormai questo periodo di due secoli è finito - l'ambizione delle filosofie a inverarsi nella storia. Un tempo ci si accontentava che le filosofie spiegassero il mondo. Da Marx a Gentile, che ha ripreso questa filosofia della prassi di Marx, invece si aggiunge o si era aggiunta una nuova pretesa, che la filosofia non solo spiegasse il mondo, ma che lo cambiasse. Ecco, la normalità non ha questa pretesa di cambiamento. La normalità di solito si adegua e non penso che possa essere rivoluzionaria.
STUDENTESSA: Nella scheda filmata abbiamo visto che gli scrittori e i pensatori citati sono tutti critici della democrazia occidentale. Ora l'atteggiamento antidemocratico può identificarsi con l'anticonformismo?
ACCAME: Certamente! Perché quelli anticonformisti sono atteggiamenti di minoranza, che quindi spesso si rivoltano, o si sono rivoltati in passato contro la democrazia. In realtà né Pound né Junger si sono particolarmente rivoltati contro la democrazia. Se mai solo Mishima, che è un curioso esempio di fascismo di ritorno, o di tradizionalismo di ritorno. Durante la guerra Mishima fu scartato alla leva e ne fu contentissimo perché si risparmiava la vita. Diventò lo scrittore giapponese più noto in Occidente, e di solito in Italia tutti i suoi primi libri sono stati pubblicati da Feltrinelli, quindi anche molto gradito alla sinistra. Omosessuale, o almeno bisessuale, quindi trasgressivo, su un piano che il pensiero conservatore è meno orientato a accettare. E tuttavia, dopo aver riscosso successo internazionale e in Giappone naturalmente, a un certo punto ha sentito la vanità di questo successo e ha avuto un ritorno di pensiero conservatore, tradizionale ed è ritornato all'antica etica dei Samurai, sino a compiere il sacrificio rituale in una caserma giapponese, per protestare contro l'occidentalizzazione del Giappone e soprattutto contro l'asservimento dell'attuale classe politica giapponese agli americani. Ecco, quindi è l'unico, se mai, che si è ribellato a quel tipo di democrazia asservita. In realtà tutti poi dopo hanno fatto riferimento al popolo. In particolare Ezra Pound era fortemente critico del sistema politico americano, ma non perché fosse antidemocratico. Lui seguiva le idee di Jefferson, che è tra i creatori della democrazia americana, ma accusava la classe dirigente democratica americana di essersi asservita ai banchieri, di essersi asservita al grande capitale finanziario e di aver quindi tradito la stessa Costituzione degli Stati Uniti, che riservava al Congresso la sovranità monetaria e invece questa sovranità era stata trasferita ai banchieri. Questo era più legato alla vera idea dei pionieri americani. Si considerava infatti un vero patriota americano, in rivolta contro il tradimento della democrazia fatta delegando troppi problemi e troppi poteri alla finanza.
STUDENTE: Non crede che l'anticonformismo sia possibile solo in democrazia, e che invece il totalitarismo non sopporti le intelligenze scomode?
ACCAME: Certamente è più facile in democrazia che nei totalitarismi. E tuttavia anche nei sistemi totalitari ci sono stati esempi di rivolta, di ribellione, che naturalmente sono costati di più. Io, come scrittore di destra, la libertà in questo mezzo secolo ho dovuto più faticosamente conquistarmela, giorno per giorno. A me non l'hanno regalata gli americani, insomma, non mi è stata importata. L'ho dovuta conquistare vincendo pregiudizi, difficoltà, tentativi di discriminazione. E quindi qualche difficoltà la si incontra anche in un sistema di piena libertà.
STUDENTE: Si può, paradossalmente, seguire la legge ed essere comunque scomodi? Pensavo, ad esempio, al Giudice Falcone.
ACCAME: Certamente! Ma il Giudice Falcone era scomodo per la delinquenza, per la grande criminalità organizzata. Non direi che sia un esempio di anticonformismo. È un esempio di eroismo, come quello del Giudice Borsellino, come quello delle forze dell'ordine quotidianamente impegnate nella difesa delle persone per bene, degli onesti, contro la grande criminalità. Ma non direi che questo sia un esempio di anticonformismo. Per quanto, lì dove la società è addormentata, dove esistono complicità tra poteri politici e grandi organizzazioni mafiose, anche questo, il coraggio di rivoltarsi, rischiando la pelle, può, a suo modo, essere interpretato come un anticonformismo. L'egoismo, il rischiare la vita, è sempre impresa di pochi. L'eroe è di per sé uno che si stacca dalla media, dalla normalità, e in questo si può considerare non perfettamente conformista. Non è uno che si fa i fatti suoi e pensa solo alla famiglia. Pensa alla Patria, alla generalità dei cittadini.
STUDENTESSA: Secondo Lei l'intelligenza scomoda è capace solo di demolire e criticare, o è in grado anche di costruire e affermare?
ACCAME: L'intelligenza scomoda vorrebbe anche costruire e affermare. In realtà, dalla lezione dei fascismi è venuto qualcosa che oggi, a livello debole, è estremamente diffuso. Cosa ha fatto il successo politico di Mussolini, ad esempio? È stato il ribellarsi a quella spaccatura, che è nel cuore dell'uomo e della società europea, che aveva provocato la presunzione illuministica, contrapponendo alla tradizione il progresso, contrapponendo alla fede la ragione e la scienza, e, poi il socialismo, contrapponendo alla aspirazione e alla giustizia sociale l'idea di Dio e della Patria. Il successo di Mussolini è stato quello di risaldare queste spaccature e legando e rendendo compatibile, con un'aspirazione alla giustizia sociale, l'idea di Dio e della Patria. Naturalmente poi gli errori hanno compromesso questo tentativo, che aveva suscitato tanti entusiasmi, aprendo nuovi conflitti: conflitto razziale, la discriminazione degli ebrei, e aprendo un conflitto sui temi della libertà. Ma questa idea di risaldare, di non spaccare le masse, sui temi di Dio e della Patria, e spingere il progresso delle masse, unificando questi sentimenti forti, oggi è condivisa da tutti. Nel socialismo italiano è stato Bettino Craxi che ha cercato di sanare queste imprudenti e stupide spaccature, queste fratture. Ha fatto un nuovo Concordato con la Chiesa, ha riscoperto il socialismo tricolore. Ma non c'è forza politica importante, sono solo marginali quelle che non abbiano il pieno rispetto del sentimento religioso e che rinneghino l'aspirazione, oggi più debole, all'identità nazionale. Questo è ormai da destra a sinistra. Tutte le volte che un'idea si affaccia, si affaccia di solito con violenza e con forza, mentre adesso, anche a livello di pensiero debole, tutti condividono questa aspirazione unificante di quelle che sono le grandi tendenze dell'uomo.
STUDENTESSA: Noi finora abbiamo parlato solo di anticonformismo. Ma cosa si intende e come si esprime il conformismo oggi?
ACCAME: Il conformismo, secondo me, si esprime soprattutto nell'economicismo, nell'assegnare, come obiettivo esistenziale e principale, l'idea dell'arricchimento. E questo porta a delle gare che possono essere addirittura distruttive per il genere umano, perché è probabile che l'assetto ecologico della terra non possa resistere a ulteriori progressi, a ulteriori escalation in questa ricerca del benessere e dello spreco. Un tempo ci si accontentava più facilmente della propria condizione economica e si cercava la gratificazione nel far bene certe cose. Il medico condotto non voleva arricchirsi, ma curare, il professore era completamente dedito al proprio lavoro di educatore e non era scontento, i servitori dello Stato e gli ufficiali peroravano la grandezza della nazione. E, comunque, chiunque faceva la propria professione, o il proprio lavoro, o il proprio mestiere di artigiano, di operaio, tendeva a trovare la gratificazione nell'esistenza e in altri valori oltre che quelli monetari. Oggi la ricerca dell'arricchimento, l'economicismo, spegnendo altre aspirazioni dell'uomo, altre tendenze, esprime una forma di conformismo che considero pericolosa.
STUDENTE: Non pensa che il prezzo da pagare all'anticonformismo sia l'individualismo?
ACCAME: No, se mai proprio il conformismo di oggi è l'individualismo. Ci si lamenta, dopo la caduta del Muro di Berlino, della affermazione planetaria della formazione di un pensiero unico, che è il pensiero liberale individualista. E c'è addirittura una forma quasi di intolleranza liberal-liberista. Se mai, l'anticonformismo oggi si dovrebbe manifestare in un ritorno al pensiero comunitario, all'idea di sentirsi insieme, all'idea della società a cui aderire e da servire.
STUDENTESSA: Secondo Lei, si può essere anticonformisti nel rispetto dell'opinione comune?
ACCAME: L'anticonformismo e l'opinione comune di solito sono in conflitto. L'anticonformista è proprio contro l'opinione comune. Però ci può essere una forma di anticonformismo del conformismo, nel senso che spesso gli intellettuali ostentano forme di disprezzo del senso comune. E allora aderire al senso comune rappresenta in qualche modo una forma di anticonformismo. Il coraggio di pensarla un po' come tutti, perché questo tipo di pensiero viene snobbato.
Puntata registrata il 21 febbraio 2001
00:35 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, droite, politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, non conformisme, pensée rebelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 17 avril 2009
Le M.A.U.S.S.: Qu'est-ce que l'utilitarisme?
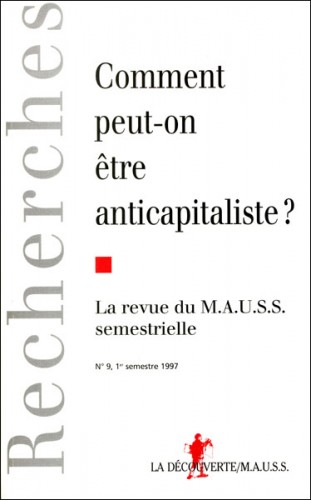
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Le M.A.U.S.S.: «Qu'est-ce que l'utilitarisme?»
La revue semestrielle du M.A.U.S.S. consacre son n°6 à «Qu'est-ce que l'utilitarisme? Une énigme dans l'histoire des idées». Elle le présente ainsi: «Depuis près de deux siècles, dans les pays de tradition anglo-saxonne, l'utilitarisme a constitué la philosophie morale et juridique de base. A ce titre, il a suscité de nombreux débats. Rien de tel en France où, depuis la grande thèse d'Elie Halévy, La Formation du radicalisme philosophique (1903), l'utilitarisme était oublié et ignoré. Toutefois, depuis quelques années, les philosophes et les chercheurs en sciences sociales relancent le débat sur l'utilitarisme. A en croire Halévy et la quasi-totalité des commentateurs de l'époque, le fondateur de l'utilitarisme est Jeremy Bentham (1748-1832): sa doctrine reposerait sur l'hypothèse que les sujets humains doivent être considérés comme des égoïstes calculateurs et rationnels. Pas du tout, rétorquent nombre d'interprètes contemporains: non seulement J. Bentham ne postule nullement le caractère dominant des motivations égoïstes, mais, en adoptant comme critère du juste et du bien la maximisation du bonheur du plus grand nombre, il plaide au contraire pour l'altruisme. On ne saurait rêver lectures plus radicalement opposées. Ce numéro de la Revue du M.A.U.S.S. semestrielle présente donc les diverses interprétations et suggère deux manières originales, et de surcroît probablement justes, de résoudre l'énigme. Pour la première, loin d'inventer l'utilitarisme, Bentham est celui qui achève une certaine tradition utilitariste vieille de plus de deux mille ans. Pour la seconde, cette tension insoluble entre égoïsme et altruisme est précisément ce qui caractérise l'utilitarisme moderne et post-benthamien amorcé par John Stuart Mill» (PM).
Editions La Découverte/La Revue du MAUSS, 9 bis rue Abel-Hovelacque, F-75.013 Paris, 290 p., 160 FF.
00:05 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, utilitarisme, anti-utilitarisme, économie, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 08 avril 2009
Eléments pour une "pensée-monde" européeenne

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Université d'été de la F.A.C.E. - 1995
Résumé des interventions
Eléments pour une «pensée-monde» européenne
(Intervention de Louis Sorel)
I. Dans quel monde vivons-nous?
Notre monde prétend refléter un «Nouvel Ordre Mondial» (NOM); pour les uns, il doit être américain, pour les autres “onusiens”. Le NOM américano-centré risque de devenir très vite une pure fiction, puisque les Américains font passer leurs problèmes domestiques avant les affaires internationales. L'internationalisme américain actuel est sélectif, dans le sens où il évite les “bourbiers”. En cas d'intervention, les USA frappent et se retirent, abandonnant ainsi le statut de puissance hégémonique pour prendre celui de puissance “prédatrice”. Quand au NOM onusien, il se recentre sur un discours “humanitaire” et se réserve le traitement des “bourbiers”.
Le monde ne vit donc pas sous un “ordre” mais dans un “désordre”: on parle de “Nouveau Désordre Mondial” (NDM). Ce NDM est une phase d'ajustement que les théoriciens du NOM prévoient pour une période de 20 à 25 ans.
Le monde actuel est caractérisé par l'interdépendance et l'interaction. Le Général Poirier utilise la notion de système-monde multipolaire et polycentrique, se déployant au sein d'un mouvement général de territorialisation. Ce monde comporte des “acteurs-Etats” et des “acteurs non étatiques”: il est donc chaotique et imprévisible. Ce monde est privé de sens, les grandes idéologies universalistes s'y essoufflent, alors que la “guerre froide” a été un affrontement idéologique pour l'appropriation du sens. Chacune des deux grandes puissances avait leur télos. La fin de la guerre froide (entre 1989 et 1991) a d'abord été interprétée comme la fin du communisme; en fait, c'est une déconstruction idéologique générale. De l'euphorie, on est passé au désenchantement.
II. Un monde oligo-polaire.
Une tendance prévaut: l'émergence de macro-régions sur la planète, de régions planétaires.
Exemples:
1. L'Union Européenne:
C'est le projet le plus ambitieux; ce n'est pas seulement une zone de libre-échange depuis 1957 mais, c'est un espace évoluant depuis 1992 vers une union monétaire et politique. C'est un ensemble spatial qui a vocation à s'élargir.
2. L'ALENA (depuis 1992):
C'est un projet modeste de libre-échange avec une monnaie commune: le dollar. Il a vocation à s'étendre à l'Amérique du Sud.
3. L'Aire de Co-Prospérité (Japon, Indonésie,...)
La Chine en est exclue. Il se construit sur un mode informel.
Ces trois pôles forment la “Triade”. Cette représentation laisse de côté l'ensemble Russie-CEI, la Chine et le Brésil. Le mouvement de “régionalisation” s'accompagne d'affrontements économiques. D'où la vogue du concept de “géo-économie”. La mondialisation n'a pas aboli la géographie. L'espace économique n'est pas un bloc. On vit dans ce qu'on appelle un archipel-monde, mais il n'est pas exclu que l'on aille progressivement vers un monde de blocs politico-économiques.
La théorie des “grands espaces” (Großräume) de Carl Schmitt, élaborée à partir de 1939, lors d'une conférence d'universitaires à Berlin, était, au départ, une critique du wilsonisme, de l'universalisme américain. Schmitt prônait un nouvel ordonnancement du monde et un équilibre entre grands espaces. Ces unités de puissance devaient, selon lui, être politiquement autocentrées et régulées.
III. Eléments pour un Grand Espace Européen (GEE):
1. Délimitation du GEE:
Ces limites ont fluctué au cours de l'histoire (Charlemagne, Napoléon, De Gaulle,...). Voir aussi les configurations institutionnelles de l'Europe (CEE, CSCE/OSCE, Conseil de l'Europe, COCONA, OTAN, UEO,...). Le Sommet d'Essen a ouvert des perspectives d'ouverture pour l'Union Européenne, qui a bien entendu vocation à s'élargir. Maastricht a réduit l'identité européenne aux quatre “D” (démocratie, dialogue, développement, droits de l'homme), vus dans une optique universaliste et non pas particulière et adaptée à l'Europe et à son histoire.
Sur le terrain, il y a deux cas qui posent problème pour déterminer les limites de l'Europe: la Russie et la Turquie.
2. L'Organisation politique du GEE:
Deux conceptions sont en lice:
a) L'Europe confédérale ou l'Europe des patries;
b) L'Europe fédérale ou l'Europe supranationale. Cette Europe fédérale n'a pas vu le jour quand a été rejetée la CED (défense) en 1954. Aujourd'hui on reste toujours dans l'optique confédérale. Il ne s'agit pas de faire de l'Europe un Super-Etat, le seul modèle qui lui convient, c'est le concept d'Empire au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire une association hétérogène d'ethnies, de cultures que l'on n'a pas la prétention de niveler et d'homogénéiser. L'Empire est fondé sur l'allégeance.
3. Un modèle de sécurité pan-européen:
Il faut se référer au réseau des systèmes de sécurité existants en Europe (des schémas clairs et didactiques sont parus dans Le Monde du 23 juin 1992): CSCE/OSCE, OTAN, COCONA, CEI. Il y a concurrence entre la CSCE et l'OTAN (avec ses émanations); de même, entre l'OTAN et l'UEO sur le plan de la défense. François Mitterand a dit un jour: «On a besoin d'une nouvelle théorie des ensembles». Ce qui est exact. Les Etats-Unis essayent par tous les moyens de pousser l'OTAN, qui est leur instrument majeur au niveau de l'Europe.
Dans cet imbroglio, quel est notre choix, minimal dans un premier temps? Développer l'OSCE où l'emprise des Etats-Unis est moindre et qui accorde toute sa place à la Russie, sans la marginaliser. Exiger le retour à une Alliance Atlantique rénovée, dégagée de la trop forte tutelle des Etats-Unis. Promouvoir l'Union de l'Europe Occidentale. Comme la Russie refuse l'élargissement de l'OTAN, élargir l'UEO aux pays d'Europe centrale et orientale. Clarifier les rapports entre l'Union Européenne et l'UEO.
Conclusion:
- La mondialisation n'implique pas obligatoirement le mondialisme.
- La mondialisation est plutôt une macro-régionalisation.
- On peut considérer que le climat international est beaucoup plus porteur qu'auparavant.
- L'enjeu: faire de l'Europe un ensemble légitime en recouplant sens et puissance.
- Faire prévaloir la logique politique sur la logique économique.
Notre travail intellectuel de projectualisation de l'Europe est entré dans une phase beaucoup plus constructive.
(Résumé d'Etienne LOUWERIJK).
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, politique internationale, monde, stratégie, europe, conflits |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 07 avril 2009
Le communautarisme américain

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Université d'été de la F.A.C.E. - 1995
Résumé des interventions
Le communautarisme américain
(intervention de Robert Steuckers)
Le communautarisme américain d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout le débat entre sociologues visant à réhabiliter la notion de “communauté” aux Etats-Unis, est une réponse tardive au néo-libéralisme et une redécouverte des liens communautaires. Conscients de la faillite et de l'impasse que sont l'individualisme et le collectivisme, les sociologues de la “nouvelle gauche” cherchent désormais à restaurer la logique communautaire. La plupart de ces nouveaux “communautariens” américains tâtonnent: ils tentent de vulgariser et d'adapter un discours qui a été parfaitement “scientificisé” en Europe avec Otto von Gierke, Ferdinand Tönnies (Communauté et société) et François Perroux. Mais cet héritage précieux de la sociologie avait été refoulé au profit de conceptions très “sociétaires” ou très “technocratiques” des agrégats humains. Les sociologues américains de la tradition “communautarienne” aujourd'hui émergente ont constaté, devant la déliquescence des villes américaines, devant la criminalité galopante, que leur société basculait dans l'anomie totale, vu la disparition de tous les référents sous les coups de l'hyper-modernité.
D'où le triple constat de cette nouvelle école sociologique et philosophique:
1) Les Etats-Unis sont une société sans référents, parce qu'elle est une société d'immigrés qui ont rompu avec leurs traditions ancestrales, sans en avoir reconstruit d'autres;
2) Or les Etats-Unis veulent être une société pleinement démocratique; mais une démocratie n'est viable que s'il existe au préalable des vertus civiques, c'est-à-dire une sorte de bloc d'idées incontestables, impliquant des droits et des devoirs. Les vertus civiques réclamées par toute démocratie saine sont l'avatar contemporain de la virtus des Romains, de la virtù de Machiavel et de la vertu de Montesquieu.
3) Pour que ces vertus civiques demeurent vivantes, dynamiques, adaptables aux circonstances, il faut que demeurent les liens, valeurs et comportements traditionnels; d'où la notion d'un “progrès” —qui effacerait définitivement ces legs irrationnels du passé pour qu'advienne un bien définitif, rationnel, raisonnable et épuré— n'est plus défendable.
C'est sur base de ce triple constat que la sociologie récente aux Etats-Unis lance un appel aux citoyens pour qu'ils renouent avec leurs traditions, mais cet appel demeure assez vague et imprécis quand on le compare à la profondeur d'analyse d'un Tönnies ou d'un Perroux. Nous préférerions retourner à la rigueur de Tönnies et de Perroux, mais cette rigueur n'est plus directement accessible, même en milieu académique, c'est pourquoi nous sommes contraints en pratique de revenir dans le débat sur la “communauté” par cette “petite porte” —la seule qui ne soit pas condamnée— qu'est le communautarisme américain actuel.
Autre aspect intéressant de ce débat: il permet de dépasser le paralysant clivage “gauche/droite”, étant donné, justement, que les “communautariens”, s'ils viennent en majorité de la “gauche”, viennent aussi assez souvent d'une droite “axiologique” ou “aristotélo-thomiste”. Le communautarisme permet de rassembler tous ceux qui s'opposent au libéralisme radical, à l'hyper-individualisme et au culte de l'argent, revenu sur l'avant-scène avec Thatcher et Reagan. A l'époque du grand avènement du néo-libéralisme, de la fin des années 70 à l'entrée de Reagan à la Maison Blanche, les théories de Hayek et des Chicago Boys avaient triomphé de celles de John Rawls, consignées dans un ouvrage célèbre à l'époque, A Theory of Justice (1979). Rawls critiquait la notion de contrat aliénant ma liberté de citoyen, déléguant mes pouvoirs naturels à une instance appelée à barrer la route au chaos (guerre civile). Pour Rawls, le fait de déléguer ainsi ses propres pouvoirs ruine les ressorts coopératifs naturels de toute la société. Pour dépasser cet effet pervers du contractualisme, il faut rendre vigueur aux normes traditionnelles, se débarrasser de cette philosophie anglo-saxonne qui estime que les normes et les valeurs découlent d'énoncés vides de sens. Le livre de Rawls provoque deux réactions: 1) Nozick et Buchanan définissent des normes toutes faites, jugées comme universellement valables et intangibles (origines néo-libérales de la political correctness); 2) il faut faire revivre les normes traditionnelles, donc redonner vie aux ressorts des communautés.
Parmi les nombreux protagonistes de ce nouveau “communautarisme”, citons Ben Barber, issu d'une gauche très activiste, engagée dans tous les combats depuis 68. Ben Barber oppose très justement le libéralisme à la démocratie. Le libéralisme signifie l'anarchie sociale, l'effilochement des tissus séculaires, la fin des institutions stables de la société (mariage, famille, etc.), l'anomie. La démocratie, si elle est forte, implique la participation, donc des agrégats humains aux ressorts naturels intacts, capables de s'adapter en souplesse à tous les contextes et à tous les coups du sort. Restaurer une démocratie forte, contre les effets dissolutifs du libéralisme, signifie accroître la participation des citoyens à tous les niveaux de décision, réactiver la citoyenneté. En effet, le libéralisme, issu du contractualisme, est une “démocratie faible”, dans le sens où il participe d'une épistémologie “newtonienne”, où le simplisme géométrique est de rigueur; le libéralisme est cartésien, dans le sens où il est déductif et où il ne considère comme pleinement citoyens que ceux qui adhèrent religieusement à quelques vérités abstraites, alors que le “communautarisme” est amené à définir le citoyen comme le ressortissant d'un Etat qui a une histoire particulière et a déployé des valeurs spécifiques, particularités et spécificités qui fondent justement la concrétude de la citoyenneté. Le libéralisme postule un homme dépolitisé (qui a délégué ses pouvoirs potentiels à une instance supérieure), ce qui est une aberration aux yeux de l'ancien militant gauchiste Ben Barber. Il faut donc opérer un retour à la Polis antique, où le citoyen se situe dans une histoire, où il intervient et participe. Le libéralisme, soit la “démocratie faible”, génère des pathologies: atomisation sociale, chaos, anomie, expédiant de la dictature, passivité des citoyens. Une démocratie réelle, soit une démocratie forte, commencent par des “assemblées de voisins” (5000 citoyens décrète Barber), reliées entre elles par des “coopératives de communication” (rendues possibles par les progrès en télécommunications). Ben Barber propose ce modèle pour les Etats-Unis, société où aucune tradition ne subsiste et où aucune tradition particulière ne peut s'imposer à la majorité. D'autrs communautariens parle de “faire éclore partout des sphères de justice”. Un débat passionnant que les “Bons Européens” doivent brancher sur les legs communautaires de leurs propres histoires et sur l'appareil conceptuel que nous lèguent Otto von Gierke, Tönnies et Perroux.
(résumé de Catherine NICLAISSE).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, politologie, sciences politiques, théorie politique, etats-unis, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 avril 2009
Arthur Moeller van den Bruck

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Il y a 70 ans mourrait Arthur Moeller van den Bruck
«C'est une question que vous adressez au destin de l'Allemagne, lorsque vous me demandez qui fut Arthur Moeller van den Bruck», déclarait sa veuve Lucy en 1932, dans le seul et unique interview qu'elle a accordé pour évoquer la mémoire de son mari. En effet, la vie de Moeller van den Bruck, le protagoniste le plus significatif de la Révolution Conservatrice de l'entre-deux-guerres, reflète parfaitement l'esprit du temps. Mais si son époque l'a marqué, il l'a marquée tout autant. Le Juni-Klub qu'il avait fondé avec Heinrich von Gleichen en 1919 quand il devinait l'effondrement du Reich, la révolution spartakiste et les affres du Diktat de Versailles, devait devenir la cellule de base d'un mouvement “jeune-conservateur”. Un an plus tard, le Juni-Klub déménage et se fixe au numéro 22 de la Motzstraße à Berlin, pour déployer de nouvelles activités. Outre les soirées de débat, le Juni-Klub s'empressa de mettre sur pied un “collège politique” pour parfaire la formation politique des “nationaux”. En 1923, le Juni-Klub acquiert le droit de décerner des diplômes reconnus par l'Etat et entame une activité journalistique intense. Finalement jusqu'à 50 journaux importants ou revues au tirage plus restreint ont été chercher leurs éditoriaux ou leurs bonnes feuilles dans les locaux de la Motzstraße. Dans tout le territoire du Reich, ces structures de formation et de publication se multiplient et se donnent un nom, Der Ring (= L'Anneau), qui symbolise le mouvement national naissant, quadrillant le pays.
Le périodique le plus significatif des Jeunes-Conservateurs fut Gewissen, une revue rachetée en 1920, dont la forme fut entièrement remodelée par Moeller. La revue a tout de suite suscité un grand intérêt et a eu les effets escomptés, comme l'atteste une lettre de Thomas Mann à Heinrich von Gleichen (1920): «Je viens de renouveler mon abonnement à Gewissen, une revue que je décris comme la meilleure publication allemande, une publication sans pareille, à tous ceux avec qui je m'entretiens de politique». Moeller était véritablement le centre de toutes ces activités. En écrivant des brochures et d'innombrables articles, il façonnait le mouvement, lui donnait son idéologie, ses lignes directrices. Mais sa forte personnalité jouait un rôle tout aussi intense, rassemblait les esprits. Pourtant, jamais il n'écrivit de grande œuvre politique, mis à part des ouvrages de référence indispensables, comme Das Recht der jungen Völker [= Le Droit des peuples jeunes] (1919), puis l'ouvrage collectif écrit de concert, notamment avec Heinrich von Gleichen et Max Hildebert Boehm, et destiné à devenir la base d'un programme “jeune-conservateur”, Die Neue Front [= Le Front Nouveau] (1922) et, bien sûr, le plus connu d'entre tous ses livres, Das Dritte Reich (1923). Bien entendu, ce titre fait penser, par homonymie, au “Troisième Reich” des nationaux-socialistes, ce qui a nuit à la réputation de l'auteur et du contenu de l'ouvrage. Pourtant, Moeller émettait de sérieuses réserves à l'endroit de Hitler et de la NSDAP. Malgré son opposition, Hitler put parler un jour à la tribune du Juni-Klub en 1922, mais Moeller en tira une conclusion laconique, négative: «Ce gaillard-là ne comprendra jamais!». Après le putsch de Munich, Moeller commenta sévèrement l'événement dans Gewissen: «Hitler a échoué à cause de sa primitivité prolétarienne».
Le mouvement jeune-conservateur
L'influence prépondérante de Moeller van den Bruck peut parfaitement se jauger: en 1924, quand une grave maladie le frappe et le contraint à abandonner tout travail politique, les structures mises en place se défont. Le 27 mai 1995, après plusieurs mois de souffrances, Moeller met volontairement un terme à ses jours. Ce sera Max Hildebert Boehm qui prononcera le discours traditionnel au bord de sa tombe: «Le chef, le bon camarade, l'ami cher, auquel nous rendons aujourd'hui un dernier hommage, est entré comme un homme accompli, comme un homme “devenu”, dans notre cercle de “devenants” (... trat als ein Gewordener in unseren Kreis von Werdenden)».
Pour Moeller, comme pour tant d'autres, la Première Guerre mondiale et ses conséquences ont constitué un grand tournant de l'existence. En effet, quand Moeller s'est définitivement donné au travail politique, il était déjà un homme accompli, un “devenu”. Né le 23 avril 1876 à Solingen, il avait derrière lui un cheminement aussi extraordinaire que typique. Il appartenait à une génération qui n'avait plus pu s'insérer dans la société du tournant du siècle; adolescent, il avait interrompu sa formation scolaire et s'était installé d'abord à Leipzig, où il fit la connaissance du dramaturge et poète Franz Evers, qui l'accompagnera longtemps et marquera plusieurs stades cruciaux de son existence. Ses seuls intérêts, à l'époque, étaient littéraires et artistiques. Ce jeune homme très sérieux avait un jour suscité la remarque ironique d'un auditeur: «Vous avez-vous? Le jeune Moeller a ri aujourd'hui!». En 1896, il part pour le centre de la vie intellectuelle du Reich: Berlin.
Le style prussien
C'est dans la capitale allemande qu'il épousera un amour de jeunesse, Hedda Maase, qui partageait ses passions. Plus tard, elle a rédigé un mémoire détaillé sur son époque berlinoise, où elle décrit son mari: «Il s'habillait de façon très choisie et cherchait à exprimer l'aristocrate intérieur qu'il était à tous les niveaux, dans ses attitudes, dans les formes de son maintien, dans son langage». Un héritage leur permettait de vivre sans travailler; ainsi, ils pouvaient passer beaucoup de temps dans les cafés littéraires et dans les restaurants, et discuter des nuits entières avec des hommes et des femmes partageant leur sensibilité: parmi eux, Richard Dehmel, Frank Wedekind, Detlev von Liliencorn, le peintre et dessinateur Fidus, Wilhelm Lentrodt, Ansorge ou Rudolf Steiner. Ces réunions donnait l'occasion de pratiquer de la haute voltige intellectuelle mais aussi, assez souvent, comme Moeller l'avoue lui-même, de rechercher “le royaume au fond du verre”. Avec sa femme, il traduit, dans ces années-là, des ouvrages de Baudelaire, de Barbey d'Aurevilly, de Thomas de Quincey, de Daniel Defoë et surtout d'Edgar Allan Poe. Entre 1899 et 1902, il achève un ouvrage en douze volumes: Die moderne Literatur in Gruppen- und Einzeldarstellungen.
En 1902, Moeller quitte précipitamment Berlin sans sa femme, qui épousera plus tard Herbert Eulenberg. En passant par la Suisse, il aboutit à Paris. Il y restera quatre ans, parfois en compagnie d'Evers. Il édite plusieurs ouvrages, Das Variété (1902), Das Théâtre Français (1905) et Die Zeitgenossen (= Les Contemporains) (1906), flanqués de huit volumes, écrits entre 1904 et 1910, Die Deutschen. Unsere Menschengeschichte (= Les Allemands. Notre histoire humaine). A Paris, Moeller avait fait la connaissance de deux sœurs originaires de Livonie (actuellement en Lettonie), Less et Lucy Kaerrick, et de Dimitri Merejkovski. Ces amitiés ont permis l'éclosion du plus grand travail de Moeller: la première édition allemande complète de l'œuvre de Dostoïevski. Plus tard, Moeller épouse Lucy Kaerrick. En 1906, il voyage en Italie avec Barlach et Däubler, ce qui lui permettra de publier en 1913 Die italienische Schönheit [= La beauté italienne]. En 1907, il retourne en Allemagne et accomplit sur le tard son service militaire, pour exprimer son engagement en faveur de l'Allemagne qu'il n'avait jamais cessé de manifester à l'étranger. Ensuite, il voyage encore dans tous les pays d'Europe. Quand éclate la Première Guerre mondiale, il est affecté dans une unité territoriale (Landsturm). C'est à cette époque qu'il aura plusieurs longues conversations avec un jeune juriste, Carl Schmitt. En 1916, Moellers change d'affectation: il se retrouve dans le “département étranger” de l'état-major de l'armée de terre. La même année paraît un de ses meilleurs livres: Der preußische Stil [= Le style prussien], recueil d'articles et d'essais antérieurs mais dont la portée ne s'était nullement atténuée.
Guido FEHLING.
(article paru dans Junge Freiheit, n°21/1995).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, conservatisme, années 20 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 avril 2009
Vilfredo Pareto et la circulation des élites

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Université d'été de la F.A.C.E. (juillet 1995):
Résumé des interventions
Jeudi 27 juillet 1995
Vilfredo PARETO et la circulation des élites
(Intervention d'Enrico Galmozzi, traduite par Alessandra Colla)
Cet exposé est aussi une présentation de la revue Origini, éditée conjointement par Alessandra Colla, le Centro Culturale Orion et Sinergie Europee, qui vient de sortir un gros dossier sur Vilfredo Pareto.
Si des institutions scientifiques, comme celles qui gravitent autour de la maison d'édition Droz ou des Cahiers Vilfredo Pareto, à Genève et à Lausanne, ont continué, imperturbables, à éditer Pareto et ses exégètes ou continuateurs, en Italie, un voile est tombé sur son œuvre, jugé trop “à droite”, voire “pré-fasciste”, alors que la sociologie était jugée, à tort, comme un héritage exclusif des gauches. Pareto a donc toujours été plus accusé que lu, plus cité (à partir de sources secondaires) qu'étudié. Après les décès de Raymond Aron et de Julien Freund, qui ont été ses meilleurs disciples, l'étude de l'œuvre parétienne est entrée, elle aussi, en dormition; avec la récente étude de Bernard Valade, on peut espérer son retour dans l'université française (cf. Pareto: la naissance d'une autre sociologie, PUF, 1990).
Dans le cadre de nos travaux, il est bon de rappeler quelques termes de la sociologie de Pareto:
- L'élite est la classe élue, un petit groupe qui se détermine seul, qui se montre capable d'influencer la masse, qui devient aussi, par le truchement du phénomène de la “circulation des élites” le groupe dominant au sein d'une société ou d'un Etat.
- Les résidus, sont des sentiments permanents, irrationnels, qui conditionnent les hommes individuellement et collectivement, et déterminent leurs actions non-logiques. Ce sont les traditions, les héritages, les stratifications dues à la religion, aux droits anciens, aux préjugés.
- Les actions logiques, sont des raisonnements dérivés de l'observation des faits.
- Les actions non-logiques, relèvent, elles, des résidus.
Le fondement de l'œuvre de Pareto est une critique de l'idéologie, en somme, une volonté d'arracher les masques que se donne la praxis sociale pour retrouver le fonctionnement réel de la société et l'analyser crûment, sans aucun recours aux dérivatifs idéologico-philosophiques habituels. Dans le sillage de Pareto, le terme “idéologie” a été employé dans un sens polémique: les faits réels sont recouverts par un voile de nature idéologique, qui justifie l'existence d'appareils de pouvoir qui sont souvent efficaces en phase initiale de déploiement, mais qui s'usent avec le temps, pour tomber ensuite dans une caducité problématique, enrayant la bonne marche de la société et barrant la route aux forces innovantes. Pareto veut forger une méthode d'investigation scientifique de ce processus, afin que les forces innovantes puissent disposer d'un instrument critique imparable et jeter bas les forces déclinantes avant qu'elles ne figent une société et ne finissent par la tuer. Pour Pareto, il ne s'agit pas tant de refuser a priori toutes les mystifications idéologiques, car celles-ci se justifient dans la mesure où il y a une véritable demande sociale de mystification. Mais il faut que cette mystification serve un fonctionnement optimal de la société. Si elle ne justifie plus qu'un fonctionnement caduc, elle doit disparaître au plus vite. La mystification efficace est “mythe” au sens sorélien du terme, et correspond aux besoins réels de la société, fournissant un fondement axiologique pour maintenir harmonieusement un équilibre entre la masse et les élites; la mystification déployée comme écran devant une société en déclin ou un appareil politique figé est manipulation.
La politique est donc un lieu privilégié de la fiction, une fiction qui assure un équilibre des forces en jeu entre la masse et les élites. Pareto, pessimiste, méprise la démocratie parlementaire qui oblitère les spontanéités populaires, y compris quand elle prévoit le plébiscite (qui est une action de violence masquée par la légalité). Ce mépris marque une rupture radicale avec la conception optimiste du contrat social, dominante au 19ième siècle, et avec le positivisme d'un Auguste Comte. Ce dernier pensait que l'on pouvait obtenir une connaissance rationnelle de la société, or celle-ci se développe imprévisiblement: elle est un organisme en quête d'un équilibre et, en tant que telle, elle se soustrait à tous les calculs que libéraux, optimistes, positivistes, eudémonistes, progressistes, etc. ont cru benoîtement être des lois immuables dans le fonctionnement des sociétés humaines, en tous temps et en tous lieux.
Le pessimisme de Pareto interdit les jugements de valeur simplistes. Quand une élite nouvelle renverse une élite caduque ou moisie, cela ne signifie pas qu'elle est moralement meilleure: plus simplement, elle fonctionne mieux au moment où elle accède au pouvoir. Elle incarne une rupture avec l'ancienne culture dominante et ses traditions. La théorie parétienne de la circulation des élites permet de penser un équilibre dynamique, une médiation qui, si elle est acceptée comme telle, empêche un bouleversement paroxystique et total de la société. Si les gouvernants acceptent la théorie de la circulation des élites et donc la caducité graduelle de tout pouvoir, ils coopteront et accepteront à leurs côtés les représentants des challengeurs, induisant de la sorte une rotation souple des élites. Les élites n'ont donc jamais duré au cours de l'histoire; elles ont pris le pouvoir dans leur phase de jeunesse, elles se sont usées en cours de maturité et elles ont sombré dans leur phase de vieillesse.
Pareto est toutefois inquiet en voyant s'installer le pouvoir de l'argent, la ploutocratie. L'économie omniprésente vide toutes les relations sociales de sens, elle détache les hommes de la religion, des traditions, des histoires nationales, toutes instances qui conférent du sens et à l'intérieur desquelles s'opéraient les contestations amenant les changements de pouvoir. La disparition des instances porteuses de sens va figé les processus de circulation et de rotation des élites.
(cf. Origini, n°11, textes consacrés à Pareto et édités sous la direction d'Enrico Galmozzi; disponible à l'adresse belge de “Synergies”, prix: 25 FF ou 150 FB, port compris).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, théorie politique, politologie, italie, synergies européennes, sociologie, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 29 mars 2009
Duits socialisme
Boekbespreking: Jacques Van Doorn - Duits socialisme
Duits socialisme: het falen van de sociaal-democratie en de opkomst van het nationaal-socialisme
Ex: http://onsverbond.wordpress.com/
Prof. em. dr. Jacques van Doorn (1925-2008) was in de jaren 1960 een der grondleggers van de Nederlandse sociologie en van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met het standaardwerk Moderne sociologie: een systematische inleiding uit 1959 - samen met C.J. Lammers geschreven - werd een hele generatie Nederlandse sociologen opgeleid. Hoewel het de jaren van de maakbaarheid van de samenleving waren, verloor de uit Maastricht afkomstige van Doorn geleidelijk zijn geloof in de maakbaarheidsidee en werd hij steeds meer aangetrokken door het conservatisme, dat de illusie van aardse verlossing verving door een scherp besef van de onvolkomenheid van al het menselijk streven. Die ontnuchtering had alles te maken met de utopische en populistische inslag van het studentenprotest en Nieuw Links in de jaren 1970. In 1987 ging van Doorn met vervroegd en niet geheel vrijwillig emeritaat. Dat jaar werd namelijk de door hem opgerichte opleiding Sociologie aan de Erasmus Universiteit opgeheven en de staf collectief ontslagen, omdat hij een geniepige poging van de toenmalige directeur-generaal voor het wetenschappelijk onderwijs om zichzelf een leerstoel in Rotterdam te bezorgen publiek scherp bekritiseerd had. De volgende 21 jaren ‘pensioen’ bleken zowel voor zijn intellectuele reputatie als ideologisch belangrijker dan zijn 40 academische jaren.
Politiek bewoog deze bekende hoogleraar zich van links tot rechts-conservatief. Hij schreef niet om zijn persoonlijke mening te uiten, maar analyseerde. Als columnist bij NRC-Handelsblad stapte hij in 1990 over naar de dagbladen Trouw en HP/De Tijd, nadat hij valselijk beschuldigd was van antisemitisme door NRC-Handelsblad, dat dit pas recent officieel toegaf. De laatste jaren werd hij vooral bekend vanwege zijn moedige en tegendraadse kritiek op het rechtse populisme en op fanatieke islamcritici als Ayaan Hirsi Ali, Marco Pastors, Ehsan Jami en Geert Wilders. Zijn intellectuele provocaties waren een welkom tegengeluid tegen het ongenuanceerde zwart-wit denken van de neocons en de Verlichtingsfundamentalisten. De altijd onafhankelijke geest van Doorn was daarmee een van de belangrijkste naoorlogse intellectuelen in Nederland, een land dat weinig echte vrijdenkers kent.
Het vlak voor zijn dood - op 14 mei 2008 - verschenen meesterwerk Duits socialisme: het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme beschrijft de opkomst en het verval van de sociaal-democratie in Duitsland in Fin-de-Siècle en interbellum, evenals de opkomst en machtsovername van het nationaal-socialisme. Het resultaat van een leven lang denken werd neergeschreven in dit indrukwekkende nieuwe boek. Met zijn enorme sociologische, historische en politiek-theoretische kennis onderbouwt professor van Doorn hierin de vlijmscherpe stelling dat het nationaal-socialisme een authentieke revolutie en zelfs een alternatieve vorm van socialisme was. Zonder enige twijfel vormt het de kroon op zijn veelzijdige oeuvre.
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de geschiedenis van de sociaal-democratische beweging; het tweede bespreekt de vele stromingen die in de jaren 1920 nationalisme en socialisme trachtten aaneen te smeden, terwijl het derde deel het nationaal-socialisme schetst als een vorm van socialisme.
De Duitse sociaal-democratische beweging was het vlaggenschip van het internationale socialisme. De centrale vraag in dit boek is hoe Hitler aan de macht kon komen ondanks de ongeëvenaarde organisatorische, electorale en intellectuele kracht van de SPD. Niet door een geslaagd politiek manoeuvre, zo blijkt, maar wel als resultaat van diepgaande maatschappelijke onderstromen, waarin zich twee versnellingsmomenten voordeden: augustus 1914 en november 1918, het begin en het einde van de Eerste Wereldoorlog.
De meeste historici ontkennen of relativeren het socialistisch gehalte van het nazisme. Zij doen de socialistische component in het nazisme af als een maskerade, waarmee ze de verwantschap tussen sociaal-democratie en nationaal-socialisme uit de weg kunnen gaan. Toen bijvoorbeeld de Utrechtse historicus Maarten van Rossem als student zijn scriptie wou schrijven over de tot op heden bestaande sociale maatregelen van de Duitse bezetter, werd hem dit met klem ontraden met het argument dat dit hem tot een paria in de historische wetenschap zou maken. De contemporaine historiografie schetst immers het Derde Rijk als een boosaardige misvatting in de Europese geschiedenis en als een exclusief Pruisisch-Duits verschijnsel. Jacques van Doorn toont echter de evidente verwantschap tussen sociaal-democratie en nationaal-socialisme aan. Traditioneel wijzen historici de conservatieven, de Reichswehr, de adel en de industriëlen aan als wegbereiders van Hitler. Nochtans was de NSDAP in de Weimarrepubliek zowat de enige Duitse politieke partij die níet gefinancierd werd door voornoemde groepen. De auteur wijst erop dat de arbeidersklasse nooit genoemd wordt als steunpilaar van het nazisme, maar integendeel steevast afgeschilderd wordt als een alleen door de sociaal-democratie vertegenwoordigde groep verschoppelingen, die vanzelfsprekend tot de ‘goeden’ gerekend wordt.
Dit vormt van Doorns uitgangspunt voor een verhelderende studie naar de wortels van het nazisme in de Duitse sociaal-democratie. De SPD had het in het Fin-de-Siècle immers moeilijk met zijn nationale identiteit en kampte steeds opnieuw met groepen revisionisten en dissidenten die - anders dan de marxistische partijtop - de staat, militarisme en patriottisme positief waardeerden. Naast socialistische verdedigden zij ook nationalistische belangen. Hiermee geeft van Doorn het nationaal-socialisme een verleden. De sociaal-democratische antecedenten van het nazisme werden echter tijdens de Tweede Wereldoorlog verdrongen door de orgie van vernietiging waarin het nationaal-socialisme culmineerde, hoewel Duitsland tot in de eerste oorlogsjaren zowel militair-politiek als ideologisch een voorsprong op de rest van Europa had.
De auteur toont aan dat het nationaal-socialisme noch programmatisch, noch in zijn praktische uitvoering een reactionaire kracht was, maar in tegendeel juist een uitermate revolutionaire. Op amper enkele jaren tijd werd de sociale structuur van het krachteloze Weimar-Duitsland gesloopt. De stelling dat het naziregime een logische voortzetting was van een autoritair, Pruisisch Duitsland blijkt volkomen onjuist. Hitlers weerzin tegen de staat, die hem met zijn inherente bureaucratie en legalisme in zijn bewegingsruimte belemmerde, vertaalde zich binnenlands in een ware sociale omwenteling. Het nationaal-socialisme wordt door professor van Doorn als een anti-kapitalistische stroming beschreven, waartegen de sociaal-democraten het moesten afleggen omdat ze het nationalisme niet wisten te integreren in hun programma. Het boek is een onconventionele kijk op de geschiedenis van de arbeidersbeweging.
Bijna nergens werd het Keynesianisme zo succesvol toegepast en genoten werknemers zo’n uitgebreide sociale zekerheid als in nazi-Duitsland. De liberale geallieerden waren zelfs zo beducht voor de bekoring van de nazi-welvaartsstaat bij de Europese bevolking dat ze zich gedurende de oorlog genoodzaakt zagen een op het Duitse voorbeeld geïnspireerde verzorgingsstaat te ontwerpen. Jacques van Doorn toont hiermee aan dat onze huidige sociale zekerheid ontstond uit het nationaal-socialisme.
Volgens de auteur faalde de Duitse sociaal-democratie dus vanwege haar grootste tekort: het onvermogen om nationalisme en socialisme te verzoenen. Dit gebrek belastte de Duitse sociaal-democratie vanaf haar ontstaan tot op heden: geen enkele Duitse partij huivert zo voor vlagvertoon en het uitdrukken van identitaire gevoelens als de SPD. Reeds in de jaren 1860 leidde dit tot een hevige tweestrijd tussen enerzijds de internationalisten Karl Marx en Friedrich Engels en anderzijds de ‘eerste nationaal-socialist’ Ferdinand Lassalle (1825-1864). Het Duitse socialisme ontstond trouwens bij de Pruisische staatssocialist Lassalle, die de eerste socialistische partij ter wereld oprichtte. Zijn vroege dood in 1864 zorgde er echter voor dat de strekking Marx-Engels de overhand kreeg. Toch schreef ook Lasalles opvolger Johann Baptist von Schweitzer (als voorzitter van de ADAV - een voorganger van de SPD) in het ADAV-tijdschrift Der Socialdemokrat nog regelmatig over nationalistische thema’s, zoals het goedkeuren van de annexatie van de Deense gebieden Sleeswijk en Holstein door Pruisen of het benoemen van Duitsers die niet participeerden aan de Frans-Duitse Oorlog als landverraders. Volgens hem bestond de Duitse macht “uit de Pruisische bajonet en de vuist van Duitse proletariërs”.
Binnen de sociaal-democratische partij - sinds 1890 heette die SPD - waren dergelijke bekentenissen echter omstreden. Nooit kon een verzoeningsformule gevonden worden voor dit permanente conflict tussen internationalisten en ‘nationalen’. De partij schipperde dan ook decennialang tussen de ene keer het ondersteunen en de andere keer het bestrijden van de regering inzake nationale belangen. Vanaf zijn ontstaan tot zijn ondergang in 1933 manifesteerde de SPD zich steeds weer als een tweeslachtige partij, die bovendien permanent werd veracht door ‘rechts’ en gewantrouwd door ‘links’.
Uit het onsamenhangende werk van Marx en Engels distilleerde hun politieke erfgenaam Karl Kautsky (1854-1938) een marxistische orthodoxie die weliswaar de SPD aaneensmeedde door een vast geloof, doch tegelijk de socialisten ook dwong zich tegenover Duitsland te blijven opstellen. In augustus 1914 waren ze echter door de tegenstelling tussen hun reformistische praktijk en hun revolutionaire programma niet tegen de nationalistische oorlogseuforie bestand, waardoor de SPD gedwongen werd in de Rijksdag voor de oorlogskredieten te stemmen. Veel partijleden bleken immers voorstander van oorlogsdeelname en wezen erop dat Duitsland het land was van organisatie en een paternalistische staat, terwijl ook de Duitse Kultur op een hoger niveau stond dan de liberale oppervlakkigheid van Engeland en Frankrijk. En hoewel het de historische taak van de SPD was in Duitsland het socialisme te verwezenlijken, een einde te stellen aan vergaande sociale mistoestanden en het ongebreidelde kapitalisme aan banden te leggen, mislukten de Duitse sociaal-democraten hierin tijdens de ongelukkige Novemberrevolutie van 1918, die dan ook door de Vrijkorpsen werd neergeslagen.
Hierdoor kregen ze tijdens de daaropvolgende Weimarrepubliek de schuld voor de verloren oorlog toegeschoven, terwijl de SPD tot overmaat van ramp door het marxisme van Kautsky niet voorbereid was om het land te besturen. Zo werden de door de sociaal-democraten decennialang beloofde economische hervormingen nauwelijks uitgevoerd. De SPD beperkte zich daarentegen tot het verdedigen van de in Duitsland onpopulaire liberale democratie. De partij faalde dus jammerlijk, wat van Doorn toeschrijft aan één tekort: de partij kon Duitsland niet vinden. Daarom zou de SPD ten onder gaan in de confrontatie met een partij die bewees dat het socialisme wél een unieke nationaal-bindende kracht kon zijn. Het nationaal-socialisme voltooide bijgevolg de geschiedenis van het Duitse socialisme door zich te identificeren met Duitsland. Om dat Duitse socialisme vervolgens te vernietigen door er de meest extreme consequenties aan te geven, die “zum Teufel führen”, zoals van Doorn schrijft.
Hoe groot de behoefte aan een synthese tussen socialisme en nationalisme was, bleek uit het enorme succes van de NSDAP in de loop van de jaren 1930, toen de omvang ervan veel groter bleek dan de SPD ooit gekend had. Maar anders dan de SPD stelde de NSDAP de Duitsers niet teleur: in 1951 noemde veertig procent der Duitsers de jaren 1930 de beste tijd die Duitsland ooit had gekend. Omdat het nazisme bijgevolg weinig weerwerk van de bevolking te vrezen had, telde de Gestapo in die jaren slechts 8.000 man (op ca. 80 miljoen inwoners). Ter vergelijking: het wérkelijk onpopulaire DDR-regime had 91.000 medewerkers - zonder de ca. 175.000 informanten! - nodig om een onwillige bevolking van 17 miljoen mensen in bedwang te houden. Het ontbreken van de dwang waarmee de regimes in de Sovjetunie en diens Midden-Europese satellietstaten zich moesten handhaven, wettigt volgens professor van Doorn zelfs “de vraag of het juist is nazi-Duitsland een totalitaire staat te noemen, en zelfs of het regime dat serieus beoogde te zijn”.
Zowel de marxistische klassenstrijd als de oude keizerlijke standenmaatschappij werden begraven en vervangen door een echte Volksgemeinschaft. Sociale en culturele ongelijkheid werd met kracht bestreden. Voortaan telden prestaties in plaats van geboorte of financiële status bij het toewijzen van posities in leger, partij, SS en maatschappij. De sociale mobiliteit nam aanzienlijk toe, terwijl tevens de samenleving opener werd, een ontwikkeling die na 1945 niet meer kon worden teruggedraaid. Het Derde Rijk, concludeert de auteur, was wel degelijk op weg naar een socialisme gezien de verregaande toename van sociale gelijkheid en emancipatie. De nazi’s slaagden erin een eind te maken aan de standenstaat en de diepe scheiding tussen burgerij en arbeiders, waartoe de SPD - ondanks zijn electorale successen - nooit in staat was geweest. Hierbij dient wel duidelijk gesteld te worden dat deze transformatie niet berustte op een wijziging van de economische structuur - zoals het marxistisch socialisme wou - maar wel op een sociaal-psychologisch veranderingsproces. Met andere woorden, de nazi’s socialiseerden niet de banken en fabrieken, maar “wir sozialisieren die Menschen”. Daarmee bewijst van Doorn dat het Duitse nationaal-socialisme wel degelijk als een socialisme moet worden beschouwd, daar het gaat om de gemeenschappelijke kern van alle vormen van socialisme: de kritiek op laissez-faire kapitalisme en traditionele sociale ongelijkheid.
Het algemeen aanvaarde beeld is dat de 20ste eeuw het strijdtoneel was tussen liberale democratie en de totalitarismen fascisme en communisme. Dit blijkt slechts geallieerde propaganda te zijn. In het interbellum kon de liberale democratie zich in Europa nauwelijks handhaven, vermits het geen antwoord had op de Grote Depressie en op de uitdaging van de nieuwe massacultuur. Het was juist de nationaal-socialistische verzorgingsstaat die een serieus alternatief organiseerde waar vasthouden aan het liberaal-kapitalisme tot massale werkloosheid en uitzichtloosheid leidde. De gruwelijke slotperiode van het Derde Rijk, met de barbarij van de Tweede Wereldoorlog, werd volgens van Doorn maar al te gemakkelijk gebruikt om dit onder de mat te vegen. Naast de New Deal, de Zweedse verzorgingsstaat en het plansocialisme was er daardoor nooit aandacht voor de succesvolle maatschappelijke ordening van Robert Ley, leider van het Deutsche Arbeitsfront. Als uitsmijter herinnert de auteur er ons tevens nog aan dat veel sociale wetgeving uit de nazitijd in Duitsland én in Nederland na de oorlog intact is gebleven.
Van Doorns boek laat een ontembare nieuwsgierigheid en een verfrissende onbevangenheid zien. Zijn uiteenzettingen zijn zeer helder, leesbaar en rijk aan weinig bekende, maar belangrijke feiten. Daarmee zal hij - zeker onder historici - geen vrienden maken. Maar dat zou de tijdens het schrijfproces reeds terminaal zieke en ondertussen overleden hoogleraar vermoedelijk niet veel kunnen schelen hebben.
Vbr. lic. hist. Filip Martens
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : socialisme, socialisme allemand, social-démocratie, national-socialisme, années 20, années 30, allemagne, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 mars 2009
Revolutionary Conservative: Interview with Jonathan Bowden

REVOLUTIONARY CONSERVATIVE:
INTERVIEW WITH JONATHAN BOWDEN
Interviewed by Troy Southgate - http://www.rosenoire.org/
REVOLUTIONARY CONSERVATIVE: INTERVIEW WITH JONATHAN BOWDEN As conducted by Troy Southgate
Jonathan Bowden is the Chairman of the New Right and a man I am proud to regard both as a like-minded spirit and a friend. The following interview was conducted in the summer of 2007.
Q1: Your family background is a heady mix of Irish and Mancunian and you were brought up in rural Kent. Would you say that any of this helped to shape your intellectual development in any significant way?
JB: One’s origins obviously influence the way everything turns out in the end. I actually spent many of my formative years in the south Oxfordshire countryside, but I do admit that the Kent coast offers a certain draw. I was born in Pembury maternity hospital in mid-Kent in 1962 and the family later branched out into Bearstead after that. I remember a blue Volkswagen beetle, an extremely low-lying bungalow, roundabouts, that sort of thing… it was all very middle-class. I especially recall a Gothic moment from my own childhood; it concerned a mad woman or witch who lived up the way. She seemed to be a sort of Grendel’s mother – you know the kind. Anyway, rumour had it that she used to sit stark naked behind her letter box, dressed only in a black balaclava helmet, and any woman passing by would then be subjected to ferocious abuse. Scatology wasn’t the word for it, if you take my drift. Then, after a certain time had elapsed, the police would be called and she’d be sat there, dressed up to the nines, with cream teas and all the rest of it. It was essentially an elaborate attempt to flirt with, seduce or just fraternise with the local policemen. Then, as soon as they’d departed and she’d promised to behave, our wired sister would be back at the letter box fulminating. All other women were the object of her hate. No feminist sisterhood in evidence there, then. Its sexual hysteria and related screamings – I remember it all as if it were yesterday. My mother was terrified of her. We always had to go round the other way. Gothic or macabre things like that have always intrigued me – it’s the hint of chaos underneath bourgeois suburban conformism, you see. Life – when you stop to consider it – is really a painting through which people articulate their own death. What interests me is the artistry to it; it’s what our forebears, the Elizabethans, used to call the skull beneath the skin.
Q2: A few years ago now, you published a series of books under a different name. Tell us more about the themes involved and what you were trying to achieve at the time.
JB: Yes, I admit that your question is along the right lines. I’ve written a great deal down in the years and under various names – one of them happened to be John Michael McCloughlin, as I recall. I’ve certainly written between thirty and fifty books – depending on how you choose to look at it. At one level I’ve composed purely for myself – fiction, plays, non-fiction, memoirs, belle lettres, higher journalism, lyrics, prosody, experimental or stream-of-consciousness work, you name it. At present it’s all beginning to appear on the internet. My website – www.jonathanbowden.co.uk – contains one full manuscript. It’s an e-Book in PDF format. It’s entitled Apocalypse TV and consists of at least 100,000 words. It’s approximately 240 pages. A Platonic dialogue between a Christian and a pagan voice, it deals with Turner Prize art or the “Sensation” exhibition, criminology and the murders of Fred and Rose West, the concept of Political Correctness, all sorts of things. A short story, A Ballet of Wasps , also exists on the site. Hopefully – and before too long – a great deal of material will appear in this way. It’s essentially got to be scanned, edited, converted to PDF and then uploaded. A play which you have read, Troy, called Lilith Before Eve , has recently been added to the site. The following three short stories, Golgotha’s Centurion, Wilderness’ Ape and Sixty-foot Dolls , will appear relatively soon. There are also four more plays known as Glock’s Abattoir, We are Wrath’s Children!, Evolution X and ,i>Stinging Beetles, for example. Ultimately, one of my life tasks is to put all of it online and then see if publishers, small outfits, that sort of thing, would be willing to do hard copy versions. One point of interest: the publisher Integral Tradition Publishing has expressed an interest in possibly treating Apocalypse TV in the way I describe – although whether this will ever extend to a desire to publish full novels of mine, such as Al-Qa’eda Moth or The Fanatical Pursuit of Purity, is altogether another issue. But, rest assured, I will bring out everything I’ve ever done over time, even if it’s only in e-Book form on the internet. Politics is just a side-line, you see; artistic activity is what really matters. The one alters effects; the other changes the world. As Bill Hopkins once told me, one man sat writing alone in a room can alter the entire cosmos. It’s the ability – through a type-writer or whatever else – to radically transform the consciousness of one’s time. Cultural struggle is the most interesting diversion of all. There’s a Lancastrian truism that my mother retailed to me: “truth is a knife passing through meat”. Well, in this particular freeway one special coda stands out – you must become your own comet streaking across the heavens – all else is just a matter of flame, spent filament, rock or tissue, en passant, which slopes off to the side. Avoid those stray meteor shoals casting off to one’s left; they are just the abandoned waifs and strays of a spent becoming. Let your life resemble a bullet passing through screens: everything extraneous to one’s task recalls such osmotic filters. (I’d especially like to thank Daniel Smalley and Sharon Ebanks for their manifold assistance with these websites. Sharon’s earlier contribution was the following: www.jonathanbowdenart.co.uk). Do you wish to survey something I’ve just written? It’s a bit of a prosody based on a Futurist painting by Fortunato Depero called Skyscrapers & Tunnel (1930).
Do they make the most Of a tubular scene-scape Designed without cost And collapsing into date Crepe rape spate fate constant ingrate?
Q3: Please tell us how you came to be involved in the Western Goals Institute, a vociferously anti-liberal and anti-communist tendency which originated in 1989 as an offshoot of the American ultra-conservative group of the same name.
JB: Yes, the organisation known as Western Goals was a bit of a shape-shifting entity – it began as Western Goals UK and then transformed itself, eventually, into the Western Goals Institute. Later still it recomposed itself into the British chapter of the World League for Freedom and Democracy; a group which, as it didn’t believe in either freedom or democracy, was rather amusing. I gave them my support – I was actually deputy chairman for a while – because I agreed with a merciless prosecution of the Cold War. Right-wingers of every type and race aligned across the globe against communism. The war had to be fought tooth and branch. I essentially concurred with Louis Ferdinand C’eline’s mea culpa about Marxist-Leninism – after having toured the Soviet Union on the proceeds of Journey to the End of the Night and Death on Credit. Don’t forget that the third world war, to use a different nomenclature for the Cold War, proved to be an alliance between Western hawks or rightist liberals and neo-fascism across the Third World. Groups like Unita, Renamo, Broad National Front (FAN), the Triple A, the United Social Forces, The Konservative Party and HNP, the Contras and Arena – never mind Ba’athism… all of these tendencies were Ultra in character. Had they all been Caucasian in profile, such groups would have seemed indistinguishable from the OAS or VMO. It was vitally necessary to delouse those “communist peons of dust”… to adopt a line from a stanza by Robinson Jeffers. I have always believed with Mephistopheles in Goethe’s Faust, whether paraphrased by Sir Oswald Mosley or not, that in the beginning there is an action.
Q4: Shortly afterwards you founded the Revolutionary Conservative Caucus with Stuart Millson. What were the reasons behind the establishing of this group and, realistically, how much do you think it managed to achieve?
JB: Ah yes, the Revolutionary Conservative Caucus and all that jazz. Where have one’s salad days gone? Anyway, the RCC was set up by Millson and myself as a cultural struggle tendency. Never really conservative, except metaphysically, it wanted to introduce abstract thought into the nether reaches of the Conservative and Unionist party – an area habitually immune to abstract thought, possibly any thought at all. There have always been such ginger groups – Rising, National Democrat and later Scorpion, Nationalism Today, Perspectives, the European Books Society, the Spinning Top Club, the Bloomsbury Forum and now the New Right. The important thing to remember is that these groups are fundamentally similar – irrespective of distinct semiotics. The system of signs may jar, but, in truth, all of them are advocating radical inequality and meaning through transcendence… that’s the key. As to accomplishments or achievements… well, they were really twofold: first, the mixing together of ultra-conservative and neo-fascist ideas; second, a belief in the importance of meta-politics or cultural struggle. By dint of a third or more casual reading, various publications like Standardbearers , Oswald Spengler’s essay Man & Technics , the ‘Revolutionary Conservative Review’, a brief and intermediate magazine called Resolution and the ultra-conservative journal Right Now… all of these formulations came out of this nexus. It’s a creative vortex, you see? Let’s take one example: my interview with Bill Hopkins in Standardbearers… this links right back to the fifties Angry Young Men and to Stuart Holroyd’s productions in Northern World, the journal of the Northern League. This interconnects – like Colin Wilson writing for Jeffrey Hamm’s Lodestar – with not only Roger Pearson but also the fact that members of the SS were in the Northern League.
Sic cum transierint mei Nullo cum strepitu dies Plebeius moriar senex. Illi mors gravis incubat Qui notus nimis omnibus Ignotus moritur sibi.
It’s this which has to be avoided.
Q5: Your first association with the New Right was as a guest speaker at the very first meeting in January 2005. What made you want to become more involved with the group and what role do you think it can play in the future?
JB: I became involved because of a residual respect for what the New Right and GRECE were trying to achieve. For my own part, this has something to do with the fact that the New Right wishes to bring back past verities in new guises. It ultimately recognises an inner salience; whence the Old Right enjoyed a Janus-faced discourse: whether esoteric or exoteric in character. Do you follow? Because the outer manifestation tended to be conspiratorial, however defined. Whereas the innermost locution rebelled against old forms, postulated a Nietzschean outlook and adopted a pitiless attitude towards weakness in all its forms. Irrespective of this, the New Right recognises that fascism and national-socialism were populist or mass expressions of revolutionary conservative doctrines. Indeed, the Conservative Revolution is tantamount to Marxism on the other side: the truth of the matter is that Evola, Junger, Spengler, Pound, Moeller van den Bruck, Bardeche, Revillo P. Oliver, Rebatet, Brasillach, Jung, Celine, Wyndham Lewis, Yockey, Bill Hopkins and Arthur Raven Thompson, say, are actually to the right of their respective political movements. It’s the same with the extreme left on the other side – whether we’re talking about Adorno, Horkheimer or Althusser. Who’s ever really read Sartre’s The Dialectic of Critical Reason? As to any influence our group might have… well, perhaps it would be best to put it in this manner. I think that the New Right can prove to be a nucleus for illiberal thinking, albeit of a revolutionary and conservative character. Take, for example, Tomislav Sunic’s thesis, Against Democracy; Against Equality – a History of the European New Right. In this purview it becomes obvious that the Conservative Revolution was the seed-bed or think tank for fascism and national-socialism, much in the manner that theoretical Marxism was for communism. In the latter’s case, one only has to think of Adorno and Horkheimer’s The Dialectic of Enlightenment as the forcing house for ‘sixties revolutionism – far more, say, than Marcuse or the Situationists. Percy Bysshe Shelley, in Paul Foot’s terms Red Shelley, once described poets as the unacknowledged legislators of mankind. But, in all honesty, if we were to substitute the word intellectual or philosopher for poet then you might be nearer the mark. (All of which isn’t to take away for a moment the impact of poets like Kipling, Robinson Jeffers or the blind and recently deceased bard John Heath Stubbs, for example). Yet, I say again, one thing that we must deliberate upon is the power of conception. A man who possesses an idea or a spiritual truth is the equivalent of fifty men. Every pundit, tame journalist, academic or mainstream politician is mouthing hand-me-down ideas from a philosopher of yesteryear. At one level artists and intellectuals have no power whatsoever; undertake a parallax view or examine it in a reverse mirror, then you will see that they are matters of the universe. For those who have heard of Mosley, Degrelle, Jose Antonio Primo de Riveria, Mussolini, even at a push Julius Caesar; figures of Bardeche, Thomas Carlyle, Spengler and Lawrence R. Brown will remain forever arcane and mysterious. But fate’s mysterious witching hour knows that you can never have one without the other.
Q6: How did you reconcile your role as Chairman of the New Right, a self-proclaimed elitist and anti-democratic group, with your former position as Cultural Officer of the British National Party (BNP)?
JB: I feel that there was no great contradiction between the New Right and the British National Party. It’s a conundrum that revolves around the exoteric-esoteric fissure mentioned before. The British National Party is a populist or nativist group – it currently has about fifteen percent electoral support across Britain. No campaign and one leaflet garners a tenth of votes. Any sort of campaign nets 15%+; whereas a full-on methodology, Eddy Butler style, can get up to a fifth or a quarter of the vote. Bearing in mind that England is now fifteen per cent non-white then these margins represent an even higher proportion of Caucasia. Given this, the party represents a plebiscitary wing, the organisation’s inner spine are (for the most part) traditional nationalists; whereas their mental fodder needs to be provided by groupings like the New Right. Hierarchically speaking, the new reformats the old, albeit with a new cloak. Let’s put it this way: New Right sensibility sublimates Julius Evola’s The Metaphysics of War into Nietzsche’s The Will to Power. You have to understand that on the doorstep a small proportion of electors can vaguely recollect what country they’re living in… never mind anything else. Philosophy blinds them to a dance of sharp-toothed wolves. My, what large teeth you have, Granny – said little Red Riding Hood. Never mind: the real point is to achieve transcendence or becoming. Let’s begin with Voice of Freedom turning into Identity, inter alia, which leaps upwards to New Imperium – a step to the side of which might really be Bill Hopkins’ essay, Ways Without Precedent, in the volume of essays which served as the Angry Young Men’s manifesto. It was called Declarations. Yet perhaps even a step beyond this actually exists. Doesn’t one of Elisabeth Frink’s sculptures of a Soldier’s massive cranium – or one of her Goggle-heads, perchance – indicate a move ahead into aesthetic puissance? Everything that exists is about to transmute into a superior variant, an intellectual and spiritual speck of light which exists over it. As a BNP activist who’d been electioneering in the streets of East London once told a journalist; “If there’s nothing above you then there’s nothing to aspire to”.
Q7: Is there any real difference between the natural ascendancy of the strong over the weak – a recurring theme in your speeches – and the ruthlessness of capitalist economics?
JB: Again, as before, my answer has to begin and end with a postulation of hierarchy tout court. Do you see? It all has to do with the fact that economics is the lowest level of social reality. It remains purely material. Despising it is no good; what you have to do must be to effectively transcend it. The neo-utilitarian economist, Arthur Marshall, who was active at the turn of the twentieth century once famously described his subject as the dismal science. Just so… literary-minded types have always preferred belletrists of finance, whether J.K. Galbraith or Hilaire Belloc’s Economics for Helen. What you need to do is accept the market as the basis for a national economy that will be mainly privately owned, as Tyndall advocated in the Eleventh Hour, and then impose implacable political ethos on it from above. Politics must master economics; businessmen must be made to be spiritually subordinate to spiritual verities: the supreme expression of which is Art. Money then serves higher interests to which it is beholden – not the other way around. In all vaguely autocratic systems the economy operates in the way I’ve described. Ultimately you have to teach people not that money is the root of all evil – that’s purblind Biblical moralising – but that capital proves to be little more than fuel. To start up your car you need to put the key in the slot. Economic activity then has to serve the national community – not the reverse. As to the alleged ruthlessness of capitalist economics – that’s largely Darwinian romanticism. Does an eagle suffer from pity as it tears its prey to pieces in the stump of a tree? Anyway, do you really suppose that we have an unfettered market after over a century of state intervention or social democratic manipulation of its mechanisms? The only real success the far-left’s ever had was to provide shot-gun marriages for statist institutions in the West. New liberals designed pension, health, credit, insurance and social housing schemes in order to buy off proletarian rebellion from below. It owed as much to the far-right as the accredited Left – hence Skidelsky’s hero-worshipping of Mosley in his biography of that name. (This author moved from being right social democrat to a left conservative at a later date). Likewise, Sir Oswald Mosley’s New Party contained Marxian economists and social commentators like John Strachey – later to be Minister of Food in the post-war Labour government. The real point has to be the metaphysical guiding post behind Mosley’s post-war treatise, The Alternative. Subordinate economics to the meaning of politics not its management. The whole point of a political class is to impose a morality on the market – as Heseltine, of all people, once said, market economics has no ethical system otherwise. Von Hayek’s methodology of the implicit moral goodness of markets (because self-correcting) is flawed. But de Benoist’s attack on an advocacy of jungle law – whether directed at von Mises, Hayek, Friedman, etc… falls sheer. Why so? Because all that’s wrong with primitivism, brutalism and what Ragnar Redbeard called Might is Right has to be an absence of culture. That’s the salient point to remember. No Sistine chapel ceilings would ever have been painted without a systematic metaphysic to master gold. Put it in its proper place, why don’t you? Yet you can only do so after its creation. In this custodianship Sir Digby Jones, the former director general of the CBI, has to find himself subordinated to the manifestation of those eight symphonies by Sir Peter Maxwell Davies.
Q8: How ‘new’ is the New Right?
JB: It is clear to me that the New Right is diverse and diachronic in form. Like the refracted sides of a cerulean gem it casts many different slants afoot. All of these shimmer and break against a dark glass. To be truthful, the biggest disjunctions between old and new have to do with reductionism, conspiracy and revisionism. The old accepts the first two categories and could be said to have reformulated itself by virtue of the third. Perhaps we could go as far as to say that Revisionism is the reworking of the Old Right in modern guise – revisionist literature could then be considered to be the Old Right’s research and development. Just so… maybe Butz, Samning, Steiglitz, Baron, Berg, Harry Elmer Barnes, Rudolf, Mattogno, Graf, Faurisson, Zundel, Rassinger, Joachim Hoffmann, Heddessheimer, et al, are really Maurras, Weininger, Brasillach, Drieu la Rochelle, Celine, Barres, Revilo P. Oliver, Yackey, Ezra Pound, Jack London and Rossenberg… all come round again. I think, in these circumstances, that the New Right is a differentiated codex or semiotic – it enables a great deal of radical conservative material to return, maybe in a new guise. Although another point should be made, in that ultra-Right movements tend to have an occult trajectory. They manifest two sides: the esoteric and the exoteric. This can be considered to be a polarity between internal and external. For the masses Jean Respail’s Camp of the Saints or Christopher Priest’s Fugue for a Darkening Island; for the elite Count Arthur de Gobineau’s Essay on the Inequality of the Human Races . To quote yet another example – for mass taste Kolberg or Der Ewige Jude; for elitist consumption Leni Riefenstahl’s Olympia or the Italian film industry’s version of Ayn Rand’s We the Living. Even Hans Jurgen Syberberg’s seven hour epic, Hitler: a Film from Germany, strives for neutrality in an area where only negative partisanship is allowed. In this context Steukers, Sunic, Gottfried, De Benoist, Walker, Lawson, Krebs and so forth, are the inner elitism or vertical dimension amidst a general carnival. They are less the meat in the sandwich than the inner pagan and non-humanist core to ideas which the residuum cannot grasp unless they are put in a more basic form. It must only be true the less it is understood, in other words… By virtue of our silk-screening, reductive and metaphysical conspiracies are materialisms. They are explanations on a physical level. New Right discourse internalises and sublimates this doxa; it circulates it as spiritual velocity. Aesthetically speaking, what can be transmuted – for a philistine or mass public – as Max Nordau’s Degeneration becomes Ortega Y Gasset’s The De-humanisation of Art at a more advanced illustrative push. Perhaps, even as a reverse dialectic, Wyndham Lewis’ The Demon of Progress in the Arts provides an overlapping negation to Y Gasset’s thesis – all prior to a new or renewed synthesis. Ethnically speaking, one might aver that The Turner Diaries amount to the outside face of the Bell Curve’s Junction. Artistically again, doesn’t Ayn Rand’s The Fountainhead provide a fusion, in mock-libertarian guise, of internal and external messages in a bottle? Whereby the heroic modernist Roark – based loosely on the living example of Mies van der Rohe – overlaps with the neo-classical sculptor ‘Steve’. A character which was loosely based on Gustav Thorak, an artist who’s heroic figurine, Atlas, outside the grand central station in Chicago influenced Ayn Rand’s last right-anarchist novel, Atlas Shrugged. I would go so far as to say that the New Right is a toxic cerebration to the Old Right’s fist: in musical terms it’s Screwdriver becoming Laibach and then morphing into Carl Orff. But isn’t Verese’s noise brought back into focus by Igor Stravinsky’s The Right of Spring? After the performance of which – the master Stravinsky had to be guarded at his concerts, like a prize fighter. Diaghilev strove to remain highly jealous throughout.
Q9: You have a keen interest in Modernism. Why does this form of artistic expression appeal to you most and what, in your opinion, makes Modernism so superior to Modern Art?
JB: Ah yes, the issue of Modernism… I’m an ultra-rightwing modernist, let’s make that clear. Even though some of my work is traditional, restorationist, historical and semi-classic in spirit… nonetheless, I’m a modernist, even on some occasions an Ultra-modernist. Let’s be definite about this: some of my pictures do relate to Bosch, Redon, Klimt, Bacon, Pacher, ancient Greek sculpture and so on, but primarily I wish to create new and ferocious forms. They must come from within; what you really require is an image the like of which no-one has ever seen before, even dreamt of prior to your conception. Bacon always declared that he wanted to paint the perfect cry, after the fashion of the nurse on the steps facing the White Guards in Battleship Potemkin. I never wished to paint the greatest scream a la Poussin’s Massacre of the Innocents. No. For my part, I wanted to paint the most ferocious image of my time – these works are not neurotic, paranoid, schizoid, disturbed or mentally ill, as some might suggest… they are passionate integers of fury. The effort is to project strength and power. One cares nothing for the aesthetic standards of the masses; they are children who only like what they know or feel comfortable with. What really matters has to be the ecstasy of becoming – early or classic modernism happened to be exactly that. It was an attack on sentimentality; it proved to be an art purely for intellectuals. It was anti-humanist, elitist, inegalitarian, vanguardist, misanthropic, sexist, racist and homophobic – all good things. It gave witness to the neo-classic bias within the Modern that related to the theories of T.E. Hulme, a revolutionary conservative, and Ortega Y Gasset, a mild fascist. In the latter’s Dehumanisation of Art he preaches a new style against the Mass – that notion has always intoxicated me; to trample upon the masses and synthesise them into a new evolutionary surge has to be our object. The failure of extremist conservatism, fascism and national-socialism was material; revolutionary right-wing ideas may only really flourish spiritually: art has to be its vehicle; the stars its limit… homo stultus, the putty. Early modernism found itself penetrated by these ideas… only much later did it become a vehicle for liberal humanism. A move which in and itself related to the academic, restorative and conservative aesthetic tendencies in Soviet and Nazi art. One of the ironies is that revolutionary art becomes liberal wall-paper; while revolutionary movements adopted philistinism as their watchword. Their anti-formalism became a rigid fear of upsetting the majority. Art partly exists to disturb expectations, but liberal anti-objectivism has gradually dissolved this influence. An image like Tato’s March on Rome becomes more and more diffuse… until you end up with a David Hockney sketch, a Yorkshire scene bathed in light, and adorning a corporate office anywhere in the world. But let’s not fall into the trap of talking about the revolution betrayed – that’s such a bore. Also, revolutions are always betrayed; that’s their purpose. It’s only then that we recognise the salient truth: namely, they are part of life’s warp and weft. They have to be taken - to use Truman Capote’s axiom – in Cold Blood. A dilemma which brings us to the exposed issue of post-modernism, I dare say.
Q10: A talented and accomplished artist, you have produced over 200 paintings of your own. What first motivated you to take up painting, and how would you describe your own inimitable style?
JB: Unlucky for some, eh? Well, let’s look at it in this way… between around six or thirteen years of age I used to draw comics or graphic novels. They were my first form. Around two thousand images definitely came into the world as a consequence of these endeavours. They were my first love, I suppose – primarily due to their combination of words and images. A factor which also accounts for my interest in the graphic, the horrific or Gothic, the linear and the pre-formed. Contrary to the desiderata of pure modernism, in graphic work you always know where you’re going but not necessarily where you intend to end up. After a brief gap – grammar school and so on – I started to produce images again. Yet now a subtle change had taken place. The pictures underwent a metamorphosis into full-scale paintings and over around thirty years have mounted up to at least 215 works. Some of the early ones are framed; others not. Around 175 or 177 (depending) are available for viewing on my website (www.jonathanbowden.co.uk), sundry sketches and preliminaries will follow… and the coup de gras shall be those graphic novels which await scanning and upload at a later date. Personally speaking, I find them to be captivating in their allure. They are extremely varied in their focus – some are ferocious, savage and expressionist; others are erotic, playful and sensual; still more have a classic, restorationist or historical bias; while the remainder embody autobiographical and ideological themes. Some pertain to child art or the ramifications of Art Brut: that is, a willing or known primitivism in terms of artistic silence. Certain other paintings are literally portraits of people known to me; whilst early on I experimented with the psycho-portrait – here you illuminate a person’s nature and not their looks. Although eschewing abstraction – unlike Norman Lowell – I’ve never been interested in pure representationality after the invention of photography to do it for you. Do you recall those nineteenth century series of photographs by the master Edward Muybridge? He was one of the great pioneers of slow-motion, frame by frame photography when this art or science was in its infancy. A sequential art motif featuring two men engaged in Graeco-Roman wrestling has to be an early classic. These images in particular had profound influence on Francis Bacon’s oeuvre. Anyway, if we examine it closely then this tradition splits several ways. It leads to the strip cartoon, the cartoon or funny, comics and the story board – a development that prepares the ground for early silent cinema. So inter alia, the fantastical and linear presentation of action becomes art’s necessity. All of which involves going inside the mind so as to furnish provender – imagination then facilitates change, transmutation, forays from within and the custody of inner space. An eventuality which portends Modernism – why don’t you think of me as a heterosexual version of Francis Bacon? Maybe you could construe yourself, Troy, as the famous critic David Sylvester with whom Bacon had a well-known artistic dialogue in Plato’s tradition. Thames and Hudson published it years ago.
Q11: In his recent book, Homo Americanus, the Croatian author Tomislav Sunic notes that “postmodernity is hypermodernity insofar as the means of communication render all political signs disfigured and out of proportion.” (p.150)? What is your view on post-modernism and hyper-modernism?
JB: I actually question whether the concept of hyper-modernity actually exists, but we don’t want to end up in a cul-de-sac of meaning and response. By no means… Do you happen to recall that story by H.P. Lovecraft, Pickman’s Model, where the artist’s baying creature at the end of various Old Bostonian tunnels was taken from life? That’s the point… Anyway, in Tomislav Sunic’s Homo Americanus, which I have to admit that I had a hand in editing, he makes a situational point about post-modernism. Note: Situationism was a literary theory of excess, somewhat ‘terrorist’ in spirit, which grew out of a fragment of late surrealism. Its chief text was Guy Debord’s The Society of the Spectacle. Certainly the notion of a twenty-four hour media circus which penetrates everything, cyclonically, has come to be seen as a cliché. Nowadays , a thinker like Jean Baudrillard just tidied up post-modern excess and evinced an ironic distance over any attachment to left radicalism. Post-modernity is really about patterning. It’s an Asiatic or Oriental deportment; one in which displaced tarot cards are endlessly displaced and new meanings then become attached to them. It self-consciously adopts a mosaic’s inflexions, but variously complex or contradictory currents enter into the mixture here. Yet misnomers abound: Stravinsky’s neo-classicism early on in the twentieth century is definitely post-modern in feel… yet historically it can hardly be described as such. Whereas an extremist modernist text written after the Second European Civil War by Samuel Beckett, Comment C’est (How It Is), could be delineated as a post-modern elixir. In it two forms – vaguely reminiscent of the actors Patrick Magee and Max Wall – drag themselves across plateaus of mud towards an uncertain future, mouthing imprecations all the while. Also, there is a complicated interaction between post-modernist diction and historical revisionism over the Shoah. Its extreme relativism, metaphysical subjectivism and heuristic bias lend itself to micrological analysis, rather like Kracuer’s estimation of the German film industry. Nonetheless, the hermeneutical pea-souper which clings to Paul de Mann’s Blindness & Insight definitely has something to do with his own partiality for writing on behalf of Leon Degrelle-like journals during that conflict. Paradoxically though, deep textual analysis or criminological fare, rather like Faurisson’s exegesis, can quite easily dovetail itself with Thion’s post-structuralism, whereby all media certainties become questionable. As to hyper-modernity, what can one say? Perhaps it relates to the mass media’s electronic self-consciousness – the self-consciousness of its own self-consciousness, if you like. Now post-modernism truly behaves like a serpent devouring its tail, or the Worm Ouroborous. It also betokens those cinema audiences in the ‘fifties, metaphorically, who sat in darkened flea-pits watching in X-Ray specs. Possibly hyper dims post-modernity, if only to provide its apotheosis and defeat. A chimpanzee sits before a Sony Playstation playing a Gulf War game with News 24 alive in the background… maybe the latter scenes in Pierre Boulle’s novel, Monkey Planet, have a certain salience. Particularly when these gestures are interestingly spliced with Christopher Priest’s racialist science-fiction novel, Fugue for a Darkening Island… the one with a piece of Ploog-like fantasy art on the cover. A neglected work – it nevertheless intones values similar to those of a British Camp of the Saints. The point to make throughout all of this, however, is that culture cannot just elicit a significatory response. It must entertain an essentialist or organic bias (even in its existential mists) – otherwise it’s meaningless. One can then look forward to conceptual art replacing an art of concepts; wherein Stewart Home’s interpretation of Manzoni’s cube smears over Kipling’s The Stranger.
Jonathan Bowden may be contacted in writing via BCM Refine, London WC1N 3XX, England.
| Home | Articles | Essays | Interviews | Poetry | Miscellany | Reviews | Books | Archives | Links |
00:23 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, conservatisme, conservatisme révolutionnaire, droite, angleterre, théorie politique, esthétique politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Machiavelli's Stellingen over Staat en Politiek
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, politique, théorie politique, philosophie, 16ème siècle, renaissance, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 mars 2009
La figure du "Katechon" chez Carl Schmitt

La figure du “Katechon” chez Schmitt
(intervention du Prof. Dr. Fabio Martelli - Université d'été de la FACE, 1995)
Dans sa Théologie politique (1922), la figure du katechon est celle qui, par son action politique ou par son exemple moral, arrête le flot du déclin, la satanisation totale de ce monde de l'en-deçà. Catholique intransigeant, lecteur attentif du “Nouveau Testament”, Schmitt construit sa propre notion du katechon au départ de la Deuxième Lettre aux Thessaloniciens de Paul de Tarse. Le Katechon est la force (un homme, un Etat, un peuple-hegemon) qui arrêtera la progression de l'Antéchrist. Schmitt valorise cette figure, au contraire de certains théologiens de la haute antiquité qui jugeaient que la figure du katechon était une figure négative parce qu'elle retardait l'avènement du Christ, qui devait survenir immédiatement après la victoire complète de l'Antéchrist. Schmitt fonde justement sa propre théologie civile, après avoir constaté cette différence entre les théologiens qui attendent, impatients, la catastrophe finale comme horizon de l'advenance de la parousie, d'une part, et, ceux qui, par le truchement d'une Theologia Civilis tirée en droite ligne de la pratique impériale romaine, veulent pérenniser le combat contre les forces du déclin à l'œuvre sur la Terre, sans trop se soucier de l'avènement de la parousie. Les sociétés humaines, politiques, perdent progressivement leurs valeurs sous l'effet d'une érosion constante. Le katechon travaille à gommer les effets de cette érosion. Il lutte contre le mal absolu, qui, aux yeux de Schmitt et des schmittiens, est l'anomie. Il restaure les valeurs, les maintient à bout de bras. Le Prof. Fabio Martelli a montré comment la notion de Katachon a varié au fil des réflexions schmittiennnes: il rappelle notamment qu'à l'époque de la “théologie de la libération”, si chère à certaines gauches, où un Dieu libérateur se substituait, ou tentait de se substituer, au Dieu protecteur du statu quo qu'il avait créé, Schmitt sautait au-dessus de ce clivage gauche/droite des années 60-70, et aussi au-dessus des langages à la mode, pour affirmer que les pays non-industrialisés (du tiers-monde) étaient en quelque sorte le katechon qui retenait l'anomie du monde industriel et du duopole USA/URSS. Finalement, Schmitt a été tenté de penser que le katechon n'existait pas encore, alors que l'anomie est bel et bien à l'œuvre dans le monde, mais que des “initiés” sont en train de forger une nouvelle Theologia Civilis, à l'écart des gesticulations des vecteurs du déclin. C'est de ces ateliers que surgira, un jour, le nouveau katechon historique, qui mènera une révolution anti-universaliste, contre ceux qui veulent à tout prix construire l'universalisme, arrêter le temps historique, biffer les valeurs, et sont, en ce sens, les serviteurs démoniaques et pervers de l'Antéchrist.
(résumé de Robert Steuckers; ce résumé ne donne qu'un reflet très incomplet de la densité remarquable de la conférence du Prof. Fabio Martelli, désormais Président de Synergies Européennes-Italie; le texte paraîtra in extenso dans Vouloir).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, révolution conservatrice, catholicisme, carl schmitt, théologie politique, théologie, weimar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 mars 2009
Figure du Partisan chez Schmitt, figures du rebelle et de l'anarque chez Jünger

Figure du Partisan chez Schmitt, figures du rebelle et de l'anarque chez Jünger
(intervention d'Alessandra Colla - Université d'été de la FACE, 1995)
Les notions de rebelle ou d'anarque chez Jünger en impliquent une autre: celle du “recours aux forêts”. En recourant aux forêts, l'anarque (le rebelle) manifeste sa libre volonté de chercher lui-même sa propre voie et de se soustraire ainsi à la massification qui est le lot du plus grand nombre. Mais comment survivre dans le désert spirituel de cette massification? Dans Eumeswil, l'anarque, qui affine le concept de rebelle et le hisse à un niveau qualitatif supérieur, est l'homme qui veut affirmer sa propre liberté. Mais en dehors du système, avec ses propres moyens. Le rebelle, puis l'anarque, maintiennent leur propre identité, ils n'acceptent de jouer aucun rôle dans la société étouffante qu'ils cherchent à fuir. En revanche, ils cherchent leurs pairs, avec l'espoir ténu de former de nouvelles élites qui agiront directement sur les noyaux vitaux du système. Face à ces figures proches du rebelle et de l'anarque, le partisan de Schmitt est l'héritier des maquisards français, yougoslaves ou soviétiques de la deuxième guerre mondiale. Mais le partisan n'est pas en dehors de toute loi: il reçoit ses déterminations d'une instance extérieure à lui, sur laquelle il n'a aucune prise. Après son combat et en cas de victoire, le partisan se hisse au pouvoir et le rend aussi routinier qu'auparavant, donc aussi insupportable, aussi étouffant.
Débat: Le système produit des “décalés”, non des anarques, et peut se justifier par la présence même de ces “décalés”, prouver de la sorte qu'il n'est pas aussi totalitaire et étouffant qu'il n'en a l'air. Le “décalé” est celui qui se taille une toute petite sphère d'autonomie dans le système, sans en sortir, en profitant des avantages matériels qu'il offre: le “décalé” est donc un “Canada Dry” par rapport à l'anarque. Le marketing du système utilise l'atypisme formel du décalé, qui est ainsi parfaitement récupéré, sans le moindre heurt. L'anarque se caractérise par une discipline intérieure, par un travail en profondeur sur lui-même, qu'est incapable de parfaire le décalé.
(notes prises par Catherine Niclaisse).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, tradition, sciences politiques, théorie politique, politologie, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 mars 2009
Baldur Springmann, pionnier de l'écologie allemande
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995

Baldur Springmann, pionnier de l'écologie allemande
Baldur Springmann, né en 1912 à Hagen en Westphalie, est le fils d'un grand industriel. Après 1945, il est expulsé de sa propriété de l'Est, achète une ferme dans le Holstein et l'exploite. En 1954, il la transforme en entreprise pionnière de l'agriculture biologique/dynamique. Il participe au vaste mouvement qui s'oppose aux centrales nucléaires. Conjointement à Herbert Gruhl, ancien porte-paroles de la CDU en matières écologiques, il contribue au lancement du mouvement vert. Il le quitte quand les groupes marxistes commencent à noyauter le mouvement et placent leurs hommes aux postes-clef. En 1982, il publie un livre, Partner Erde (= Notre partenaire, la Terre). Depuis 1991, il appartient au mouvement des écologistes indépendants en Allemagne.
Q.: Y a-t-il eu dans votre vie un événements crucial, qui a fait de vous un écologiste?
BS: Oui. Par exemple, dès l'âge de quinze ans, j'ai ressenti, dans mon fors intérieur, qu'existait bel et bien ce que C.G. Jung appelait l'“archétypal”; j'ai donc ressenti que mon vécu se branchait immédiatement sur l'essence même de la nature. Par ce contact direct, j'ai pris conscience des forces mortelles que déployait l'industrialisation, avec laquelle je ne voulais ni ne pouvais vivre. Voilà pourquoi je suis devenu paysan. Mais j'ai dû constater par la suite qu'il y avait agriculture et agriculture...
Q.: Vous avez été l'un des co-fondateurs du parti des “Verts”. Peut-on encore considérer que ce parti est aujourd'hui encore une plate-forme pour un véritable mouvement écologique?
BS: Dans l'ensemble, non. Ce qui s'est passé dans les années 70 pour le mouvement anti-nucléaire, s'est passé chez les Verts. Les idéologues marxistes qui cherchaient un tremplin et qui ne se souciaient pas le moins du monde de l'écologie, se sont introduits dans le mouvement, l'ont transformé et déformé, l'ont forcé à prendre une direction qui n'a plus grand'chose à voir avec les positions véritablement écologiques du début. Quoi qu'il en soit, les Verts sont encore le seul parti qui a défendu des positions écologiques, avec des hauts et des bas.
Q.: Quel est le reproche principal que vous adressez aux Verts?
BS: Leur anti-germanisme. L'anti-germanisme est aujourd'hui une forme de racisme beaucoup plus virulente que l'anti-sémitisme. Pourquoi l'anti-germanisme serait-il moins raciste, moins hostile à la vie, moins dangereux que l'anti-sémitisme? C'est la présence de ce racisme qui me dégoute chez les Verts. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont eu des difficultés avec le mouvement Bündnis 90, où ce racisme n'est pas présent. Ces hommes et ces femmes ont encore le sentiment d'appartenir à un peuple, tout naturellement, sans aucune crispation. Ceux qui veulent se faire valoir en répétant à satiété des slogans comme «germanité = criminalité», développent au fond une idéologie qui n'a rien à voir avec l'écologie. Les obsessions racistes et discriminantes sont une preuve d'incompétence en matières écologiques.
Q.: Cette équation entre germanité et criminalité que l'on trouve chez les Verts, qu'a-t-elle à voir avec les questions écologiques?
BS: On peut tout bonnement se débarrasser de l'écologie comme d'un vulgaire déchet si, d'une part, on revendique la guérison de la nature, et, d'autre part, on nie les liens qui unissent le peuple, le terroir et l'homme. L'écologie, c'est davantage que l'installation d'un biotope protégé pour les grenouilles et les crapauds, et le terroir, c'est beaucoup plus que le parking du supermarché du coin. Pour l'homme, le terroir c'est le fait de se sentir protégé, de se sentir à l'abri, dans une Geborgenheit dirait le philosophe Heidegger; mais à l'abri de quoi? D'une culture protectrice, englobante, maternante et poliçante. Le sentiment du terroir touche directement ce que j'appelle l'“écologie proprement humaine”. L'écologie, en effet, est la tentative de reconnaitre scientifiquement les liens qui unissent tous les domaines de la nature. L'homme n'est pas en dehors de la nature. Il est lié à elle. Et à tout l'univers. Peut-on, sans sombrer dans l'irréalisme et la sottise, nier ces liens qui unissent l'homme à la nature et à l'univers?
Q.: Prochainement, vous allez faire paraître un nouveau livre. De quoi s'agit-il?
BS: Mon livre paraîtra bientôt aux éditions dirigées par Siegfried Bublies [l'éditeur de la revue Wir Selbst, ndlr]. L'essentiel de cet ouvrage autobriographique, c'est de contribuer à une éthique de libération écologique. Faire passer dans les esprits une mutation de conscience radicalement écologique, voilà bien l'une des questions essentielles de notre époque, qui décidera de la survie des peuples. Il s'agira de susciter un véritable partenariat entre l'homme et la Terre, de proposer des alternatives réalisables, des formes actuelles, non passéistes, de vie écologique.
Q.: Beaucoup de militants de droite estime que l'écologie sert de cache-sexe à l'utopisme habituel des gauches. C'est ce qui explique leurs réticences.
BS: Ces militants-là ont encore l'esprit encombré de scories du 19ième siècle. Celui qui pense véritablement en termes d'écologie n'appartient ni à la gauche ni à la droite, mais est un homme en avance sur son temps. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère culturelle et nous n'avons plus à nous orienter sur des boussoles idéologiques du passé, nous devons aller de l'avant! Le clivage passera très vite entre une minorité prête à respecter la vie et à comprendre les forces de la Nature comme révélations du divin, et une majorité relative, plus puissante, composée de technocrates arrogants qui croiront toujours pouvoir dominer la nature selon le slogan: “Soumettez-vous la Terre”.
Q.: L'écologie n'est-elle pas une thématique fondamentalement conservatrice?
BS: Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi un conservatisme négatif, qui ne songe qu'à préserver les vieilles formes mortes. En fait, il faut que forme, contenu et temporalité puissent être en harmonie. Aujourd'hui plus personne ne se laisse enthousiasmer par le vocable “patrie” (Vaterland), mais vu les succès des Verts et d'un certain féminisme, on pourra susciter l'intérêt en parlant de “matrie” (Mutterland). Nous n'aurons plus affaire à des “patriotes” mais à des “matriotes”, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aiment toujours leur peuple, la matrice de ce qu'ils sont, leur “matrie”. C'est un amour tranquille, doux, qu'on ne saurait comparer au patriotisme des tambours et des trompettes. Le “matriotisme” pourrait parfaitement être accepté par les jeunes d'aujourd'hui.
Q.: La CSU vient de faire quelques déclarations claires contre l'hostilité à la technique qui se répandrait dans la population. Elle a également réclamé davantage de “progrès” dans quelques secteurs-clef de l'économie. Elle a traité les socialistes et les verts de “bloqueurs du progrès”. A votre avis, la CSU est-elle la forge idéologique où l'on crée des arguments contre ceux qui veulent préserver les fondements de notre existence biologique?
BS: La tendance de tous les partis actuels est d'être ennemis de la vie. Les partis se perçoivent comme les protecteurs de l'économie capitaliste et non pas comme les protecteurs de la Terre. Herbert Gruhl, quand il était encore parmi nous, a dit clairement ce qu'il fallait dire à propos de la folie de ce système, qui ne peut survivre sans “croissance”.
Q.: Mais tous le monde parle pourtant de protection de l'environnement...
BS: La préservation de la nature n'est pas, en premier lieu, un problème technique. Il s'agit d'une nécessité beaucoup plus profonde, c'est-à-dire d'une rénovation totale sur les plans spirituel et culturel. L'homme est un être de culture qui, bien entendu, influence directement ou indirectement la Nature par tout ce qu'il fait. Au départ, la relation d'échange entre l'homme et la Nature n'a pas remis en question les systèmes et les circuits écologiques existants. Mais les efforts des hommes en Occident d'échapper à l'emprise des formes socio-culturelles d'ancien régime a dégénéré, pris le mors aux dents, pour devenir une volonté d'échapper aux liens qui nous unissent biologiquement à la Nature. Les hommes en sont arrivés à vouloir s'émanciper de notre Mère la Nature, mais cela n'a pas fonctionné.
Q.: Vous voulez promouvoir une volonté d'émancipation hors de la superstition techniciste...
BS: Nous n'avons nullement l'intention de promouvoir une hostilité généralisée à la technique, mais nous voulons installer dans les esprits une attitude critique à l'endroit de la technique. Nous disons que telle ou telle situation doit être changée. Nous raisonnons dans un cadre global écologique en matières agricoles, économiques, dans les domaines des communications, de l'urbanisme, de l'habitat, bref, dans tous les domaines de la vie. Nous souhaitons que les décisions politiques soient prises en tenant compte de notre cadre écologique global, en tenant compte des impératifs de la Nature et non le contraire.
Q.: Il y a une question typique que posent les partis: pendant combien de temps encore serons-nous en mesure de financer la protection de l'environnement?
BS: C'est une question qu'il ne faudrait pas poser. En revanche, il faudrait en poser une autre: que signifient les progrès que nous avons faits sur la voie techniciste et mécaniciste par rapport à l'ensemble des paramètres de la Vie sur notre Terre? Et quels sont les effets de ces “progrès” sur l'environnement, la culture, les faits ethniques, qui structurent l'homme? Le question du financement de la protection de l'environnement est une question d'irresponsable, une question d'esprit libéral.
Q.: La question écologique est-elle simultanément une question profondément religieuse?
BS: Pour que nous puissions vivre un bouleversement réel, définitif, de notre pensée, marqué par la conscience écologique, il faut qu'une religiosité nouvelle se déploie. Aujourd'hui, la religion a pour ainsi dire disparu. Il ne reste plus que des structures confessionnelles. Le christianisation de l'Europe a été la première étape dans le houspillement du divin hors de la nature, hors de notre vivifiante proximité, hors du tellurique. Cette christianisation a préparé le terrain au désenchantement, puis au désenchantement technicisto-mécaniciste, qui nous a conduit à la situation désastreuse que nous connaissons aujourd'hui. Quand je parle de déployer une nouvelle religiosité, je n'évoque pas le New Age ou une autre superficialité du même acabit, mais je veux retourner aux sources mêmes de toute religiosité, c'est-à-dire au regard plein d'émerveillement que jetaient nos plus lointains ancêtres sur l'harmonie cosmique, sur les astres. Pour eux, la Nature, dans sa plus grande perfection, c'était ces étoiles qui brillaient au firmament. Il faut restaurer cette dimension cosmique et astronomique de la religion. Et se rappeler de l'année cosmique dont parlait Platon, année cosmique qui durait 2150 ans. Un cycle de cet ordre de grandeur est en train de s'achever: nous nous trouvons dans une sorte d'interrègne, dans une phase de transition, nous allons rentrer dans une nouvelle année cosmique selon Platon. Les religions révélées dualistes, qui ont dominé au cours des siècles précédents, vont s'effillocher et céder le terrain à des religiosités de l'immédiateté, des religiosités holistes. Notre tâche: trouver des formes socio-politiques adéquates, qui correspondent à cette transition, à cette nouvelle année cosmique.
Q.: Y a-t-il une recette patentée pour nous débarrasser de la dictature du matérialisme et des paradigmes du mécanicisme?
BS: Je suis opposé à toutes les “recettes patentées”. Elles ont plutôt l'art d'exciter mes critiques. Mais l'humanité doit prendre des décisions fondamentales. Le retournement des valeurs va s'opérer, en dépit de l'hostilité que lui porte le capitalisme dominant. Je ne crois pas que ce retournement va s'opérer brutalement, en un tourne-main, par une sorte de révolution-parousie. La lutte sera longue. Nous, les écologistes, nous devons élaborer des propositions réalistes.
Q.: Ce sont des propositions réalistes de ce type que vous suggérez dans votre livre, notamment en formulant «Dix thèses pour une agriculture vraiment paysanne». En même temps, vous formulez une critique acérée contre les politiques agricoles conventionnelles...
BS: Pour la plupart des politiciens de l'établissement, les quelques misérables pourcents de l'agriculture dans le PNB sont une quantité négligeable. C'est pour cette raison que tout le discours sur la “promotion des entreprises agricoles familiales” n'a jamais été suivi d'effets, que ce discours n'a été que propagande et poudre aux yeux. En réalité, on a, par décrets administratifs, systématiquement exterminé le paysannat européen. Cette politique a commencé avec Mansholt; elle a continué avec Bochert; leur intention était claire: évacuer le fossile paysannat, le jeter définitivement au dépotoir de l'histoire. Je m'oppose avec vigueur à ce génocide, je refuse de considérer le paysannat comme une quantité négligeable. Je pose une question qui vous donne d'emblée le clivage qui s'installe: Agriculture véritablement paysanne ou industrie agro-alimentaire? Si nous luttons pour revenir à une agriculture naturelle, nous luttons pour l'avenir de tous les hommes sur la planète. Ce retour à l'agriculture s'effectuera sans doute à la fin de la période de transition que nous vivons aujourd'hui. Mais si nous ratons cette transition, nous mettrons en jeu la survie de l'humanité, nous préparerons le dépérissement misérable de nos descendants.
Je veux promouvoir une renaissance du mode de production originel. Seuls les produits issus d'un tel mode de production peuvent générer la vraie Vie. Une véritable agriculture, c'est le pilotage et l'accroissement naturel des processus agraires dans le cadre d'un environnement naturel, sans que celui-ci ne soit artificiellement transformé. Les bio-paysans, nombreux en Allemagne aujourd'hui, pratiquent cette agriculture avec succès. Leurs produits sont meilleurs, sont demandés. Leurs méthodes scientifiques, écologiques au sens scientifique du terme, sont performantes. Ils pratiquent ainsi une immédiateté avec la nature, le sol, la géologie, ils s'abstiennent d'utiliser des méthodes transformatrices dangereuses sur le long terme; ils reviennent au mode de production originel, tout en restant concurrentiels. Voilà des exemples concrets à suivre. Dans tous les domaines de l'économie.
(propos recueillis par Hanno Borchert et Ulrich Behrenz, parus dans Junge Freiheit, n°16/95).
00:05 Publié dans Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, verts, écolos, biorégionalisme, politique, théorie politique, enracinement, racines, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook